Les phrases assassines
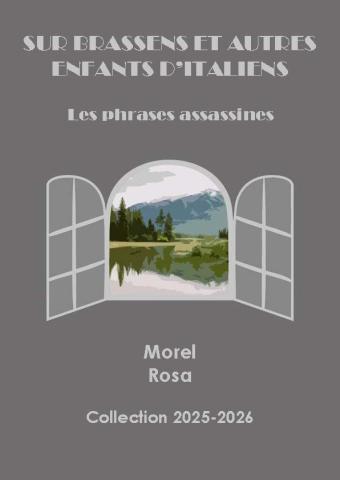
Quand on est immigré, on parle bien sûr d’intégration. S’intégrer, s’immerger dans cette
nouvelle vie, comme le caméléon : prendre ses couleurs, se fondre dans la masse, devenir
« pareil », ne plus se distinguer ni par les vêtements, ni par la langue, perdre son accent, changer
toutes ses habitudes… Comment est-ce possible ? Comment est-ce faisable ?
Nous en avons fait des efforts, tous, de toutes sortes, mais nous sommes restés « les Italiens »
en France et nous sommes devenus les francese en Italie. Je me souviens, ils arrivaient de tous
les coins du village lorsque nous y allions en vacances, avec des grands signes de bras, en criant
joyeusement : Rivaru i francese !
Mes parents et leurs trois enfants sont arrivés en France en 1950. Mon père était venu
deux ans auparavant pour gagner un peu d’argent et acheter quelque terrain un peu plus facile
à cultiver. Mais la séparation était dure et ils ont décidé de déplacer la famille, le temps de
rassembler quelques économies pour pouvoir retourner au pays et vivre mieux. Un long voyage
du sud de la Calabre au nord de la France. Je n’étais pas encore née, mais ils ont tellement
raconté cette période de leur vie que j’ai l’impression de l’avoir vécue avec eux. Ils en ont parlé
jusqu’à la fin de leur vie avec des yeux pétillants.
Ils évoquaient les moments difficiles : la traversée plus ou moins clandestine, à pied pour
les hommes, en cordée à travers le mont Blanc ; les bus qui les attendaient après la frontière, la
visite médicale pour évaluer les plus costauds (les plus faibles devaient faire marche arrière !),
puis la répartition dans les bus pour des destinations qu’ils ne choisissaient pas. Pour mon père
et plusieurs de mes oncles, ce fut le Pas-de-Calais : travail dans les mines de charbon.
À cette époque mon père travaillait « au fond » dans la journée et y retournait la nuit pour
s’occuper des chevaux qui travaillaient eux aussi dans la mine et ne remontaient au « jour » qu’une
fois morts. Plus tard, il a fait les tournées de nuit pour gagner plus, dans la mine « mouillée »
pour respirer moins de cette poussière qui détruisait les poumons. Pour son dernier poste, il était
injecteur : il devait injecter de l’eau dans des petites galeries et devait ramper dans ces galeries,
mais il y avait moins de poussière.
La pénibilité de ce travail, le danger des coups de grisou, furent les choses qui pesèrent
sur leur nouvelle vie. Jamais ils ne se sont plaints ni du climat, ni du paysage ; partis de leur
Calabre lumineuse pour arriver en plein hiver dans le Pas-de-Calais aux étranges « montagnes »
qu’étaient les terrils, jamais, jamais, ils n’ont dit que cela ne leur plaisait pas, ils étaient là, en
attendant de repartir pour des jours meilleurs. Ils parlaient avec bonheur de leur arrivée en
France, de l’accueil qu’ils ont reçu. On leur avait attribué un logement : une « baraque » en bois
avec quelques meubles dans la cité des Six Drèves à Libercourt, où on logeait tous les immigrés
avec des quartiers différents pour chaque nationalité : les Italiens, les Polonais, les Algériens, etc.
La vie était assez dure : il fallait aller chercher l’eau à la fontaine, on lavait le linge à la main, les
toilettes étaient communes à plusieurs familles, mais la vie était joyeuse. Les Calabrais faisaient
connaissance avec les autres Italiens venus des autres régions. En fait, à cette époque-là, ils
ont fait en quelque sorte connaissance avec l’Italie plus qu’avec la France : ils ont échangé des
recettes de cuisine, appris que les coutumes n’étaient pas les mêmes, qu’ils parlaient des dialectes
différents : les Siciliens disent comme ça, les Piémontais cuisinent la polenta comme ça…
Le contact avec les Français, ce fut à l’école pour les enfants, où on les a vite intégrés avec
leur classe d’âge. Ils étaient pris en charge le soir après l’école et les jeudis (jour libre du milieu
de la semaine, car à ce moment-là on allait à l’école du lundi matin au samedi soir), ce qui leur
a permis d’apprendre le français et de se remettre à niveau pour passer le certificat d’études à
quatorze ans comme tout le monde.
Le contact avec les Français, pour les mamans, c’était à « la cantine ». J’ai mis longtemps à
comprendre qu’ils désignaient ainsi l’épicerie où ils allaient acheter ce qu’il leur fallait pour la vie
quotidienne. Un jour, ma mère voulait faire la sauce tomate pour la pasta asciutta et avait besoin
de boîtes de tomates pelées ; elle est donc allée en acheter à la cantine et ne sachant pas parler
français, elle a montré à la vendeuse des boîtes rouges. Une fois rentrée à la maison, elle en
ouvre une et, surprise, elle découvre une matière blanche et collante ! C’était du lait concentré,
mais elle fut désemparée, ne comprenant pas ce que c’était cette sauce tomate blanche. À partir
de ce moment-là, elle a toujours attendu ou envoyé les enfants pour faire les courses, les enfants
qui ont très vite appris le français et qui petit à petit ont pris en charge beaucoup de choses : les
papiers à remplir, les déclarations d’impôts, les démarches administratives… Ce qui fait que les
parents, les mères surtout, ont beaucoup tardé à apprendre le français.
S’intégrer, c’était aussi avoir la curiosité de goûter des choses nouvelles. Quelques anecdotes
nous ont longtemps fait rire. Comme celle d’un oncle qui avait découvert à « la cantine » des pots
en verre qui contenaient une jolie crème jaune ; alors un jour, il se laissa tenter et pour partager
la joie de la découverte, il appela toute la grande famille pour goûter avec lui. Quand tout le
monde fut réuni, il ouvrit le joli verre et s’attribua l’honneur de goûter le premier. Il remplit
bien sa cuillère et la mit dans sa bouche avec gourmandise… mais cela lui monta vite au nez
provoquant une spectaculaire crise d’éternuements et de larmes : c’était de la moutarde !
Je n’ai pas connu cette vie aux « baraques » à la cité des Six Drèves, car nous avons déménagé
lorsque j’avais un peu plus d’un an. On nous a attribué à ce moment-là une maison en briques,
rue du Vert Chemin, à Libercourt. Je comprends seulement maintenant pourquoi j’ai tant aimé
le conte des trois petits cochons… Quel avancement social et quelle sécurité cette grande maison
en briques, avec un grand jardin où mon père cultivait de quoi nous nourrir et où ma mère
semait toutes sortes de fleurs. Les volets étaient peints en vert, des œillets parfumaient les appuis
de fenêtres… le bonheur… nous habitions rue du Vert Chemin… Je réalise aussi maintenant
pourquoi je collectionne les jolis noms de rue. J’ai toujours sur moi un petit carnet dans lequel je
consigne des noms de rue comme : rue des Horizons clairs ; rue de Bel Air ; chemin des petits
chiens ; rue des Poux Volants ; chemin de la vie des morts… et la ville où elles se trouvent. Y
a-t-il une rue du Vert Chemin dans une autre ville ? À Libercourt, c’était mon coron, il n’y avait
pas de vert chemin en vrai, mais dans ma tête chante encore ce vert chemin et toute la poésie
de l’adjectif qui précède le nom… et la poésie des Six Drèves…je ne savais pas ce qu’étaient des
« drèves » et je ne cherchais pas à le savoir… j’aimais ce « flou ». Voyage suspendu où j’imaginais
six arbres immenses ; ou bien six rêves ; ou six rênes, ou six reines ; ou sirènes…ou six... ?
dictionnaire !
Drève : (moyen néerl. De driven, conduire) Dans le Nord et en Belgique, allée carrossable
bordée d’arbres… Dictionnaire Larousse. Que c’est beau !
Donc, il y en avait six… six chemins carrossables pour accueillir des ouvriers étrangers
venus travailler en France… J’imagine ces six chemins en étoile… la vie comme en rêve… et
puis après dans le coron en briques pour les familles italiennes et polonaises… nous avions
des situations semblables : venus tous d’ailleurs pour travailler ici, étions-nous en France ? À
la maison, nous parlions calabrais. Nous étions cinq enfants, trois nés en Italie et deux nées
en France… nous relisions le livret de famille qui nous réunissait, mais d’une étrange façon
là encore. Ma sœur et moi demandions : « où je suis née, Maman ? » et elle répondait : « À la
barrrrracca ! » Nous étions nées dans la même maison, mais chose curieuse, sur le livret de
famille l’une était née à Libercourt dans le Pas-de-Calais, l’autre à Wahagnies dans le Nord.
Non il n’y avait pas d’erreur, les frontières entre les départements avaient changé.
C’est quand nous avons déménagé une nouvelle fois que nous avons vraiment passé
la frontière, que nous sommes vraiment arrivés en France. Et ce n’était pas très loin : à une
vingtaine de kilomètres de là. Dans une jolie petite ville près de Lille. Une maison était à vendre
(en briques bien sûr). Mes parents sont allés la visiter ; elle leur a plu : rez-de-chaussée, jardin,
quatre chambres, vue sur le parc de la Mairie… ils ont acheté – comptant – surtout pas de
crédit, le crédit c’était la honte ! Comment ont-ils fait pour économiser sou par sou ? Mon père
a continué à travailler à la mine, de nuit, faisant les trajets en bus et en train. Ils avaient choisi
de venir vivre là pour que ce ne soient pas les enfants qui fassent les trajets, car pour les études il
fallait venir à Lille. Papa travaillait la nuit, le matin il faisait le jardin, il cultivait toutes sortes de
légumes et râlait après maman parce qu’elle plantait des fleurs, inutiles pour nourrir la famille.
Mais elle a tenu bon et elles nous ont nourri l’âme, toutes ces couleurs parmi les légumes et les
jolies fleurs dans les vases dans la maison. Donc nous avons quitté le coron et c’est à ce moment là
que j’ai compris nos différences, que nous étions des Italiens en France.
Lorsque ma mère est venue nous inscrire à l’école, la maîtresse ne comprenait pas ce qu’elle
disait, elle s’impatientait, elle se mit à parler de plus en plus fort ; je me sentais humiliée ; j’avais
envie de lui dire : « mais, madame, ce n’est pas en criant qu’elle va vous comprendre mieux ! ».
La maîtresse dans les mines, certainement habituée aux accents de tous ces gens, comprenait ce
que disait ma mère et elles se parlaient chaque soir pour me laisser le temps de choisir un livre
dans la bibliothèque.
Notre vie ici est devenue différente ; la porte de la maison était close. Il fallait sonner pour
que quelqu’un vienne ouvrir ; le soir on fermait bien à clef. Là-bas, comme dans le village de
Calabre, la porte était un seuil que l’on passait en saluant d’un joyeux : Chi si dicci ? et la maison
était pleine de cousins, cousines, oncles et tantes…
Ici, on était éloignés de tous et on se rendait visite de temps en temps, c’était un peu plus
compliqué : il fallait prendre le bus, le train.
Ici, avec les voisins, c’était « Bonjour ! Bonsoir ! » et chacun chez soi. Cela a duré un certain
moment. J’avais l’impression d’un grand isolement. Nous avons réalisé petit à petit que l’arrivée
d’une famille italienne du pays minier avait quelque peu semé le désarroi dans cette rue chicissime.
Quelle horreur : des étrangers, avec plein d’enfants. Et le père mineur qui allait rentrer
chez lui avec la gueule noire de charbon… Mais ce qu’ils ont vu fut différent : ma mère briquait
la maison comme à son habitude, mais elle s’activait encore plus sur le seuil : la pierre noire
luisait, la serpillière qui servait d’essuie-pieds était immaculée et la poignée de porte en cuivre
était lustrée au « Vitror » au moins une fois par semaine. Dans le jardin derrière la maison, le
linge qui séchait, passé à la lessiveuse et frotté à la main, était plus blanc que blanc. Du deuxième
étage, on voyait les autres jardins : pelouse, quelques rosiers sur le côté, mais pas de fil à linge.
Énigme : où faisaient-ils sécher leur linge, les voisins ? Ils ne mangeaient pas de légumes, les
voisins… C’est vrai que vu d’en haut, notre jardin foisonnait d’exotisme.
Mais le matin, quand le père rentrait de la mine, il descendait du bus avec sa jolie veste,
digne, fatigué mais souriant et propre. Ils ne savaient pas, les voisins, que ce qu’aimait mon père
– si actif au travail – par dessus tout, c’était sa douche ! D’ailleurs, ils ne savaient pas, les voisins,
que dans les mines, aucun travailleur ne rentrait noir de charbon.
Nos relations ont évolué grâce, bien sûr, à toute l’application que nous mettions naturellement
à être très discrets, aimables, souriants et surtout grâce aux parfums envoûtants de la cuisine
de ma mère. Je me souviens parfaitement de ce soir-là, où comme d’habitude nous rentrions de
l’école, ma sœur et moi, et ma mère avait préparé pipe e patate, ça sentait bon à en mourir ! da
morire comme on dit en Italie quand c’est « trop ». Ma mère est venue nous ouvrir la porte et la
voisine rentrait au même moment. Elle nous a saluées en nous disant : « Qu’est-ce que ça sent
bon ! » Ma mère a essayé de lui expliquer ce que c’était et a fini par dire : « Vous attendre oun
po » et elle est vite revenue avec une pleine assiette de pipe e patate. C’est ainsi que débuta une
belle amitié gourmande, avec cette recette toute simple mais si parfumée :
Ingrédients :
• deux ou trois poivrons (de différentes couleurs, c’est plus joli)
• 500 g de pommes de terre
• cinq ou six gousses d’ail
• basilic, origan, sel, poivre
• une ou deux tomates
Recette : Couper les poivrons en petits carrés, les faire revenir dans de l’huile d’olive.
Lorsqu’ils sont bien tendres, les ôter de la poêle ; remettre un peu d’huile et y faire rissoler les
pommes de terre coupées en petits cubes. Lorsqu’elles sont bien dorées, ajouter les poivrons, l’ail
haché finement et les tomates épépinées et coupées en morceaux, ajouter un peu d’eau et laisser
cuire ensemble à feu doux cinq à dix minutes. Salez, poivrez, ajouter une belle pincée d’origan
et une jolie poignée de basilic haché.
La voisine a été apprivoisée, elle est même venue manger chez nous parfois. On discutait.
C’était bien.
Et voilà comment l’intégration passe par les papilles ! Intégration ? Non, le mot n’est pas
juste ; il faudrait dire plutôt dans ce cas : adoption. Car en ce qui concerne notre intégration,
c’est justement avec la nourriture que mes parents ont fait de la résistance. Chez nous, c’était la
Calabre reconstituée, dans cette maison chic, dans ce quartier distingué du nord de la France,
il s’en passait des choses culinaires ! Nous vivions presque en autarcie. Mes parents, en plus de
la culture de leurs légumes, de la confection de tous les vêtements, faisaient leur fromage avec
des litres de lait achetés à la ferme et la présure donnée par le berger de notre village lorsque
nous y allions ; ils faisaient aussi la charcuterie de chez nous. En hiver, souvent vers le mois de
février, toute la famille partait en expédition en bus au marché de Wazemmes, à Lille, acheter
le « cochon » et revenir discrètement avec nos sacs pleins pour une ou deux belles journées de
travail, on faisait la coppa, la pancetta, du confit de porc, les curcucci, les saucisses fraîches puis
sèches.
En automne des cageots de raisin muscat remplissaient la cave et nous faisions notre vin. À
Noël, c’était comme le voulait la tradition les crispedi aux anchois ou sucrées et les petrale, petits
gâteaux délicieux fourrés aux fruits secs ; à Pâques les n’gutis aux grains d’anis et décorées avec
des œufs durs qui recuisaient avec la pâte au four et prenaient un goût délicieux. Et pour le
quotidien : minestrone, lasagne, parmigiana, pasta asciutta, pruppett… Oui, par la nourriture nous
cultivions notre différence et nous avions presque parfois l’impression d’agir clandestinement…
nous étions italiens et heureux de l’être dans notre ventre.
L’idée de retourner vivre en Italie était passée en quelque sorte en arrière-plan, notre vie
se déroulait assez bien avec un certain équilibre, celle d’une maisonnée italienne dans une rue
française… mais un jour – j’étais alors en quatrième – j’ai demandé à mon père de me faire
naturaliser française car je voulais passer le concours de l’École Normale et pour cela il fallait
avoir la nationalité française. Cette demande fut pour moi très difficile car cela signifiait devenir
étrangère dans ma propre famille ! Il était implicite que nous étions tous italiens et que – un
jour – nous retournerions vivre chez nous. L’idée était toujours là, comme évidente, mais plus
vraiment formulée… mais moi, je ne voulais pas rentrer « chez nous », j’étais née en France et je
voulais y rester et surtout continuer mes études. Oh ! drame familial ! Mais mon père ne se fâcha
pas, il semblait être attristé mais comme pour lui les études passaient avant tout, nous allâmes
au tribunal de Lille pour me déclarer française.
Quand, au collège, j’ai dû apporter mes papiers pour compléter mon dossier, une de mes
camarades, voyant ce document spécial, me dit : « Ah bon ? Tu n’étais pas française ? Et pourtant,
tu étais quand même gentille ! »
Et voilà une des phrases assassines de mon passé que j’ai enfouies, mais que je n’ai jamais
pu oublier, que j’ai gardées au bord des lèvres, au bord de moi et qui m’ont longtemps fait mal.
Mais je réalise que, finalement, elles ont été une richesse, une boule de secrets dits qui m’ont fait
garder la tête haute. Oui, pourtant je suis QUAND MÊME gentille… Une phrase pareille, ça
vous construit, comme cette autre phrase, entendue à l’épicerie de mon quartier chic : Ce n’est
pas possible ! vous avez vu, les filles des Italiens, elles ont pris les places de nos enfants, elles sont
les premières de leurs classes… » (à prononcer à mi-voix, d’un air scandalisé.)
La même année, lors d’un pique-nique de classe tiré du sac, que nous devions partager,
j’avais apporté ce qu’il y avait de meilleur de chez moi : coppa aux graines de fenouil, fromage et
pain faits par ma mère, figues sèches d’Italie parfumées au zeste de mandarine et petites olives
noires. Lorsque nous avons mis notre « participation » sur la nappe, par terre, c’est vrai que
j’avais étalé là ma différence, ça se voyait, c’était criant : à cette époque-là, on ne trouvait pas ces
denrées dans le commerce. Personne n’a goûté ma nourriture ; beaucoup de grimaces, de nez
tordus ; sentiments mélangés, pas de mots. Ça se mange ça ? Ils n’en n’ont pas voulu. Et pourtant
j’étais quand même gentille…
Il y a eu aussi des phrases assassines à l’intérieur de ma maison, des petites « blagues » pour
moi, la Française désormais, rien de méchant mais… : on préparait je ne sais quel plat et on
m’a dit : « lèche-toi les doigts maintenant, les Françaises, elles se lèchent les doigts quand elles
cuisinent ! » (à prononcer d’un air gentiment moqueur, mais…)
Et c’est ainsi que je suis devenue moi, italienne, française, professeur d’allemand et de
français, mariée à un demi-polonais, goûtant et cuisinant toutes les cuisines que je croise, tous
les mots de ces langues merveilleuses, toutes ces différences, toutes ces richesses.
Quand il fut en retraite, mon père partit en automne en Calabre, car il se disait que, les
enfants étant sortis d’affaire, il pouvait envisager de repartir au pays avec ma mère. Il est revenu
quelques mois après avec quelques trésors : des châtaignes fabuleuses, des oranges merveilleuses,
mais il nous a dit avec ce sourire étrange qu’il avait lorsqu’il regardait un coucher de soleil :
« Là-bas, c’est mon pays, ici c’est ma maison. »
Et ils ne sont pas repartis.
