" Ho fatto il mio coraggio "
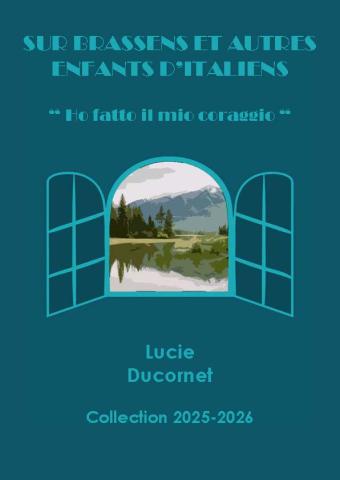
Cette étude porte sur un documentaire intitulé Ho fatto il mio coraggio, réalisé en 2008 par Giovanni Princigalli et Francesco Fasiolo à Montréal et publié sur le site internet du quotidien italien La Repubblica le 8 octobre 2009. C’est une série de témoignages d’Italiens, des hommes et surtout des femmes, qui ont émigré au Canada. Leurs propos sont entrecoupés de documents d’archives : des photos appartenant aux personnes qui parlent, des vidéos, des images ou de la musique permettent d’illustrer leur récit. Elles racontent quelles furent leurs motivations, les conditions et les conséquences du voyage qui pour chacune changea sa vie. Âgées d’environ soixante-dix à quatre-vingts ans, elles font aussi le bilan de leur vie dans leur pays d’accueil. Ces personnes sont venues du sud de l’Italie et firent partie de la dernière grande vague d’immigration italienne qui débuta après la Seconde Guerre mondiale, immigration qui fut attestée dès le XVIIe siècle au Québec. Pendant la guerre, le Canada interdit l’immigration italienne en raison du régime fasciste en Italie et cette interdiction ne fut levée qu’en 1947. En 1949 les Italiens commencèrent véritablement à affluer au Canada, vers les grandes villes, pour trouver un travail.
C’est sur les témoignages des femmes que nous allons surtout nous pencher. Il semble utile de souligner que leurs propos furent sûrement influencés, entre autres, par les conditions dans lesquelles se déroula l’interview et par la personnalité plus ou moins introvertie de chacune. Nous essaierons malgré tout de discerner au mieux ce que chacune a voulu exprimer.
L’écoute de ces témoignages nous permet de constater que les expériences d’immigration ont des caractéristiques communes et, en même temps, que chacune a vécu les événements de sa vie de manière singulière. Nous allons donc tout d’abord examiner comment elles nous racontent la période de leur départ, puis nous mettrons en relief les principales caractéristiques de leur vie d’immigrée une fois arrivées dans le pays d’accueil, enfin nous analyserons la manière dont elles ressentent leur immigration à l’âge de la retraite.
L’éventualité du départ : un choix ?
Les femmes de ce documentaire ont tout d’abord été confrontées à une première question : celle du départ. C’est souvent soudainement que ces femmes apprirent qu’elles seraient peut-être amenées à quitter leur pays pour le Canada. Cette question provoqua une intrusion dans leur vie, quand leur adolescence s’achevait à peine. Vivant dans un milieu rural et assez pauvre, la plupart d’entre elles avaient vu d’autres filles de leur voisinage immigrer à l’étranger. Elles-mêmes menaient une vie monotone : le changement ne faisait pas partie de leur vie. Certaines travaillaient la terre avec leur famille, comme ce fut le cas de Rosa. Par ailleurs, elles n’avaient aucune idée du monde extérieur, en dehors de leur région ou de leur pays. Ainsi, cette idée d’un départ pour la vie vers un ailleurs totalement inconnu engendra chez toutes des émotions très fortes.
L’on peut alors séparer leurs expériences suivant que les femmes eurent à faire face au doute ou pas. En effet, le doute suggère l’idée de pouvoir faire un choix, or toutes n’eurent pas cette liberté. Se distinguent les expériences d’Angela et de Rosa par rapport à celle d’Antonietta. En effet, Angela, interrogée au début du documentaire, résume toute la période avant son départ en une seule phrase : « Je ne me suis pas demandée si mon mari était bon ou gentil, je suis juste venue au Canada », qui nous fait clairement comprendre qu’elle n’eut pas le choix. Rosa, quant à elle, s’exprime moins directement mais laisse sous-entendre qu’il n’y avait pas d’alternative : « Pour être honnête, je n’avais pas l’intention d’immigrer au Canada ». En revanche, Antonietta a d’abord refusé plusieurs fois avant d’accepter : « J’ai continué à dire “non, non, non” et finalement j’ai décidé de venir ici ». Ces refus successifs et ce changement d’avis brutal témoignent de ses hésitations, pas non plus d’un véritable choix.
Deux autres témoignages, celui de Lina et Maria, montrent que la réponse s’imposait à ces femmes comme une évidence. Lina explique : « j’avais envie de partir car il y avait trop de misère, j’avais eu trop de problèmes ». Maria, quant à elle, invoque une raison qui semble plus optimiste : pour elle, « nous sommes comme des oiseaux » et quand on grandit il faut « déplier ses ailes et s’envoler ».
Si tant est qu’on ait laissé à ces femmes la possibilité à un moment d’exprimer leur avis sur la question du départ, chaque alternative s’avérait remplie de composantes négatives. Leur libre arbitre les poussa alors sans doute à préférer la situation qui semblait comporter le moins de désavantages pour elles, et donc à partir.
La question du mariage et sa représentation dans l’esprit des futures émigrées
Si les femmes interviewées dans ce documentaire disent aussi avoir émigré au Canada dans l’espoir de meilleures conditions de vie, la première cause était, pour chacune, le mariage avec un immigré italien qui habitait déjà au Canada. L’image préalable qu’elles se faisaient de ce type d’union fut donc cruciale dans leur appréhension du changement de vie qui s’imposait à elles.
Pour celles qui l’ont précisé, leur mariage était un mariage arrangé entre les parents des deux futurs conjoints. Par contact postal, le père du futur époux entrait en correspondance avec le père d’une jeune femme. Les deux familles échangeaient alors généralement des photographies des deux futurs époux afin de décider si chacun leur convenait. Comme le dit Antonietta, « certains paraissaient plaisants sur les photos ».
Certaines jeunes femmes eurent la liberté de correspondre avec leur futur époux avant le départ. Si Angela n’eut guère de contact avec son mari et n’eut guère le choix de s’interroger sur son futur mariage, en revanche Antonietta et Lina semblent avoir entamé une relation sentimentale avec leur futur mari avant leur départ. Antonietta lit une lettre d’amour de son futur mari dans laquelle il lui déclarait ses sentiments et Lina nous fait part de quelques mots que lui écrivit son mari : « Lina chérie, vous serez ma compagne pour toute la vie ».
Antonietta se démarque aussi parce qu’elle eut apparemment la liberté de dire à ses parents et à ceux de son futur mari : « quand j’aurai dix-huit ans, je viendrai et j’amènerai tous les documents, au bout d’une semaine je serai prête pour le mariage, mais j’y vais libre et votre fils aussi ! ».
On peut s’interroger ainsi sur les représentations du mariage que pouvaient avoir ces très jeunes femmes d’environ dix-huit ans, parfois moins (Antonietta), lors de l’annonce de leur mariage potentiel. Cette vision est encore idéalisée du fait de leur jeune âge. Antonietta montre ainsi qu’elle fut très touchée par les lettres d’amour de son mari et ne doute pas un moment que s’il lui payait son voyage, c’était « parce qu’il voulait vraiment qu’elle vienne ». On distingue en filigrane une certaine naïveté qui lui fait penser qu’elle a été exclusivement aimée pour sa personne, les sentiments ayant pu ne pas être pas aussi exaltés de l’autre côté de l’Atlantique car son mari dit seulement avoir trouvé sa femme « pas mal » sur la photo. Antonietta semble ainsi ne pas avoir pu résister aux mots doux de son futur époux mais, lucide, elle explique qu’elle ne donna son accord pour le mariage qu’après une semaine passée au Canada : « trop de filles à cette époque était malheureuses ».
Ainsi, mis à part pour Angela qui n’eut visiblement aucune liberté de pensée, chaque femme, tout en idéalisant le mariage, puisa en elle-même, de par son expérience et son éducation, l’idée d’une possible inadéquation de ses sentiments avec la réalité.
Le départ : premières sensations de l’action
Pour toutes ces femmes, le départ se caractérise par l’adieu à la famille, le trajet jusqu’au port, l’embarquement à bord du bateau et la traversée. Elles n’ont pas toutes donné de détails sur cet épisode de leur vie mais, même lorsqu’elles n’en ont donné que très peu, ce qu’elles ont exprimé est globalement marqué par un extrême déchirement. On peut même penser que cette période de leur vie fut la plus traumatisante car c’est là qu’elles durent vivre l’enclenchement du phénomène qui allait changer leur vie. C’est par l’action qu’elles entrèrent dans l’irrémédiabilité la plus concrète.
Les adieux à la famille furent la première étape. C’est ce qui les entraîna dans un engrenage de situations devant lesquelles elles ne pourraient plus reculer car elles quittèrent les seules personnes qui pouvaient encore jouer sur la situation. Pour les membres de la famille, c’était aussi un grand déchirement : les parents étaient conscients des dangers encourus par un tel voyage et ils devaient avoir à l’idée ce qu’allait être la vie de leur enfant au Canada. Rosa témoigne qu’elle vit son père pleurer pour la première fois. Quant aux frères et sœurs, s’ils étaient assez âgés, ils devaient aussi être inquiets du futur de leur sœur. S’ils étaient plus jeunes, ils devaient augmenter le tragique de la scène par leurs pleurs marqués par l’incompréhension. Lina raconte par exemple que lorsqu’elle partit « ses sœurs étaient au balcon et pleuraient ». Ainsi une jeune femme qui partait devait à la fois faire face à sa souffrance et à celle de son entourage et malgré tout prendre part à l’action. Nous en voyons notamment les séquelles chez Antonietta qui, cinquante ans après avoir quitté les siens, nous dit « ce n’était pas facile quand j’ai quitté mes parents... » et se met à pleurer. Sa réaction exprime bien l’euphémisme qui caractérise ses propos.
Mais si ce fut un moment extrêmement difficile, le départ ne signifiait pas forcément le même type de séparation. Si, pour Rosa, cela signifiait apparemment une rupture totale car elle « ne repassa jamais un Noël avec [sa] famille », pour Antonietta la séparation fut moins totale car son père lui dit : « si tu y vas, je viendrai te voir. Je n’en ai pas besoin mais je viendrai te retrouver », ce qu’il fit un an après.
La deuxième étape fut le voyage du domicile familial jusqu’au quai du navire. Sur ce trajet, nous ne possédons que le témoignage d’Antonietta, mais il est significatif. En effet, dans le documentaire, elle montre une photo de personnes, celles qui l’ont « emmenée » à Naples, « on a dormi à Naples » ajoute-t-elle. Ces gens lui étaient peu familiers et le trajet fut assez long pour durer plus d’une journée, ce qui devait laisser place à l’angoisse et à la solitude.
Ensuite, les femmes devaient embarquer à bord du bateau qui allait les mener jusqu’au Canada. Là s’accomplissait l’entrée dans un univers inconnu, à ce moment matérialisé par l’océan. Les femmes l’expriment tout à fait dans leurs propos. Ainsi, Antonietta nous dit que ces personnes qui l’ont emmenée jusqu’au quai de son bateau « sont restées là-bas et [qu’elle est] partie sur le bateau », évoquant clairement la séparation spatiale qui fut caractéristique de ce moment. De plus, on ressent dans cette description imagée l’empreinte que cette situation a dû laisser dans sa mémoire : ce n’est pas la trace d’un phénomène flou dont les sensations seraient diffuses mais plutôt un souvenir parfaitement net et si important qu’Antonietta en a gardé jusqu’aux traces visuelles. Lina nous livre aussi un témoignage rempli d’émotion sur ce moment : « Madonna, si j’avais su, je n’aurais jamais mis les pieds sur ce bateau ». Elle explique pourquoi : « car après, une fois cela accompli, on ne pouvait plus s’en aller », « je voulais juste m’enfuir en courant, c’était impossible ». C’est donc aussi le sentiment d’être prise dans un piège qui s’était déjà refermé, qui a pu être ressenti chez ces femmes.
Enfin, la traversée fut la dernière étape avant l’accostage. Ce fut un long moment, plus d’une dizaine de jours, où les femmes étaient livrées à elles-mêmes. Lina nous en fournit un témoignage très important. Elle nous dit combien la traversée était difficile d’un point de vue physique : « quand on atteignit l’océan, le navire commença à tanguer et je commençai à vomir ». Son moral était atteint : elle ne sortait presque pas de sa chambre et ne mangeait plus à tel point qu’un garçon de service lui dit un jour : « vous allez mourir sur ce bateau ». On ressent ainsi à travers son expérience la souffrance qui a dû s’emparer d’elle toute entière. C’est une véritable désorientation qui devait toucher toutes ces femmes.
D’autre part, la traversée est caractérisée par un autre type de sensations fortes : le renversement de certains a priori et la découverte d’un monde nouveau. Ainsi, nous retrouvons tout au long du discours de Lina des exclamations qui expriment combien elle fut étonnée par quasiment tout ce qu’elle vit : « la mer était si énorme ». Lina explique d’ailleurs clairement sa découverte par ces termes : « vous voyiez un tas de choses étranges ». Cette exploration aurait pu être ressentie positivement dans certaines conditions tandis qu’ici elle vient amplifier l’angoisse de Lina, expliquant son choix de rester cloîtrée dans sa chambre, seul repère de type terrestre.
La résignation et l’idée de l’avenir devant soi
À leur arrivée, les femmes immigrées devaient être empreintes du sentiment qu’après un si long voyage et tant d’épreuves traversées, le retour en arrière était véritablement inenvisageable. Lina rapporte qu’elle s’était dit à elle-même : « je dois m’y habituer, je dois vivre ici ».
Ces femmes n’avaient donc plus qu’à accepter de penser leur avenir au Canada. Elles s’efforcèrent alors certainement de discerner les bons côtés de la vie dans le nouveau pays. Ainsi, plusieurs femmes nous relatent qu’elles constatèrent la réalisation de quelques promesses d’une vie meilleure au Québec. Antonietta admet que, lorsqu’elle est arrivée, elle était « contente car [son mari] avait déjà acheté les meubles ». Dans le documentaire, juste après cette phrase, on voit un exemplaire d’un catalogue de l’époque où sont mis en valeur des produits électroménagers de toutes sortes. On imagine comme l’aménagement de sa nouvelle maison a pu l’impressionner. Rosa, quant à elle, évoque l’abondance de nourriture et dit que « c’est vrai, c’est vrai [...] en Italie il n’y avait pas une telle abondance ». On ressent qu’une possibilité d’idéalisation et donc d’espoir fut donné à la plupart des femmes à leur arrivée.
De plus, le mariage amenait une véritable perspective dans leur vie. La cérémonie leur permettait une reconnaissance dans la société et cela représentait aussi des responsabilités. Le mariage pouvait donc constituer une étape de leur reconnaissance dans ce nouveau pays. Leur avenir perdait peut-être un peu de son caractère nébuleux. Bien sûr, ce ne fut pas le cas pour toutes les femmes car Angela, par exemple, eut affaire, dès son arrivée, à un mari jaloux et sévère. Mais l’image positive du mariage concerne la grande majorité de ces femmes et la vocation du mariage restait inchangée quelle que soit la personnalité du conjoint puisque définie juridiquement.
La vie de famille : le rôle du conjoint et les souffrances endurées
Le conjoint a un rôle très important pour ces femmes. En effet, c’est pour le rejoindre que chaque femme a traversé l’Atlantique et il est le seul point de repère dans les premiers temps. Un des moments les plus forts qui illustre le lien quasi vital au sein de chaque couple, dès l’arrivée de la femme, est celui de leur première rencontre. Ainsi, Lina raconte que quand elle est descendue du train, son futur mari a couru vers elle, ils se sont serrés dans les bras et embrassés et que « c’était un vrai baiser d’amour ». L’amour semble ici être la source d’un profond étayage pour elle.
Comme nous l’avons déjà souligné, les femmes interviewées dans ce documentaire n’ont apparemment pas toutes eu des relations du même ordre avec leur époux respectif. Ainsi, Angela témoigne d’un mari qui était jaloux quand elle s’habillait bien, si elle parlait à quelqu’un et qui l’a finalement trompée. On remarque que sa vie conjugale ne fut guère un soutien pour elle. Elle nous transmet en plus que cela ne fait que quatre ans qu’elle peut vivre la vie qu’elle aurait voulu vivre, depuis le départ de son mari, peut-on comprendre grâce au contexte. Nous pouvons inférer que son mari amplifia profondément la souffrance de son immigration. Au contraire, Antonietta, qui est interviewée aux côtés de son mari, semble plutôt complice avec lui. Elle nous dit d’ailleurs qu’elle a « eu une vie heureuse ». De plus, il y a un passage de l’interview où l’on sent qu’un lien particulièrement fort unit ces deux époux. Lorsqu’Antonietta nous évoque sa séparation d’avec ses parents, la caméra se tourne vers son mari qui est aussi au bord des larmes et embarrassé comme s’il se sentait coupable d’avoir fait venir sa femme au Canada. Rosa témoigne aussi : « heureusement mon mari était bon avec moi, j’ai eu des enfants ».
Ces enfants, les femmes n’en parlent pas vraiment. Ils sont évoqués quand elles parlent de leurs dépenses ménagères de l’époque, mais on n’en apprend globalement pas plus. Quand bien même ces femmes continuent à voir leurs enfants adultes fréquemment, ils ne partagent pas la même expérience de vie que leur mère. Elles ne rencontrent donc peut-être pas l’opportunité ou la facilité de partager des émotions liées à leur statut d’immigrée avec eux.
La vie professionnelle : un engrenage « anti-identité »
Dans le début de la deuxième partie de ce documentaire, plusieurs femmes assises autour d’une table sont interviewées. Elles ont été pour la plupart ouvrières dans l’industrie et nous font partager leur expérience. Nous bénéficions aussi de la présentation de plusieurs documents vidéo d’archives qui illustrent leurs propos. Elles évoquent quasiment toutes le fait qu’elles ont dû produire un revenu pour le foyer ou aider dans le restaurant familial. Ainsi, ces femmes durent travailler avant tout pour accroître les revenus de leur foyer. Comme le fait remarquer Lina, les enfants « ne pouvaient grandir sans aller à l’école, contrairement à leurs parents », ce qui supposait des moyens financiers.
Ce travail leur fut imposé et elles durent commencer le plus tôt possible après leur arrivée. Ainsi, Rosa témoigne qu’elle est arrivée le samedi et que le lundi elle travaillait déjà au restaurant. Pour les ouvrières, les conditions étaient, comme dans toute manufacture à l’époque, très difficiles : les femmes, comme on le voit sur les vidéos d’archive, étaient enserrées entre des tables de travail, elles devaient faire beaucoup d’heures chaque jour pour un salaire très bas et leurs supérieurs pouvaient facilement faire pression sur elles. Maria raconte qu’elle n’a jamais pris ses quinze minutes de pause parce qu’elle avait besoin des « dix nickels » qu’elle aurait perdus en faisant des pauses pendant la journée. On prend conscience de la précarité de sa situation. De plus, elle nous relate le harcèlement moral qu’opérait son supérieur qui lui reprochait de travailler trop vite. Ainsi même si elle voulait gagner plus, elle ne le pouvait autant qu’elle le désirait. On voit à quel point cette situation précaire allait jusqu’à l’absurdité la plus révoltante. Les conditions de travail étaient donc non seulement difficiles physiquement mais aussi moralement. Maria et les nombreuses femmes qui vivaient les mêmes expériences devaient endurer un surmenage physique et psychique la journée et le soir être obligées de s’occuper de leur foyer. Elles n’avaient pas de temps libre pour elles-mêmes. Elles tendaient à devenir des robots qui n’avaient plus la force de penser. Les conditions de travail qu’elles devaient affronter étaient une négation de leur identité.
Mais, un contre-exemple vient en la personne de Giuseppina. En effet, elle s’oppose catégoriquement à Maria en exprimant qu’elle prenait toujours ses dix minutes de pause et qu’il lui importait peu de gagner un dollar en moins car « c’était [s]a vie ». On prend conscience ici que certaines femmes, malgré l’environnement déplorable dans lequel elles devaient vivre, étaient capables d’imposer une part de leur identité au monde qui les entourait. Giuseppina sentait peut-être que ces journées toutes similaires composaient une grande partie de sa vie et qu’elle devait donc se battre pour garder un peu de prise sur cette situation. Mais, on peut douter que Maria et Giuseppina aient enduré exactement la même intensité de difficulté car on a vu qu’en plus de la force qu’elles eurent en elles-mêmes, beaucoup de facteurs contextuels pouvaient modifier totalement leur appréhension de la vie. On peut tout de même penser que la personnalité de chaque femme joua certainement beaucoup sur sa perception de sa vie. Maria prône par exemple le « sacrifice » à tel point qu’elle semble se nier elle-même.
La retraite : quand l’identité ressurgit malgré soi
Lorsqu’advient la retraite, les enfants grands et partis du foyer, les femmes ont une somme de tâches bien moins lourde à accomplir chaque jour. Leur mari, quand il vit encore, est généralement lui aussi à la retraite. Les conjoints se retrouvent alors face à des conditions de vie commune tout à fait différentes de celles des années antérieures. En général, ils sont amenés à être confrontés l’un à l’autre quasiment en permanence. Le stress conséquent à la pluralité de tâches à effectuer est réduit et les conversations peuvent portent sur des thèmes plus plaisants qu’avant. L’esprit étant moins sollicité, il peut vaquer selon le cours de sa réflexion naturelle. De plus, la fin de vie s’approchant la quête identitaire peut se faire plus intense. C’est ainsi que pour beaucoup de femmes, les réflexions à propos de leur immigration rejaillissent en masse.
Mais si pour certaines cela pourrait être la concrétisation d’un épanouissement personnel, pour les femmes de ce documentaire, cette identité qui refait surface est globalement désagréable.
Surgit tout d’abord le problème de la mémoire car leur identité ayant été bafouée pendant de nombreuses années leurs souvenirs ont été relégués à une zone très profonde de leur mémoire. Il est donc difficile pour beaucoup de femmes d’y accéder. Par exemple, Anietta dit se souvenir de son village natal seulement « comme dans un rêve ». Face à cette impossible re-mémorisation précise et véridique, les femmes peuvent ressentir une terrible angoisse. Elles prennent conscience qu’elles ne se connaissent plus beaucoup elles-mêmes et qu’étant loin de leurs proches, dans l’espace et dans le temps, personne ne pourra les aider à reconstruire cette identité qu’elles ont laissé échapper. Cela n’est pas démontré dans le documentaire mais au vu des phrases de certaines femmes, comme Anietta, on peut penser que ces femmes ont déjà éprouvé cette angoisse de manière plus ou moins intense lors de leur retraite.
De plus, ces femmes à qui beaucoup de choses ont été imposées d’une manière ou d’une autre, sont confrontées à la difficulté de faire face émotionnellement au bilan de leur vie. En effet, celle-ci fut pour beaucoup semée de souffrances, dont elles n’ont toujours pas guéri. Antonietta en témoigne lorsqu’elle nous dit : « et j’essaie de ne pas y penser mais j’y pense toujours ». Le ton de sa voix est alors très triste et l’on sent que c’est comme un fardeau pour elle, qu’elle aimerait presque pouvoir tout oublier.
Mais, dans ce documentaire, il y a une personne qui semble beaucoup moins souffrir de son identité face à la retraite : Giuseppina. En effet, elle sourit durant toute l’interview et elle n’évoque pas de points négatifs concernant sa vie, elle souligne même qu’elle n’a jamais eu de problèmes. Cela n’étant peut-être pas très réaliste, on peut imaginer qu’elle fut aidée par une vision optimiste de la vie. De plus, on la voit en train de tricoter, elle nous dit alors qu’elle tricote une couverture parce qu’à son âge les femmes en ont besoin. On peut interpréter cela comme une sorte d’épanouissement : Giuseppina réussit à profiter de l’instant présent, elle ne reste pas en permanence dans le passé, dans les regrets. De la même manière, elle ne prend pas vraiment part aux conversations protestataires de ces semblables. On observe aussi qu’elle parvient à construire des choses, à son âge, car même si ce n’est qu’un tricot, cela dénote un esprit créatif. On peut penser que c’est justement parce qu’elle n’a jamais gravement coupé le lien avec son identité et parce qu’elle a toujours réussi à exister dans le présent, en adéquation avec elle-même.
Lina est longuement interviewée dans ce documentaire. Nous étudions le passage où elle nous parle de son présent, en 2008. On voit Lina devant sa maison qui nous explique tout d’abord que, pour son mariage, c’est sous le porche devant lequel elle se trouve que les époux ont été pris en photos, avec la famille. Cela semble un souvenir plutôt positif dans sa mémoire. Mais elle nous indique ensuite que cela fait deux ans que son mari est mort et qu’elle se sent désormais « comme un arbre seul ». Le contraste entre les deux phrases est flagrant. Il nous montre tout d’abord à quel point les sentiments qu’elle ressent à présent sont différents de ceux qu’elle a pu éprouver quelques années plus tôt. Il nous révèle aussi à quel point une femme, qui fut un temps entourée par une famille, se retrouve seule et se sent perdue. Enfin, ces propos antithétiques introduisent la description que Lina va nous donner de sa vie présente. Il faut préciser que pour Lina la retraite n’est, semble-t-il, très dure à vivre que depuis que son mari est parti. En effet, elle évoque les expériences qu’ils eurent ensemble par des termes mélioratifs et l’on sent vraiment qu’elle souffre parce qu’elle n’a plus le soutien de celui-ci. Elle nous fournit alors une métaphore poignante de sa vie : « vous voyez, toutes les fleurs sont flétries » nous dit-elle en montrant son jardin, rappelant ainsi que les femmes qui immigrèrent durent aussi endurer les souffrances communes de la vie.
Toutes les femmes de ce documentaire eurent à faire face à plusieurs événements très semblables durant leur vie. Elles ont notamment toutes été contraintes, d’une manière ou d’une autre, au départ, elles ont effectué le même type de voyage et elles ont globalement dû endurer des conditions de vie précaires et un environnement de travail difficile. Mais, chacune vécut cela d’une manière singulière en raison de la variabilité, même infime, des conditions dans lesquelles ces évènements eurent lieu. Leur personnalité et leur histoire personnelle les amena aussi à percevoir et à garder en mémoire tout phénomène d’une façon unique. Au travers de ces témoignages, on retient tout de même l’extrême souffrance que ces femmes ont éprouvée tout au long de leur vie et qui, chez beaucoup d’entre elles, persiste intensément. Souffrances de la vie, aggravées sans doute par le déracinement de la migration. Leur vie de tous les jours est alors tourmentée par des sensations et des souvenirs qu’elles n’ont pu assimiler harmonieusement. Pour elles, le processus d’immigration ne sera peut-être jamais fini.
Néanmoins, si très peu de ces femmes ont accédé à un semblant d’épanouissement, certaines continuent cette quête, notamment en organisant un retour au pays. C’est dans un contact direct avec leur terre d’origine et avec leurs valeurs les plus profondes, celles qui leur ont été transmises pendant leur enfance, qu’elles espèrent retrouver une partie de leur identité égarée. On peut se demander si la culture canadienne, avec laquelle elles furent en contact pendant si longtemps, n’influencera pas considérablement la vision qu’elles se feront de leur pays et donc d’elles-mêmes. Une femme immigrée possède en fait une identité vraiment à part : n’est-elle pas entre deux terres sans véritablement n’appartenir à aucune d’elles ?
