Immigrés d’hier, Turinois d’aujourd’hui
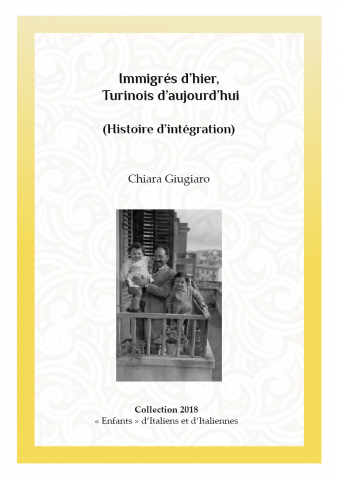
Je souhaitais raconter une histoire d’immigration très positive, qui puisse faire comprendre que l’immigration n’apporte pas que des malheurs, comme certains dirigeants veulent nous le faire croire dernièrement. Pour cette raison, ma première pensée alla à mon grand-père, Turi, qui a tout quitté il y a cinquante-sept ans et a réussi à s’intégrer parfaitement. J’ai donc organisé un dîner avec lui lors d’un de mes retours à Turin. À cette occasion, ma mère, mon grand-père et mon grand-oncle étaient présents. Tous les trois avaient émigré en 1960, mais leur façon de s’intégrer était différente. Cela me donna l’envie de creuser un peu et je décidai d’interviewer aussi mon grand-oncle.
Catane déménage
Turi avait trente-cinq ans quand il décida de quitter Catane. Cet homme, père de trois enfants, Angelo, Nunzio et Nunzia, savait que son déménagement améliorerait les conditions de vie de sa famille. Pour cette raison, il partit confiant avec l’optimisme qu’il montre sans cesse depuis quatre-vingt-treize ans, ce qui lui a permis de surmonter les nombreuses difficultés de la vie avec le sourire et sans jamais regretter le passé.
Avant même de terminer l’école primaire, Turi avait déjà commencé à travailler en tant que cordonnier pour aider sa famille. À l’époque, malgré la loi qui déjà interdisait l’exploitation des enfants de moins de douze ans, cette pratique était assez courante et les garçons étaient envoyés au travail dès leur plus jeune âge. Il commença donc chez un cordonnier de Catane qui le garda de nombreuses années, jusqu’à ce que, après la fin de la guerre, il décide d’ouvrir une boutique de chaussures et propose à Turi de continuer en tant que vendeur. À contrecœur, il dut accepter ce changement pour garantir la sécurité financière de sa famille. En effet, Turi avait connu sa femme, Maria, en 1947 ; ce fut un véritable coup de cœur. Au bout de deux ans, comme le voulait la tradition, ils se marièrent, donnèrent naissance l’année suivante à leur premier garçon, Angelo. Ils auront deux autres enfants, Nunzio en 1953 et Nunzia, appelée ainsi car elle est née le jour de l’Annonciation, en 1957.
La nécessité de quitter la Sicile s’imposa lors d’un énième refus de son patron de lui accorder une augmentation. À l’époque il gagnait 12 000 lires par semaine, en comptant les nombreuses heures supplémentaires qu’il faisait. Cela suffisait à peine à nourrir sa famille. Quand son beau-frère, qui avait depuis peu déménagé à Turin, lui parla des nombreuses opportunités de travail que cette ville proposait, Turi décida sur-le-champ que le temps était venu de partir.
C’était le 20 novembre 1960. Turi salua sa famille, qui le rejoindrait une semaine plus tard, juste le temps de s’installer, et il prit le train pour un voyage de 24 heures, direction Turin.
Turi arriva un dimanche à Porta Nuova, la gare centrale de Turin. Il retrouva ses deux beaux-frères, Francesco et Cosimo, et ils allèrent dans un bar proche de Via Giulio, où ils habitaient et où Turi et sa famille allaient habiter jusqu’en 1971. Pendant qu’ils dégustaient un bon café en famille, un homme entra dans le bar et commença à parler avec le propriétaire, en disant qu’il avait urgemment besoin d’un cordonnier pour l’aider dans sa boutique. C’est ainsi que, quelques heures à peine après son arrivée en ville, Turi trouva un emploi. « C’était une autre époque, me dit-il, mais c’est vrai que j’ai eu de la chance : en quelques heures j’ai trouvé une offre pour le travail que j’aimais faire. »
Une semaine après, Maria et ses trois enfants le rejoignirent. Ils ont habité pendant onze ans au 29 via Giulio, dans un petit studio mansardé ; les toilettes étaient sur le balcon. Malgré la présence dans de nombreux appartements du panneau « On ne loue pas aux méridionaux », ils purent trouver cette location avec l’aide de la mère de Maria, qui depuis quelque temps habitait avec ses deux fils dans cette même rue et qui se porta garante auprès du propriétaire. La première année ils vécurent dans ce petit studio avec seulement un drap qui séparait la zone jour de la zone nuit. Au début de la deuxième année, l’appartement deux-pièces à côté se libéra et le propriétaire installa une porte pour relier les deux pièces et donner un peu plus de place à la famille de Turi.
La vie n’a pas toujours souri à Turi et à sa famille : malgré leurs attitudes positives, ils ont souvent été confrontés à des situations difficiles. En effet, quelques mois après leur arrivée à Turin, Maria tomba malade. Elle était affectée d’une grave forme de diabète qui la rendit inapte au travail. Très rapidement, elle ne fut plus indépendante. Cet événement eut de grosses répercussions sur toute la famille. Turi dut trouver de nombreux petits emplois pour maintenir la famille, pour déblayer la neige ou faire des livraisons à domicile, et Nunzia, qui n’était encore qu’une enfant, gérait déjà la maison. Ce fut en partie pour cette raison qu’en 1971 ils déménagèrent à Leini, une petite ville à une demi-heure de Turin, dans laquelle des cousins éloignés de la belle-mère de Turi avaient construit une maison. Cosimo, le beau-frère de Turi, n’a pas vécu gaiement ce départ.
Le jeune Cosimo avait suivi un cursus de professionnalisation agricole et avait commencé à travailler à l’âge de quatorze ans en tant que forgeron. Àdix-sept ans, il fut contraint de quitter Catane et de rejoindre sa mère et son frère à Turin. Il partit le 20 octobre 1960. Quand il quitta Catane, le soleil resplendissait dans le ciel bleu et, à son arrivée à Porta Nuova, il fut plongé dans une de ces journées grises pluvieuses typiques de Turin qui lui fit immédiatement regretter d’avoir accepté de déménager dans le froid. Il alla vivre avec sa mère via Giulio et, au bout d’une semaine, il trouva un emploi en tant que forgeron juste en bas de chez eux. Il y travailla quelques mois, puis alterna les emplois, soudeur, livreur, jusqu’au moment où il fut embauché chez Fiat en tant que métallurgiste, jusqu’à l’âge de la retraite.
Cosimo garda de forts liens avec la famille restée à Catane. Il y a quelques années encore, il descendait chaque été pendant trois mois, pour lui, les meilleurs de l’année. Quand Nunzia, sa nièce, le conduisait à l’aéroport, c’était toujours une lutte pour faire entrer dans la voiture les énormes valises contenant des cadeaux pour tous les cousins et les cousines qui habitaient encore à Catane. Ces mêmes personnes lui donnaient des cadeaux de toutes sortes et des spécialités à rapporter à toutes ses connaissances dans le Nord qui, « les pauvres, ne connaissent pas les délices de la Sicile ».
En 1985, deux événements marquèrent la famille entière. L’état de santé de Maria, aveugle depuis plusieurs années, se dégrada et elle s’éteignit en avril, à l’âge de cinquante-cinq ans. Sa mère, âgée de soixante-neuf ans, se rompit le col du fémur quelques mois après etfut opérée, malgré une mauvaise tension : elle perdit la vie au cours de l’opération. Ces épisodes tragiques ne démoralisèrent pas la famille. Turi se remaria en juin 1991 avec une gentille dame d’origine piémontaise, Anna, elle aussi veuve et mère de quatre enfants. Cette femme qui adorait le crochet et son gros chat persan blanc, Rolli, ne parlait qu’en dialecte piémontais. Malgré cela, elle se fit tout de suite aimer par tous, y compris par la famille restée à Catane. Anna et sa petite-fille (qui vécut avec eux depuis l’âge de dix ans), furent la raison de vivre de Turi pendant de nombreuses années.
Turi a toujours eu cette capacité à se faire aimer par tout le monde. Volontaire, souriant, travailleur et toujours prêt à aider. Il adore cuisiner et pendant des années, il a été le cuisinier des colonies de vacances de la paroisse de son village, pour la joie des enfants qui ont pu déguster les délices rigoureusement siciliens qu’il préparait.
Cette joie et cette gentillesse l’ont aidé à plusieurs reprises. Nunzia fréquentait une école catholique à Turin. Plusieurs fois les bonnes sœurs, qui s’étaient vite attachées à elle, avaient donné des sacs de courses pour aider cette famille en difficulté. Il y a huit ans, cela lui sauva même la vie : alors qu’il était à l’église, il eut une attaque cardiaque qui aurait pu lui coûter la vie si les gens présents ne lui avait pas immédiatement porté secours en le conduisant eux-mêmes à l’hôpital.
Anna s’éteignit en 2016 et Turi se retrouva à nouveau veuf, mais même cette dernière épreuve ne l’a pas démoralisé. Aujourd’hui, il a quatre-vingt-treize ans et il garde sa joie de vivre et son indépendance. Tous les jours, il se lève à cinq heures du matin, prend son petit-déjeuner et part dans sa petite voiture direction le marché où il achète fruits et légumes à l’étal de son copain sicilien. Tous les lundis, Nunzia, son mari Diego et Cosimo partent de Turin pour aller dîner chez Turi. Un bon dîner en famille et une partie à « Tivitti » (je t’ai vu en dialecte sicilien), un jeu de cartes sicilien : quoi de mieux pour se souvenir du bon vieux temps, sans jamais oublier que l’important est de vivre pleinement son présent.
L’étudiant en recherche d’une meilleure éducation
Ces deux témoignages ouvrirent la voie à une envie de connaissance encore plus grande. Turin a été pendant de nombreuses années une ville d’immigration ; cela me donnait la possibilité d’avoir plus de témoignages qui me feraient mieux comprendre le parcours d’intégration de l’époque. Je demandai donc à ma mère de m’indiquer qui, parmi ses connaissances, avait quitté la Sicile autour des années 1960. Mon choix tomba sur Salvatore, un étudiant catapulté à Turin où il fait si froid.
Salvatore, à la différence de Turi et Cosimo, vient d’une famille d’universitaires et les raisons de son déménagement sont davantage dictées par une envie d’excellence que par un besoin primaire.
Salvatore est l’aîné de trois frères et sœurs ; il est le fils d’un géomètre, diplômé en économie, et de commerce, et d’une professeure de lettres. Il a passé son enfance et son adolescence à Caltanissetta, une ville du centre de la Sicile. Naturellement doué depuis son plus jeune âge, il saute une classe à l’école primaire, selon la décision de ses parents, décision en partie regrettée par Salvatore, qui se trouva à devoir redoubler d’efforts pour réussir ses études. À l’âge de treize ans, fasciné par la logique des mathématiques, il choisit la filière scientifique ; c’était un choix encore rare pour l’époque, car les étudiants privilégiaient le lycée classique (une filière littéraire avec enseignement obligatoire du grec et du latin).
Après le lycée, le choix de l’université s’imposa. Le profil de Salvatore semblait parfait pour intégrer l’École polytechnique de Turin, qui était, et est toujours, une des plus renommées. Durant l’été 1966, il partit avec cinq camarades de sa promo du lycée direction l’Espagne ; leur projet était de profiter des avantages que le père de Salvatore avait en tant qu’employé de Trenitalia : remonter toute l’Italie jusqu’à Turin, s’arrêter quelques jours dans une auberge de jeunesse, juste le temps de se renseigner sur les modalités d’inscription, et aussitôt repartir en direction de l’Espagne pour un voyage on the road sous le signe de la bonne humeur.
Le vrai déménagement eut lieu en novembre 1966. L’arrivée de Salvatore fut décidément moins joyeuse qu’à l’été. Quand il descendit du train, il fut accueilli par un brouillard épais qui l’empêchait même de voir les noms des rues grises et carrées de cette triste ville. Il avait trouvé une chambre chez la tante d’un de ses camarades, laquelle louait régulièrement ses chambres libres aux étudiants. Dans la maison, il n’y avait qu’un réchaud à alcool, qui suffisait juste pour se faire du café ou une assiette de pâtes. Salvatore et ses copains allaient donc souvent manger dans des petits restaurants conventionnés avec la faculté, ce qui leur a permis de connaître la cuisine locale, et d’autres cuisines aussi.
Aux vacances scolaires, Salvatore rendait visite à sa famille qui avait déménagé à Palerme en 1970. Il garde un très mauvais souvenir de ces voyages interminables, où il fallait porter d’énormes bagages et courir pour trouver une place assise. Certains dormaient même dans les toilettes. Il me raconta que plusieurs fois il avait passé l’intégralité du voyage dans le couloir, dans le froid.
Salvatore avait choisi le parcours d’ingénieur électronique. Même si à l’époque il n’y avait pas encore d’examen d’entrée, la sélection au cours de l’année était sans pitié. Les professeurs sautaient sur la première occasion pour décourager les étudiants les plus faibles. Terminer son cursus dans les temps était très compliqué. C’est un peu à cause de cela, mais aussi à cause des luttes dans lesquelles il s’était engagé, que Salvatore prit beaucoup de temps pour finir ses études et n’obtint son diplôme qu’en 1973.
L’école polytechnique, renommée dans le monde entier, était fréquentée par des jeunes provenant des quatre coins du monde : les discriminations étaient rares. Malheureusement, le frère de Salvatore, Sergio, ne connut pas le même sort. Il avait déménagé à Turin en 1967 pour fréquenter la faculté de médecine. Là-bas, il reçut un accueil tellement marqué par le racisme qu’il abandonna ses études sans même terminer la première année. Il retourna en Sicile et recommença la faculté à Palerme, où il termina brillamment ses études de psychiatrie.
En plus des fréquentations liées à ses études et à la maison où il vivait, Salvatore fit de nombreuses connaissances grâce aux mouvements de grèves qui, en cette période, naissaient un peu partout dans la ville. En juin 1967, la guerre des Six jours d’Israël avait enflammé les esprits des jeunes étudiants qui décidèrent de bloquer la faculté de physique et de mathématiques. Suite à cette première occupation, beaucoup d’entre eux avaient été fichés par la police, mais sans réelles répercussions. Cela avait renforcé le mouvement qui continua avec des actions de sit-in tout au long de l’année, pour enfin exploser en 1968. Au début des années 1970, Salvatore commença à fréquenter un groupe de discussion qui se tenait chez un camarade de nom Schiavazzi. Ils pouvaient discuter pendant des heures et de tous types de sujets. La seule règle : parler en dialecte piémontais. Ce fut ainsi que Salvatore apprit le dialecte du lieu.
En 1968, un ami de Salvatore le fit dans une chorale, dont il fait toujours partie. C’est là qu’il eut la chance de rencontrer Rosina. Il commença à fréquenter cette gentille fille piémontaise deux ans après et, malgré les premiers doutes de la famille de la jeune fille, il se fit bien aimer assez rapidement. Aujourd’hui, il se décrit comme le « chouchou de sa belle-mère ». Ils se marièrent en février 1976 et eurent un enfant.
En 1973, juste après l’obtention de son diplôme, il fut appelé pour le service militaire, qu’il avait pu repousser jusque-là grâce à ses études. Toujours déclaré résident à Caltanissetta, il dut rentrer à Palerme pour quarante jours d’entraînement. Son service dura treize mois au total, pendant lesquels il fut appelé pour contrôler les votes lors du referendum sur le divorce. Il fut muté ensuite au contrôle de la prison militaire de Peschiera del Garda. Il fut isolé sur cette petite île, car il était fiché en tant que militant activiste : on voulait éviter que ne se propagent les grèves menées par Lotta Continua.
Après le service militaire, Salvatore décida de rentrer à Turin pour rejoindre Rosina. En 1976, il passa le concours pour devenir professeur d’électronique et commença à enseigner dans des lycées professionnels, où il travailla avec passion jusqu’en 2009, année de sa retraite.
Salvatore est aujourd’hui très content d’avoir émigré à Turin : cette ville est vite devenue sa maison et il ne regrette rien de son parcours.
Avant de nous quitter, il me transmit une dernière réflexion à propos de l’immigration d’aujourd’hui. Contrairement à Turi et à Cosimo qui ont de l’immigration actuelle la vision que transmet la télévision et qui ont presque l’impression qu’il y a plus d’immigrés que d’Italiens sur le sol italien, Salvatore, grâce à ses fréquentations et à son engagement social, a un vrai contact avec les immigrés d’aujourd’hui. Selon lui, la solution à toutes ces tensions sociales serait de se fréquenter davantage d’un milieu à l’autre. Il conclut en me disant : « C’est exactement comme entre vieux et jeunes : dans un cas, on a une confrontation des générations, dans l’autre, on a une confrontation des cultures. On ne peut pas se comprendre si on ne se connaît pas. Donc il faut arrêter ces divisions et commencer à chercher une façon de vivre ensemble dans le partage. »
L’arabe à l’italienne
Après avoir parlé avec mes trois témoins, j’avais encore beaucoup de questions et ma curiosité envers l’immigration n’était pas épuisée. J’ai lors demandé à ma mère de faire à nouveau marcher ses contacts pour pouvoir interviewer un autre immigré d’hier. Cette fois-ci j’avais envie de connaître quelqu’un qui ne venait pas d’Italie et ma mère avait déjà trouvé la bonne personne.
Abdessamad est connu par la plupart des Turinois sous le nom d’Abdul à cause de l’assimilation qu’un grand nombre d’Italiens a faite entre la nationalité marocaine et ce prénom. Nous l’appellerons Abde. Lorsqu’il n’était qu’un jeune étudiant, Abde a décidé d’aller étudier en France, pays pour lequel il avait obtenu son visa sans problème. Un ami de sa famille devait partir pour Bergame et lui a proposé de faire le voyage avec lui.
C’était le début de l’été 1989. Les deux voyageurs partirent de Casablanca dans une Renault 5, direction Tanger, Gibraltar puis tout droit vers l’Italie. Abde me raconta le sourire aux lèvres, mais sans cacher une petite déception, que les passages des différentes frontières n’avaient pas été évidents. Il fut profondément marqué par la méfiance et l’agressivité montrée par les douaniers, malgré tous leurs papiers en règle. Cette méfiance avait été accentuée par la passion pour la bière de son conducteur, passion qu’il essayait de cacher avec une énorme quantité de parfum. Lors du passage des Pyrénées, les policiers, soupçonnait à cause de la forte odeur, avaient démonté la voiture à la recherche de drogue en leur faisant perdre une bonne partie de la journée. La France en général ne lui fit pas très bonne impression. C’est en effet là qu’Abde se fit arnaquer pour la première fois, qui plus est, dans une pharmacie, alors qu’il cherchait des médicaments pour se soigner. Malgré tout, le voyage fut assez paisible et ils réussirent à éviter les problèmes à presque toutes les frontières en laissant des « cadeaux » aux douaniers, surtout des paquets de cigarettes et parfois même de l’argent.
Quand ils arrivèrent en Italie, Abde se fit déposer à Turin, où son frère l’attendait. Il aima tout de suite l’Italie et ses habitants et l’idée de partir étudier en France lui semblait de plus en plus lointaine. Mais ce qu’il lui fit changer définitivement d’idée fut la rencontre avec un Français d’environ soixante-dix ans, qui avait fait la guerre d’Algérie et qui lui conseilla de rester en Italie puisque la France était sur une mauvaise pente. À raison ou pas, cela suffit à le convaincre de rester et Abde, malgré les difficultés rencontrées, n’a jamais regretté cette décision.
Sa première aventure fut d’apprendre l’italien, car il souhaitait commencer des études en agronomie. À l’époque, il y avait un programme qui prévoyait un montant de cent cinquante heures de formation que le syndicat des métallurgistes avait obtenu en 1973, dans le cadre du droit aux études. Ce programme, qui durait un an, lui permit de se faire connaissance avec des gens de toutes les nationalités et lui donna envie de travailler dans le domaine social. La mixité sociale a toujours été importante pour Abde et le racisme dont il a pu être victime, heureusement seulement en paroles, n’a jamais freiné son envie d’intégration. Pour cette raison, l’année suivante, il devint bénévole en tant que médiateur pédagogique dans l’école où il avait appris l’italien. En 1998, il passa le concours pour devenir médiateur au sein de la mairie et entra dans le Comité d’urgence contre le racisme de Turin, qui s’appelle aujourd’hui Comité d’élimination de la discrimination raciale.
Abde fait partie des chanceux qui, ayant mis le pied sur le sol italien avant le 30 décembre 1989, ont pu bénéficier de la loi Martelli de 1990. Cette loi réglementa l’immigration, définit le statut de réfugié et introduisit la programmation des flux depuis l’étranger, c’est-à-dire le système des visas. Grâce à cette loi, Abde, comme 260 000-270 000 autres personnes, a été régularisé. Malheureusement, cela ouvrit aussi ce qui est tristement connu comme le « business de l’immigration », qui, dans sa forme de l’époque, consistait à donner des faux documents qui certifiaient l’arrivée des immigrés avant le 30 décembre 1989.
Abde fut incroyablement chanceux, car grâce à cette loi, en 2005, dix ans après son bref retour en Maroc et la rencontre avec celle qui est aujourd’hui sa femme, il put bénéficier de son droit de demande de nationalité. Il attendit trois ans avant d’avoir une réponse, trois ans d’angoisse, dans lesquels on ne sait pas si on sera recalé ou accepté. Cette angoisse en moyenne dure trois ans, mais pour certains elle peut durer beaucoup plus, comme c’était le cas pour le frère d’Abde qui attendit sept ans avant d’avoir une réponse. Cette angoisse est autorisée depuis 1998 par la loi italienne qui ne prévoit pas de limite de temps pour donner des papiers aux étrangers. Ces papiers peuvent leur être refusés sans motivations. Cette longue attente est parfois une cause de drames dans la vie des demandeurs : quand le permis de séjour arrive à échéance, ils décident parfois de ne pas le renouveler, convaincus de recevoir leur nationalité italienne dans un bref délai. Malheureusement, quand cela ne se réalise pas, il est désormais trop tard et les personnes en question se retrouvent en situation irrégulière, après des nombreuses années de résidence régulière sur le sol italien, et risquent l’expulsion.
Les enfants d’Abde ont aussi de la chance car, grâce à la nationalité acquise par leur père et grâce au droit du sang, ils sont considérés enfants de deux Italiens et n’ont pas été assujettis à cette loi. En effet, même quand ils sont nés sur le sol italien, la loi en vigueur impose le permis de séjour aux enfants d’immigrés. En outre, cette deuxième génération qui se sent plus italienne qu’autre chose, est obligée, lors du dix-huitième anniversaire, de demander la nationalité italienne avant dix-neuf ans, sous peine de perdre leur droit de demande.
Une autre raison pour laquelle Abde et sa famille ont été très chanceux, c’est qu’en Italie deux autres lois sur l’immigration sont passées. La première, la loi Turco-Napolitano en 1998, non seulement introduit une réglementation très dure sur la demande de nationalité, mais établit aussi la triste existence des Centres de Permanence Temporelle (CPT), aujourd’hui appelés Centres d’Identification et d’Expulsion (CIE), dans lesquels tous les étrangers menacés d’expulsion sont détenus avant d’être accompagnés d’une façon coercitive à la frontière. Ce n’est sûrement pas un hasard si ces centres ont été définis par plusieurs experts de l’immigration comme des vrais « camps de concentration ».
La deuxième loi, la loi Bossi-Fini de 2002, ne fit pas d’énormes changements par rapport à la précédente ; elle précisa les conditions d’expulsion avec accompagnement à la frontière, imposa la nécessité de travail effectif pour l’acquisition du permis de séjour, aggrava les peines des trafiquants d’hommes, réglementa l’utilisation des embarcations de la marine nationale pour lutter contre le trafic des clandestins.
Aujourd’hui cela fait trente ans qu’Abde a immigré en Italie et il est devenu depuis longtemps un Turinois, il a même pris l’accent de la région. Il ne regrette rien. Au contraire, il est heureux d’avoir réussi son histoire d’intégration et de l’avoir transmis à sa famille, car, oui, sa famille est 100% italienne sur les papiers, mais en réalité, il est le fruit d’une belle mixité ethnique. En effet, il est musulman pratiquant et sa femme catholique. À la naissance des enfants, ils ont décidé de ne pas leur imposer de religion : ceux-ci grandissent dans ce mélange. Même en cuisine, c’est la mixité qui se pratique, me raconte Abde. Il définit sa façon de cuisiner « arabe à l’italienne ou italienne à l’arabe ». Quand il était jeune, il avait un peu travaillé avec son frère, qui est cuisinier et qui lui a transmis la passion pour la cuisine. Aujourd’hui, il vante son fameux « couscous au pesto », que j’ai hâte de goûter !
Les histoires de ces quatre témoins ne suffisent sûrement pas pour décrire de façon exhaustive le phénomène de l’immigration en Italie, mais elles m’ont donné la possibilité d’amplifier mes connaissances et offrent la preuve tangible que l’immigration peut vraiment avoir une fin heureuse.
Chiara Giugiaro, 2018
