La physionomie italienne du Var
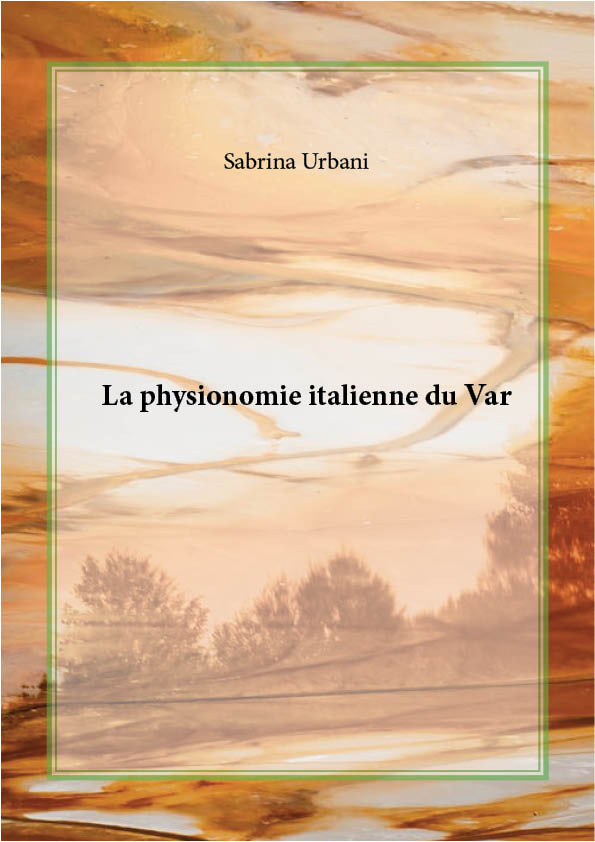
La France et les royaumes italiens entretiennent depuis le Moyen-âge des liens qui ont perduré au fil des siècles. Les flux migratoires se sont intensifiés après la formation de l’unité italienne. De 1861 à nos jours, 29 millions d’Italiens ont quitté leur pays et le nombre de retours est estimé à 11 millions. Au cours de cette période, la France a été une de leurs destinations privilégiées[1].
Le Var est un des départements français à avoir accueilli le plus d’Italiens. L’immigration italienne fait donc partie intégrante de l’histoire de ce département qui comptait 26 000 Italiens en 1901[2]. Jusqu’en 1914, ceux-ci représentaient plus de 90% du total des étrangers[3]. Ce pourcentage décroît de manière progressive après la première guerre mondiale, mais il est encore de 65% en 1946. Souvent considérés endurants et travailleurs, les Italiens ont joué un rôle de premier plan dans les activités du Var où « rien ne peut s’expliquer sans l’apport italien[4] » et ont notamment apporté une contribution indispensable au développement économique de Toulon et de La Seyne-sur-Mer[5]. Une enquête réalisée fin 1986 par un enseignant d’italien, trois enseignants d’histoire-géographie et une documentaliste bibliothécaire du lycée du Golfe à Gassin (Var) montre que, dans ce département, 20% des noms de famille sont d’origine italienne[6]. Une présence si nombreuse et si durable n’a pu que laisser des traces. En m’appuyant sur des documents d’archives ainsi que sur des témoignages, j’entends montrer que, malgré les nombreux obstacles qui se sont dressés sur leur chemin, les Italiens sont parvenus à s’intégrer complètement au paysage varois. Le phénomène d’acculturation généré par l’ampleur de cette présence a modifié au fil des générations la physionomie de ce département.
L’immigration, source de grandes souffrances
Bien que les immigrés italiens aient chacun des parcours et des souffrances qui leur sont propres, il existe des similitudes dans leur vécu. Il s’agissait en effet de fuir la misère, la dictature ou bien de rejoindre des membres de la famille ayant émigré auparavant. Le déracinement et le déchirement ont provoqué de grandes souffrances auxquelles ils ont dû faire face du mieux qu’ils ont pu. Le racisme et la xénophobie auxquels les immigrés italiens étaient quotidiennement confrontés ne se manifestaient pas systématiquement par des actes violents. En effet, il pouvait également s’agir de brimades et de réflexions dont l’objectif était toujours de blesser l’amour-propre de ces individus complètement déracinés et désemparés. Parmi les réflexions qui pouvaient paraître insignifiantes mais qui n’étaient pas moins blessantes, on trouve par exemple le fait de considérer qu’il était inutile pour les enfants d’immigrés d’aller à l’école car ceux-ci étaient destinés aux emplois les moins qualifiés, il leur suffisait ainsi de faire des ménages ou bien d’être maçon[7]. Certains témoignages mettent en avant les marques de bienveillance témoignées par les Français et ont tendance à occulter le racisme et la xénophobie. Peut-être est-ce parce que les difficultés rencontrées en France paraissent dérisoires à ces immigrés en comparaison de celles affrontées en Italie ou bien par reconnaissance envers le pays qui les a accueillis.
Des témoignages publiés dans Racines italiennes[8] montrent dans quelle mesure l’aide d’autres immigrés italiens pouvait faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. Ce fut le cas par exemple pour l’arrière-grand-père d’Emmanuelle Magliano[9]. Alors qu’il n’a que dix-neuf ans, Bartolomeo décide de partir en France pour chercher un travail et envoyer ainsi de l’argent à sa famille. Accompagné de trois de ses frères et de cousins, il arrive en 1894 à La Seyne-sur-Mer, où il est employé dans les chantiers navals. L’importance de la présence italienne et l’entraide qui régnait au sein de cette communauté ont permis à Bartolomeo de s’acclimater très rapidement à sa nouvelle vie. Il retourne en Italie pour effectuer son service militaire et épouse Santina Colombo. Le couple émigre en France en 1906 et s’installe à La Seyne-sur-Mer dans un petit appartement. Bartolomeo et Santina ont la chance d’avoir pour voisins des Italiens grâce auxquels ils vont apprendre le français. Ils retournent en Italie en 1911 car Bartolomeo se languit cruellement de son pays natal. De retour en France en 1923, ils s’installent à Hyères après y avoir acheté un terrain et une maison. Ainsi Bartolomeo peut vivre du travail de la terre et Santina devient une couturière réputée. Magno et Maria Berardengo, qui s’installent à Hyères dans les années 1920, ont également eu la chance de retrouver des amis qui leur ont permis de s’intégrer en leur enseignant le français et en leur servant de guide dans la région[10]. Le soutien moral et l’aide d’autres Italiens constituaient pour les immigrés un atout précieux qui facilitait leur intégration et leur permettait de mieux faire face à l’hostilité environnante.
L’hostilité à l’égard des Italiens était d’une intensité variable selon les époques.
Au XIXe siècle, les Italiens arrivèrent en masse et occupèrent les emplois dénigrés par les Français[11]. Or, la situation économique difficile de la France entre 1873 et 1896 conduisit les Français à se tourner vers les emplois peu qualifiés refusés auparavant et ils se trouvèrent alors confrontés à une masse d’Italiens très appréciés par les patrons pour leur expérience et leur efficacité[12]. Les Français se sentaient donc envahis et spoliés de leurs emplois. Par ailleurs, l’appartenance de l’Italie à la Triplice depuis 1882 attisait cette hostilité à l’encontre des Italiens[13]. À la veille de la Première Guerre mondiale, le racisme continuait de sévir. La presse française représentait l’Italien comme un « voyou » ou un « anarchiste » armé d’un couteau ou d’un poignard[14]. À côté de cette description, il en existe néanmoins une autre moins souvent mise en avant : celle du travailleur sous-payé et peu contestataire à qui les syndicats reprochaient de briser les grèves et les salaires[15]. Entre 1919 et 1925, les campagnes de presse contre les immigrés se multiplièrent car la création des Faisceaux et l’organisation des vacances d’enfants italiens en France faisaient craindre à de nombreux Français une sorte de colonisation italienne.
La crise économique de la fin des années 1920 et les événements politiques qui suivirent amplifièrent l’hostilité à l’égard des immigrés. Dans l’entre-deux guerres, ils étaient soumis à la surveillance drastique des autorités italiennes et françaises[16] et vivaient dans la peur d’être découverts par la police politique de Mussolini[17]. Le consul d’Italie devait surveiller tous les immigrés du département et transmettre les informations recueillies[18]. Quant aux autorités françaises, elles surveillaient de près leurs actions politiques. Des enquêtes individuelles pouvaient déboucher sur des expulsions. Toutes les actions des antifascistes (réunions, conférences et déplacements) faisaient l’objet d’une surveillance accrue car leurs idées parfois révolutionnaires préoccupaient les autorités locales qui en informaient les ministères. La surveillance française était toutefois moins draconienne que celle italienne dans la mesure où elle était effectuée de manière préventive et non systématique dans le but d’éviter les perturbations de l’ordre public ainsi que les événements pouvant mettre en danger la population. Les naturalisations ainsi que les mesures destinées à limiter la main d’œuvre étrangère entraînèrent une diminution du nombre d’Italiens à partir de 1926[19]. En effet, la loi du 10 août 1927 facilita l’accès à la nationalité française et à partir de cette date le nombre de naturalisations augmenta considérablement. Avec la loi du 10 août 1932, le gouvernement français commença à appliquer des mesures réglementaires restrictives destinées à protéger les travailleurs français. L’autorisation spéciale du Ministère pour les étrangers présents en France fut donc rendue obligatoire. Pour conserver la main d’œuvre étrangère, les patrons encourageaient les travailleurs immigrés à devenir français. Quant aux autorités, elles n’hésitaient pas à utiliser menaces, intimidations et pressions pour pousser les Italiens à demander leur naturalisation.
L’approche de la guerre rendit l’intégration des étrangers encore plus difficile car la surveillance des autorités françaises entravait leur régularisation. La situation était d’autant plus complexe et difficile pour les réfugiés politiques. Même avec un comportement irréprochable, rester sur le sol français fut le résultat d’un parcours long et difficile. Ce fut le cas pour Pietro Teppa, Giuseppe Tebolla et Giovanni Viviano, qui auraient pu rester anonymes sans les documents conservés aux archives départementales[20] qui permettent de retracer une infime partie de leur parcours.
Né le 5 juin 1891, Pietro Teppa réside en France de 1928 à 1936 et habite à Avignon et à Bormes, avant de rejoindre de manière volontaire la Brigade internationale de Barcelone où il a le grade de Sergent du Parti politique antifasciste. Inconnu des services de police toulonnais, il affirme n’avoir jamais eu aucune condamnation ni en France ni en Italie. Au moment de son départ pour l’Espagne en novembre 1936, sa carte d’identité de travailleur industriel n’est plus en cours de validité. De retour en France suite à une blessure, il est présenté au service des expulsions. Désireux de s’installer définitivement en France et plus particulièrement à Toulon ou bien dans les environs de Draguignan, à l’exception de Grimault, Saint-Tropez et Hyères, et craignant de retourner en Italie à cause de son enrôlement dans les rangs politiques antifascistes espagnols, il promet d’arrêter la politique si l’autorisation de séjourner en France lui est accordée. Craignant qu’un jour il recommence ses activités politiques, le Commissaire ne lui accorde qu’un séjour d’un mois sans aucune possibilité de renouvellement et avec une assignation à résidence dans les environs de Draguignan à l’exception des villes stipulées par l’intéressé. Il réussit toutefois à obtenir des sursis successifs grâce à l’appui du maire de Mazaugues qui écrit plusieurs lettres en sa faveur. Au mois d’avril 1939, celui-ci fait état de la conduite exemplaire de Teppa et précise qu’il ne participe pas à la vie politique. Il évoque également ses qualités morales et suggère qu’il pourrait travailler dans le secteur du bois où la main d’œuvre fait défaut.
Giuseppe Tebolla travaille à Toulon de 1933 à 1937 et rejoint lui aussi l’armée républicaine espagnole. Identifié comme réfugié politique, il demande le droit d’asile le 18 octobre 1938. Bien qu’ayant travaillé de manière régulière, s’étant toujours bien comporté et n’ayant jamais manifesté aucune activité politique, sa présence dans un port de guerre est considérée comme dangereuse pour la nation et une assignation à résidence dans le centre de la France est préconisée. Cela n’étant pas réalisable, le Commissaire de police recommande de lui assigner un logement dans un village du Haut-Var et de le faire travailler dans le secteur agricole.
Quant à Giovanni Viviano, il arrive en France en décembre 1929 muni d’un passeport et s’installe à Toulon en 1935 où il est employé par un maître boulanger dans le quartier du Mourillon. Dans l’armée républicaine espagnole depuis le mois de janvier 1938, il doit en partir au mois de septembre de la même année suite au retrait des volontaires étrangers. Trois mois plus tard, il passe devant la Commission de contrôle international et retourne ensuite à Toulon où il résidait auparavant. Au début de 1939, il doit prendre contact avec le directeur de l’Office départemental de la main d’œuvre afin de régulariser sa situation. Les vingt-cinq francs par jour que lui verse le Comité d’aide franco-espagnol lui permettent de subvenir à ses besoins en attendant la régularisation de sa situation. Il n’est pas connu des services de police car durant son séjour à Toulon sa conduite et sa moralité n’ont jamais été mises en doute. Cependant, tout comme pour les deux individus précédents, son pays d’origine ainsi que ses prises de positions politiques sont génératrices d’inquiétudes. Le Préfet du Var demande donc au directeur de la police de soumettre cet étranger à une surveillance très attentive et de l’informer de ses déplacements. En août 1939, Giovanni Viviano écrit au Préfet du Var pour demander le renouvellement de son séjour en France. Un rapport d’enquête favorable lui permet de bénéficier d’un nouveau sursis en septembre 1939.
Les problèmes que certains immigrés rencontraient avec la justice rendaient encore plus difficile leur maintien sur le territoire français. Ce fut le cas pour Liberale Tonelli[21], né le 8 mars 1906, qui arrive en France en 1922 après avoir passé clandestinement la frontière à Vintimille. Il vient résider directement à Toulon où habite son père. Maçon dans plusieurs entreprises de la ville, il est connu des services de police pour être un anarchiste. Il est expulsé en 1931 suite à une condamnation à 30 francs d’amende par le tribunal correctionnel de Toulon pour un motif qui serait la détention d’une arme. Volontaire pour rejoindre l’armée républicaine espagnole, il rentre en France en juillet 1938. Les fréquentations de l’intéressé ainsi qu’un frère anarchiste expulsé quelques années auparavant amènent les autorités à maintenir l’arrêté d’expulsion. Liberale Tonelli est assigné à résidence dans la région toulonnaise et la possibilité de résider en France grâce à des sursis successifs lui est accordée. Au mois d’août 1938, il bénéficie d’un sursis de trois mois valable seulement pour Toulon et il est invité à contacter très urgemment les autorités consulaires de Hollande, d’Angleterre et d’Espagne pour obtenir le droit de se rendre dans un de ces pays. Ses démarches se soldent par un échec car tous ces pays refusent. Les documents d’archives que j’ai consultés ne permettent malheureusement pas de continuer plus loin son histoire.
Pour un autre immigré nommé Eugenio Zannier[22], la situation est un peu différente. Les documents trouvés à son sujet ne mentionnent aucun démêlé avec la justice mais ils stipulent en revanche que cet individu fréquente les milieux extrémistes. Né le 25 novembre 1903, il habite chez Monsieur Del Prari dans le quartier Lagoubran à Toulon. Il est célibataire et exerce le métier de maçon. Ancien combattant dans les Brigades internationales, ce réfugié politique ne peut pas rejoindre son pays d’origine. Le Commissaire de police considère que les fréquentations de cet individu rendent sa présence à Toulon préjudiciable à l’ordre public et justifient une assignation à résidence dans un village du Haut-Var. Un sursis est accordé par le Préfet du Var sous réserve d’une conduite irréprochable et d’une régularisation de sa situation.
Bien que n’ayant très certainement été que de passage, ces personnes ont néanmoins contribué à laisser une empreinte italienne dans le département du Var. En effet, la durabilité du phénomène de l’immigration politique ainsi que l’importance numérique des personnes concernées ont joué un rôle de premier plan dans le phénomène d’acculturation évoqué précédemment.
Les souffrances endurées par les immigrés italiens atteignirent leur paroxysme au moment du second conflit mondial. Les Français se sentaient trahis, c’est l’image du « poignard dans le dos[23] ». Dans l’ouvrage Le Var de 1914 à 1944[24], il est fait état de l’opinion des Français à l’égard des Italiens, décrits comme étant arrogants et prétentieux. Ils étaient beaucoup plus méprisés que les Allemands car les Français leur reprochaient d’avoir lâchement attaqué la France à un moment où elle était déjà à terre[25]. Le témoignage suivant illustre le profond ressentiment français : « On est occupé par les Italiens qui dévastent tout dans les jardins, ils sont bien pires que les Allemands et avec ça d’une arrogance il faut voir ça, tout le monde les déteste, à part évidemment leurs compatriotes et ici il y en a beaucoup[26] ». En dépit d’une certaine sympathie éprouvée par une partie de l’opinion pour ces immigrés en lutte contre le Régime de Mussolini, les Italiens étaient très souvent victimes d’un amalgame systématique avec les fascistes et leurs descendants nés en France ne furent en rien épargnés. Le témoignage « Sillio. Histoire d’un émigré[27] » montre de quelle manière un homme parfaitement innocent des faits dont il était accusé fut conduit en prison. Le fils de Sillio subissait également le racisme à l’école : au cours des alertes d’entraînement, il était privé du masque de protection contre les gaz. Au moment du second conflit mondial, les Italiens furent contraints de choisir leur camp. La crainte du comportement des Français à leur égard conduisit un grand nombre d’entre eux à retourner en Italie. Mais ils furent également nombreux à se battre aux côtés des Français[28] et à rejoindre les maquis du Var et des Alpes après la signature de l’armistice[29]. Certains ouvriers italiens prêtaient main forte aux Français pour saboter la production ennemie et détruisaient par exemple les voies ferrées, les centrales électriques ainsi que les dépôts allemands d’armes et de vivres. Dans les témoignages, on retrouve deux raisons récurrentes pour expliquer le choix du camp français par de nombreux Italiens : la lutte contre le fascisme mais également la volonté de défendre le pays qui les avait accueillis au moment où ils se sentaient abandonnés par le leur.
Dans les années qui suivirent la fin de la seconde guerre mondiale, le besoin de main d’œuvre de la France facilita la situation des Italiens[30] qui s’intégrèrent complètement et connurent une mobilité sociale ascendante. En dépit d’une intégration plus facile, on trouve cependant des témoignages qui font état d’un racisme toujours bien présent à l’encontre des Italiens. Le père de Mathilde Pascuttini en fait l’expérience lorsqu’il arrive en France en 1970 alors qu’il est âgé de dix-sept ans[31]. L’accès à un bar lui est un jour refusé car le patron refuse de servir « un rital », « un facho[32] ». Il épouse une Française et connaît des difficultés pour se faire accepter par sa belle-famille. Les souffrances liées à ses origines l’amène à juger inutile la transmission de sa langue maternelle à ses enfants.
Les épreuves et les souffrances ont laissé d’importantes séquelles qui ont contraint les immigrés italiens à porter un fardeau tout le restant de leur existence.
Le poids du passé
L’adaptation et l’installation ont nécessité courage et abnégation et n’ont été possibles qu’au prix de nombreux sacrifices. Chaque individu réagit d’une manière personnelle face à son douloureux passé, chaque comportement étant étroitement lié aux circonstances dans lesquelles le pays d’origine a été quitté ainsi qu’aux difficultés affrontées dans le pays d’accueil. La profonde reconnaissance que les immigrés éprouvent pour la patrie qui les a accueillis et qu’ils ont choisie ne va pas sans une certaine culpabilité liée à l’abandon de la terre de leurs ancêtres. Certains éprouvent un mélange de sentiments complexe toujours lié aux circonstances qui les ont amenés à prendre le chemin de l’exil. De nombreux Italiens ressentent le besoin de raconter leur vécu et leurs souffrances pour en quelque sorte les exorciser et se libérer ainsi du poids du passé. Il y en a toutefois qui cherchent à oublier complètement l’Italie et les souffrances que ce pays leur a infligées et qui vont même parfois jusqu’à un refus de la langue d’origine pour eux-mêmes et leurs enfants. C’est le cas de Giovanni Morini qui cherche à oublier complètement ses origines[33]. Il s’assure que ses enfants n’aient jamais la nationalité italienne et refuse de leur apprendre sa langue maternelle. Certaines personnes ont réussi à partager leurs souffrances suite à un événement décisif de leur existence. Pour le père de Lidia di Carlo, c’est la maladie qui déclenche le besoin, longtemps occulté, de partager son vécu avec sa descendance[34]. Par ailleurs, des personnes qui semblaient être parvenues à oublier complètement l’Italie et tout ce qui s’y rapportait se sont subitement mises à parler leur langue maternelle peu avant de s’éteindre.
La mémoire du passé se transmet, volontairement ou non, d’une génération à la suivante. Il s’agit parfois d’un legs tout juste perceptible et difficilement descriptible, mais qui n’en demeure pas moins bien présent. Chaque descendant d’immigré italien va utiliser cet héritage culturel d’une manière qui lui est propre.
Comment les descendants d’immigrés italiens continuent-ils de faire vivre leurs origines ?
Le sentiment d’appartenance lié aux origines ne se manifeste pas toujours de manière consciente et volontaire car chaque individu ne dispose pas de la même capacité ni de la même volonté d’introspection. Adrien Vezzoso souligne le fait que, même quand tout sentiment d’appartenance au pays des ancêtres semble avoir été perdu, la quintessence des origines demeure[35]. Cependant, pour que les sentiments et les émotions se manifestent, il est nécessaire d’être à leur écoute, de leur donner la possibilité et la permission de s’exprimer. Les ressentiments, la rancœur, freinent et faussent la manière dont l’héritage culturel se manifeste et la façon dont il est vécu.
Chaque descendant d’immigré italien continue donc de faire vivre ses origines d’une manière qui lui est propre. En effet, les origines italiennes se vivent de manière singulière et se manifestent souvent par une sensibilité exacerbée aux « rappels » de l’Italie qui génèrent chez les descendants d’immigrés une mosaïque d’émotions. Lidia Di Carlo[36], Christophe Mileschi[37], Mathilde Pascuttini[38] et Marie Magdeleine Dauthier[39] témoignent de l’incidence de leurs origines sur leur quotidien. Dans son témoignage, Corinne Battistoni-Van der Yeught explique la familiarité que lui inspirait la langue italienne à douze ans alors qu’elle n’était plus retournée en Italie depuis ses sept ans[40]. Elle s’était imprégnée dès son plus jeune âge de la « mélodie » de cette langue.
Le sentiment d’appartenance à la culture italienne naît bien souvent avec la disparition des grands-parents qui emportent avec eux une grande partie de l’histoire familiale. La nostalgie du pays des ascendants se mélange donc très souvent avec celle de l’époque où la famille était au complet. C’est alors que commence à naître un besoin parfois essentiel de faire un retour aux sources, de revisiter les lieux dans lesquels ont vécu les ascendants pour continuer de faire vivre leur mémoire. Ce besoin est exprimé dans de nombreux témoignages dont ceux d’Isabelle Felici[41], Martine Storti[42], Corinne Battistoni-Van der Yeught[43], Cindy Doneda[44] et Emmanuelle Sola[45]. De manière générale, tous les témoignages recueillis dans Racines italiennes et Enfants d’Italiens, quelle(s) langue(s) parlez-vous ? manifestent un grand besoin de reconstituer l’histoire des ascendants et par la même occasion de leur rendre hommage. Les descendants d’immigrés italiens n’ont pas le monopole de ce sentiment mais lorsque les racines se trouvent dans un pays étranger, il s’en trouve amplifié car à la nostalgie s’ajoute un réel besoin de connaître une culture inconnue ou connue de manière très lacunaire, un besoin de savoir d’où l’on vient. Ce besoin viscéral de conserver un lien avec la culture d’origine explique l’essor de l’associationnisme qui permettait également de fournir aux immigrés une aide matérielle et un soutien moral[46]. En 1980, le Ministère italien des Affaires étrangères recensait 322 associations dans l’hexagone dont 233 créées après 1945[47]. D’abord regroupés sur la base de leur origine nationale, les Italiens privilégient les origines régionales à partir des années 1970. Les associations et les autorités italiennes travaillent de concert pour continuer de faire vivre leurs cultures parmi les transalpins immigrés. Elles organisent des cours de langue et de littérature, des conférences, des projections de films et des concerts. Il ne s’agit en aucun cas d’un repli communautaire, les associations ayant pour vocation de faciliter l’intégration sociale dans le pays d’accueil. Certains préfèrent à l’associationnisme la famille, les amis du village d’origine ou les compagnons de travail. C’est ainsi que très souvent des familles d’un même village ou d’une même zone géographique s’installent au même endroit.
En interrogeant des descendants d’immigrés italiens on constate qu’ils ont un attachement particulier à l’Italie et à ses cultures car il ne faut pas oublier que l’unité italienne est très récente et que dans chaque région persistent encore des usages et coutumes très divers. Au-delà des différences issues des origines régionales, la convivialité, le caractère avenant, chaleureux et la proximité intergénérationnelle sont le creuset d’une entraide et d’une solidarité qui leur ont permis aujourd’hui comme hier d’affronter les épreuves et d’envisager l’avenir avec plus de sérénité.
Chaque descendant d’immigré italien porte donc en lui une parcelle de l’Italie qu’il fait vivre à sa manière. Les témoignages laissés, dont certains ont été évoqués dans cet article, soulignent la volonté de perpétuer la mémoire des Anciens et de faire en sorte que leurs histoires ne tombent pas dans l’oubli. Comme nous l’avons souligné précédemment, les origines peuvent avoir une influence plus ou moins importante sur le tracé d’une destinée. C’est précisément cela qui permet de conclure en disant que l’implantation de tous ces immigrés venus d’Italie aux différentes époques de leur long exode a enrichi, au fil des décennies, la population varoise de cet apport culturel transalpin, laissant une empreinte profonde qui a modifié pour toujours la physionomie du Var.
Sabrina Urbani
[1] Jean-Charles Vegliante, Gli Italiani all’estero 1861-1981 dati introduttivi, CIRCE, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1986, p. 49 ; François Cipollone, « L’émigration italienne : hier et aujourd’hui », 2005, http://archives-fig-st-die.cndp.fr/actes/actes_2005/cippolone-maury/article.htm consulté le 2 juillet 2011.
[2] Bertrand Blancheton & Jérome Scarabello, « L’immigration italienne en France entre 1870 et 1914 », Les cahiers du GREThA, n°13, 2010, p. 15.
[3] Jacques Girault, « Les Italiens du Var entre les deux guerres », L’intégration italienne en France, sous la direction d’Antonio Bechelloni, Michel Dreyfus et Pierre Milza, Complexe, Bruxelles, 1995, p. 252.
[4] Ibidem, p. 268.
[5] Maxime Serre, « Italiens en France », France-Italie, revue mensuelle, n°5, novembre 1913, p. 193. Mes remerciements à Jean-Charles Vegliante pour avoir porté à ma connaissance cet article.
[6] Jean Sarramea, « Les liens entre le département du Var et l’Italie », Recherches régionales, n°1, 1988, p. 14 https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Culture/archives/recherches-regionales/recherchesregionales102.pdf consulté le 20 avril 2011.
[7] Sabrina Urbani, « Le chemin de vie de deux expatriés », Racines italiennes, textes et témoignages recueillis par Isabelle Felici, Toulon, Laboratoire Babel de l’Université du Sud Toulon-Var, 2006, p. 14-15.
[8] Racines italiennes, op. cit., p. 25-30.
[9] Emmanuelle Magliano, « Histoire d’une famille d’immigrés italiens », Racines italiennes, op. cit., p. 25-30.
[10] Ibidem.
[11] Blancheton & Scarabello, art. cit., p. 12 ; Jacques Girault, art. cit., p. 259-260 et 268 ; Maxime Serre, art. cit., p. 187.
[12] Blancheton & Scarabello, art. cit., p. 12.
[13] Ibidem, p. 10.
[14] Céline Regnard-Drouot, Marseille la violente, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 177-179 ; Blancheton & Scarabello, art. cit., p. 11.
[15] Blancheton & Scarabello, art. cit., p. 11.
[16] Bertrand Bovio, Les antifascistes italiens dans le Var entre 1919 et 1939, résumé d’une thèse préparée sous la direction de Ralph Schor et soutenue à la faculté di Nice, p. 9, https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Culture/archives/recherches-regionales/rr101-1987-01.pdf , consulté le 2 février 2011.
[17] Paolo Borruso, « Note sull’emigrazione clandestina italiana (1876-1976) », in Matteo Sanfilippo, Emigrazione e storia d’Italia, Cosenza, Pellegrini Editore, 2003, p. 262.
[18] Bovio, art. cit., p. 9.
[19] Girault, art. cit., p 261-262.
[20] Archives départementales du Var, 159 W 859.
[21] Ibidem.
[22] Ibidem.
[23] Jean-Charles Vegliante (dir.), Gli Italiani all’estero, Autres passages..., CIRCE, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1986, p. 86.
[24] Jacques Girault, Jean-Marie Guillon & Ralph Schor, Le Var de 1914 à 1944, Nice, CNDP/CRDP, 1985.
[25] Ibidem, p. 190-191.
[26] Ibidem, p. 196.
[27] Murielle Mazzocchi, « Sillio. Histoire d’un émigré », Racines italiennes, op. cit., p. 56.
[28]Grégoire Georges-Picot, L’innocence et la ruse. Des étrangers dans la résistance en Provence (1940-1944), Paris, Éditions Tirésias, 2000.
[29] Le premier exemplaire du journal Resistenza unita a paru en janvier 1969 et le dernier en décembre 2000. Tous les exemplaires sont consultables sur le site http://www.resistenzaunita.isrn.it consulté le 20 mars 2009. Ce lien n’est désormais plus actif.
[30] Jean-Charles Vegliante, op. cit., p. 86-87.
[31] Mathilde Pascuttini, « Une famille frioulane », Racines italiennes, op. cit., p. 35.
[32] Ibidem.
[33] Agnès Morini, « Presque un siècle entre nous », Enfants d’Italiens, quelle(s) langue(s) parlez-vous ?, textes et témoignages recueillis par Isabelle Felici et Jean-Charles Vegliante, Toulon, éditions Géhess, 2009, p. 254.
[34] Lidia Di Carlo, « Entre deux voix », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 94.
[35] Adrien Vezzoso, « Mon Mazzolin di fiori », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 173-181.
[36] Lidia Di Carlo, « Entre deux voix », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 100.
[37] Christophe Mileschi, « Ma langue italienne », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 126-128.
[38] Mathilde Pascuttini, « Une famille frioulane », Racines italiennes, op. cit. p. 31.
[39] Marie-Magdeleine Dauthier, « Du beau et du bonheur plein les yeux », Racines italiennes, op.cit., p. 115-116.
[40] Corinne Battistoni-Van der Yeught, « Les grenouilles du fleuve », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 142.
[41] Isabelle Felici, « Le mystère des langues », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 135.
[42] Martine Storti, « En Italien, il ne parlait jamais… », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 104.
[43] Corinne Battistoni-Van der Yeught, « Les grenouilles du fleuve », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 150-153.
[44] Cindy Doneda, « L’Italie dans mes veines », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 159-172.
[45] Emmanuelle Sola, « D’Emmanuel troisième à la famille Sola : l’itinéraire d’une smala italienne », Enfants d’Italiens..., op. cit., p. 233-240.
[46] Maxime Serre, art. cit., p. 189-191.
[47] Stéphane Mourlane, « Solidarités formelles et informelles : les associations d’Italiens en France depuis 1945 », Cahiers de la Méditerranée, http://cdlm.revues.org/21 consulté le 4 juillet 2011.
