Le prix à Payer
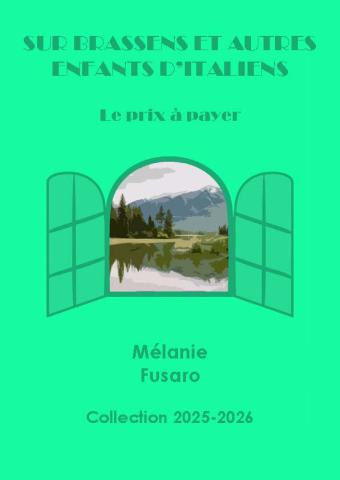
La France est régulièrement secouée par des incidents, des polémiques autour de l’islamophobie,
de l’antisémitisme, par des émeutes dans les « quartiers », des controverses sur les sans-papiers, faisant
remonter à la surface les ruptures et fractures qui séparent et divisent, autant sur le plan territorial,
social et politique qu’idéologique. Les sociologues évoquent la « ghettoïsation » des banlieues et le
terme « apartheid » a récemment ressurgi dans les discours pour dénoncer la ségrégation de pans
entiers de la population française et leur subséquente rébellion. Et c’est à juste titre qu’on peut se
demander quelle place on fait à l’Autre dans notre société.
Que ce soit les musulmans d’aujourd’hui ou les Italiens d’hier, qu’a-t-on exigé d’eux pour que
certains se dressent contre le pays qui les a accueillis ? Quelle rancœur, quelle vengeance, quelle
frustration peuvent être à l’origine d’une telle violence à l’encontre de son soi-disant bienfaiteur ? La
France assimilationniste n’a-t-elle pas elle-même engendré le monstre qui, tel Frankenstein, menace
aujourd’hui de la détruire ? En obligeant, au nom de l’intégration, les immigrés à confiner leur propre
culture au sein des espaces privés, en censurant leur expression et leur représentation dans l’espace
public, n’a-t-elle pas elle-même encouragé leur radicalisation ?
Ces questions, ces réflexions, que l’actualité fait souvent ressurgir, jalonnent de longue date
mon parcours de chercheuse. Il me semble donc intéressant d’aborder sous cet angle le rapport des
immigrés italiens à l’altérité, à cet Autre français auquel ils se devaient de s’assimiler, quitte à renoncer
à leur propre « italianité » : quel a été en réalité le prix à payer de ce que l’on a trop souvent banalisé
comme l’« immigration réussie » ?
Puisqu’il s’agit de témoigner à partir de scènes vécues, de ressentis, de souvenirs tirés d’une
mémoire plus ou moins fiable et précise, je prendrai l’exemple de ma grand-mère, née en France en
1930 de parents italiens originaires de la région des Pouilles, naturalisée française en 1967 et pourtant,
à quatre-vingts ans passés, toujours empêtrée dans une profonde et inextricable ambivalence entre
des sentiments de fierté et de honte vis-à-vis de ses origines.
Fière, elle l’est, quand il s’agit de nous régaler, nous ses enfants et petits-enfants, d’un ragù qui
mijote depuis des heures, d’un polpettone qui fond dans la bouche, de mazzapani qui croquent sous
la dent, d’une parmigiana qui lui a demandé une journée de travail. Et pourtant, ces mêmes plats
qu’elle nous sert avec la satisfaction de la mission accomplie et l’orgueil de la mère nourricière sont
dérobés au regard des autres, des Français : lorsque mes parents ont commencé à se fréquenter et
que ma mère, française, récemment entrée dans la famille, rendait visite à ses beaux-parents, ma
grand-mère cachait le repas dans le four, pour éviter que la petite amie de son fils ne voie ce qu’elle
considérait comme une « nourriture de pauvre ».
Au quotidien, elle se nourrit donc essentiellement à l’italienne, de salades colorées l’été, de soupes
de légumes secs l’hiver, de pastasciutta et de pain, d’un peu de poisson et de viande de temps en temps,
de fruits en abondance – la dieta mediterranea, en somme. Pour les repas de fête, elle honore les
traditions héritées de sa mère et de sa grand-mère pugliesi. Néanmoins, il ne lui viendrait pas à l’esprit
d’y inviter des personnes étrangères à son clan, qu’elle aurait l’impression d’offenser, en les recevant
avec ces « nourritures de pauvres ». Mais ma grand-mère imagine-t-elle seulement à quel point la
cuisine italienne – que dis-je, la « gastronomie » italienne, telle qu’elle est exportée de par le monde
– est aujourd’hui prisée et hautement appréciée ? Sait-elle seulement combien un Français est prêt à
payer un plat de pâtes plus ou moins savoureux dans un restaurant plus ou moins authentique ? Se
doute-t-elle que les épiceries fines italiennes sont désormais l’apanage des classes aisées, qui viennent
s’y fournir, à prix d’or, en burrata, taralli, huile d’olive de qualité et autres produits que ma grand-mère
désigne encore, elle, comme « nourriture de pauvres » ?
Certes, ma grand-mère, à la différence de nombre de personnes âgées qui ont su évoluer avec
leur temps, s’est laissée dépasser par un monde qui a changé trop vite pour elle et elle n’en a pas
encore intériorisé toutes les transformations. Néanmoins, cette persistance à considérer, avec honte,
son alimentation comme celle d’une classe inférieure me semble aussi découler d’un stigmatisme tant
et si bien ressenti qu’elle l’a fait sien.
De même, elle est persuadée que son dialecte ne sert à rien et qu’il est voué à l’extinction –
extinction qu’elle encourage elle-même puisqu’elle ne l’a que très peu transmis à mon père (qui le parle
très peu et se limite à quelques expressions) et qu’elle a catégoriquement refusé de nous le transmettre
à nous, ses petits-enfants : elle nous disait d’apprendre l’anglais, l’allemand, des langues qui allaient
nous être utiles dans la vie. Mais, à certaines occasions, lorsqu’elle est entourée de francophones, il lui
arrive de s’adresser uniquement en dialecte à mon père – comme une manière de revendiquer malgré
tout sa différence, son origine.
Quant à l’italien, qu’elle a appris à l’école comme une langue étrangère quand elle était petite,
elle le comprend, à force d’écouter la Rai International qui fait office de fond sonore chez elle, mais
elle le parle avec maladresse ; et si moi, sa petite-fille, qui ai également appris l’italien à l’école, je lui
parle dans cette langue, elle me répond presque systématiquement en français. Est-elle réellement
plus à l’aise dans cette langue, bien qu’elle la parle avec les erreurs typiques d’une personne ayant reçu
peu d’instruction et qu’elle l’écrive plus maladroitement encore ? Ou a-t-elle tant et si bien incorporé
l’injonction selon laquelle elle devait parler français qu’il ne lui est plus possible de parler l’italien ? Est-ce
parce que sa vraie langue maternelle, finalement, est le dialecte ? Peut-être est-ce tout simplement
que pour elle, je suis française et qu’il n’est pas si facile, alors qu’elle me parle français depuis ma plus
tendre enfance, de changer de langue de communication. Je m’interroge tout de même sur la puissance
de la répression, explicite ou implicite, à l’encontre des langues des immigrés.
C’est sans doute la raison pour laquelle, étant enseignante, je ne m’indigne pas, comme mes
collègues, d’entendre mes élèves communiquer parfois dans leurs langues d’origines au sein de
l’établissement dans lequel j’enseigne : pourquoi l’adoption du français devrait-elle nécessairement se
faire au détriment des langues étrangères ? Au contraire, je suis ravie lorsqu’un élève d’origine turque,
par exemple, fait une comparaison, remarque une similitude entre un mot turc et un mot italien : il
élargit ainsi le champ de mon savoir et celui des autres élèves, il apporte un surplus de culture dans la
classe, il fait lui-même le lien entre son propre bagage culturel et le savoir qu’il reçoit et c’est pour lui
une manière bien plus efficace de se sentir « intégré ».
Alors qu’est-ce que l’intégration ? Nos ancêtres italiens, dont on dit qu’ils représentent
l’« immigration réussie », ont certes amélioré leur qualité de vie, accédé à la propriété, permis à leurs
enfants et petits-enfants d’en faire autant ; mais à quel prix ? Celui du refoulement, de la honte, de
l’autocensure ? Celui de l’abandon d’une culture, de la mise sous silence d’une langue, de la perte d’un
patrimoine culinaire ? Et quel est le prix à payer pour les générations suivantes, qui héritent de cette
béance qu’elles mettront peut-être toute une vie à combler ?
Et si nous permettions vraiment à tout un chacun de vivre pleinement, au grand jour, sa culture
d’origine, tant qu’elle n’entre pas en contradiction avec les « valeurs de notre République » ? Cela
semble relever de l’évidence et pourtant il me semble que nous sommes encore loin de permettre
l’expression de personnalités aux cultures multiples et la fusion féconde et sereine de ces cultures.
Avec la multiplication des flux migratoires, la libre circulation des personnes et la mondialisation,
le brassage des peuples est plus que jamais d’actualité. Alors permettons que les cultures circulent
tout aussi librement, tout en appliquant avec tolérance et ouverture les principes fondateurs de notre
constitution : peut-être éviterons-nous ainsi que les prochaines générations ne donnent naissance
à certains monstres amputés d’une partie d’eux-mêmes qui cherchent dans la violence un palliatif à
leur déracinement. La poésie d’Édouard Glissant, poète créole, a su montrer que l’entremêlement
des cultures engendrait aussi la beauté, pour peu qu’on cesse d’y voir une menace à l’intégrité de nos
peuples. C’est avec les mots de ce chantre de l’hybridation que je terminerai :
Un homme
Est devenu jaloux des murs,
Et puis, têtu, c’est des racines
Qu’il ne peut plus se démêler.Il assoit à l’écart,
Un corps habitué,Exclut les portes,
Exclut le temps,
Voit dans le noirEt dit : amour.
