A la source de mes racines
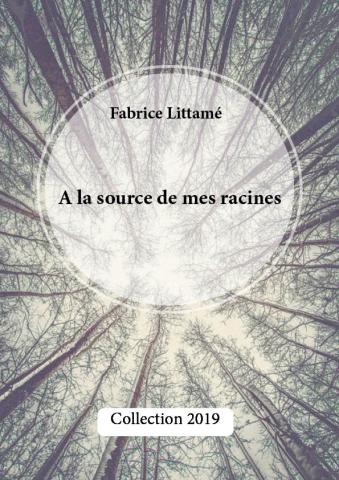
A la source de mes racines
Un diplôme de tailleur a été décerné à mon père, Raphaël Littamé, à l’âge de vingt ans, le 24 mai 1947 à Padoue. Sept années plus tard, jour pour jour, je suis né.
Cette coïncidence de dates établit un lien entre deux événements de sa vie. Il avait quitté l’école communale très tôt au début de l’adolescence et, en plus, il ne siégeait dans sa classe que le matin à la fin de ce bref parcours scolaire alors que, l’après-midi, il était formé par Achille Dardo dans son village, Terrassa Padovana, à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville padouane. Son maître, qui enseignait son art à une dizaine d’apprentis dans son atelier, jouissait d’une bonne réputation dans le secteur, de telle sorte que ses clients se déplaçaient de loin pour solliciter ses services.
Son prometteur élève était de nouveau diplômé en 1951 mais cette fois à Paris, par l’académie internationale de coupe. Comment a-t-il évolué d’une petite bourgade italienne inconnue à l’illustre capitale française ?
Le sol de la cuisine dans sa maison villageoise était constitué de terre battue dans laquelle avaient été glissés des carreaux cassés ou des pierres. En Vénétie, la misère régnait au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L’immigration représentait le salut pour beaucoup de jeunes gens qui vivaient de rapines et de larcins divers.
Marquée par un déficit de sa population masculine après ce conflit avec l’Allemagne, la France ouvrait ses bras aux immigrés. Mon père s’y engouffra en imitant son frère aîné Jean-Baptiste, dans cette famille de sept enfants. Lidia, une de leurs quatre sœurs qui, plus jeune qu’eux, travaillait déjà en Lombardie dans une usine de textiles, les aida financièrement pour leur projet.
Le tandem a répondu à une demande d’agriculteurs de Guise-en-Thiérache en remplissant un document d’embauche à sa mairie. Le patronat français proposait en effet des emplois et payait le voyage depuis Milan où, dans la caserne Garibaldi, les émigrants subissaient, avant leur départ, toute une série d’examens médicaux, radiologiques et sérologiques, afin de justifier de leur bonne santé. Dans la foulée, le duo a pris un train poussif pour Paris puis une micheline, encore moins rapide, pour Soissons dans l’Aisne, où les étrangers étaient regroupés dans un centre quelque temps avant de rejoindre leur lieu de travail dans ce département.
Lors de cette étape de transition, mon père sympathisa avec un compatriote dans un bar. Il lui fit part de son regret à la perspective de travailler dans l’agriculture et de son désir d’exercer son vrai métier qui, en fait, lui avait été imposé par son géniteur alors qu’il était tenté par la mécanique propre à la moto, fasciné par ce moyen de locomotion dans sa pauvre contrée où personne ne roulait en voiture.
Son interlocuteur lui a alors révélé que, dans sa partie vestimentaire, un certain Ottavio Cicuto, un autre transalpin, s’était installé dans la cité soissonnaise. Fort de cette information il la sillonna de long en large le lendemain, d’abord dans ses rues commerçantes puis dans un quartier cossu où il rencontra l’homme providentiel sans qu’il ne puisse être embauché, car il avait signé un contrat avec un autre employeur.
Sa déception s’intensifia dans l’exploitation agricole car il était confronté à des conditions déplorables, dans la boue, durant la campagne betteravière. Blessé par un cheval, il se servit de cet accident pour résilier son engagement et, deux mois plus tard, se présenta de nouveau au patron dont il rêvait. Il fut accepté... sur-le-champ.
Son tempérament nerveux fut remarqué par ses collègues dès les premières heures en commun. Le soir-même, ma mère couturière, qui faisait partie du personnel, décrivit le caractère ombrageux du nouveau venu à ses proches en plaignant la femme qui l’épousera. Comme elle avait constaté son isolement, elle lui proposa néanmoins de se joindre à elle lors d’une sortie avec ses amis. Ils se côtoyèrent de plus en plus et tombèrent amoureux.
Le hasard voulut que, deux décennies plus tôt, le père de la jeune fille eût suivi un trajet identique depuis San Giovanni di Casarsa dans le Frioul, une province jouxtant celle de son futur gendre. Maçon de formation, il obtint une place de contremaître à la sucrerie de Bucy-le-Long où il accomplit toute sa carrière comme salarié.
Mon père en revanche s’installa à son compte. Grâce à sa seconde formation parisienne, ses qualités professionnelles, sa faconde en faisant chanter les mots français avec son accent latin, il développa sa clientèle dans la bourgeoisie axonaise, en confectionnant des habits sur mesure puis en se lançant dans le prêt-à-porter qui survint plus tard en 1970. Il aurait pu s’enrichir s’il avait fait breveter une méthode qui lui permettait de diminuer le métrage du tissu en inversant, au moment de la coupe, les pièces qui composent un vêtement.
Il retournait régulièrement en Italie du vivant de ses parents, leur envoyant de l’argent, rachetant leur demeure qui avait été une fois hypothéquée à cause des dettes de mon aïeul dans les cafés qu’il fréquentait journellement. Jeune marié, il effectua même ce déplacement en scooter, sur une Vespa, avec son épouse comme passagère, parcourant les mille deux cents kilomètres en cinq journées, à cause de deux incidents : usure des freins en descendant le col du Mont Cenis et violent orage près de Troyes.
La maison de mes grands-parents paternels s’imposa ensuite comme la destination systématique de nos vacances estivales durant ma jeunesse. En louant un logement sur place une à deux semaines, nous profitions aussi de la mer, non loin de là, à Sottomarina, près de la mythique Venise et de Chioggia, un port moins réputé mais magnifique par son authenticité.
Gamin, j’ai appris le dialecte veneto et je jouais à la scopa, un jeu de cartes typique, avec mon grand-père qui se mettait en colère et jurait quand il perdait. À la briscola à quatre, par équipe de deux joueurs, en tâchant de ne pas se faire remarquer par les adversaires, on informait son partenaire grâce à des expressions du visage lors de parties hilarantes. En claquant des dents, on indiquait un as et un « trois » qui rapportaient des points. Un roi était signalé en levant les yeux au ciel vers sa couronne, une reine et un cavalier en haussant les épaules et un valet en tirant la langue. Comme il était permis de le faire dans ce cas-là, le gamin farceur que j’étais profitait de l’aubaine.
Adulte, j’ai continué à entretenir ces liens vénitiens et frioulans, en les étoffant d’une dimension culturelle par la visite de sites religieux ou antiques, à Rome évidemment, Pompéi, Paestum ou Agrigente en Sicile, sans oublier Florence, la fine fleur de la Renaissance. Mais je ressens un attachement particulier pour les tombes étrusques de Tarquinia en Toscane, que j’ai visitées encore étudiant.
Avec une telle lignée, je me sens plus italien que français. J’ai même acheté là-bas, dans le sud, une habitation traditionnelle, un trullo, en inversant l’odyssée paternelle pour revenir à la source de mes racines. Ce cheminement reste néanmoins utopique car on ne peut réellement replonger dans le passé qu’en pensée dans les méandres de la mémoire. La nostalgie suscite en nous des images dont les contours s’estompent et finissent par se brouiller comme un mirage dans le désert qui devient flou en inondant de zébrures notre regard et en dissipant nos chimères.
