Chut on oublie
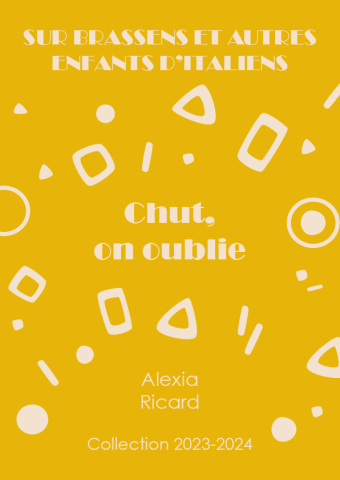
Chut, on oublie
On ne s’imagine pas vraiment à quel point il peut être difficile de s’immiscer dans des souvenirs qui ne nous appartiennent pas. Étonnement, aussi bien pour mon interlocuteur que pour moi, car nous nous connaissions déjà : nous sommes de la même famille.
Ne rien savoir, ou presque rien, de ses origines ne pose pas vraiment de problème tant qu’on ne cherche pas à en apprendre davantage. « J’ai du sang italien, j’ai des origines siciliennes », voilà ce qu’on entend, ce qu’on salue de loin et ce qu’on approuve, car le métissage, c’est bien, c’est chargé d’histoire. On aime, mais au fond, on ne creuse pas pour connaître les détails. En revanche, répondre « Super ! De quelle ville ? Quels parents étaient Italiens ? » devient une curiosité un peu mal perçue. Enfin, quand on insiste et qu’on en vient à LA question « mais... pourquoi avoir quitté l’Italie ? », alors c’est carrément une indiscrétion.
Je me suis rendue compte de cet obstacle quand mon interlocuteur n’a pas pu narrer l’histoire de son aïeul avant que celui-ci arrive en France. Gianni R, le grand-père, était originaire de Sicile, de Monterosso plus particulièrement. Il était né à l’aube du XXe siècle et avait commencé très tôt à travailler comme maçon avec son père.
Mon interlocuteur était fier de me raconter qu’il a visité récemment Monterosso pour connaître la ville de son grand-père et de son arrière-grand-père, plus par curiosité que par désir de retrouver ses racines. Mais il avait quand même fait quelques recherches et découvert que son arrière-grand-père avait participé à la construction du Palazzo Cocuzza. Malheureusement, son nom n’est pas resté dans les archives. Il était simple maçon, pas architecte ni homme d’importance dont le nom aurait été digne de figurer dans les archives du bâtiment.
Mais voilà que tout cet orgueil que représentent les racines, les origines s’est évanoui lorsque j’ai posé LA question. De nombreux membres de la famille R. ont quitté l’Italie durant les années vingt et trente pour partir vers différents pays du monde : la France, les États-Unis, l’Argentine, le Royaume-Uni. J’ai compris que le grand-père de mon interlocuteur n’était pas d’accord avec le pouvoir fasciste de l’époque et que, pour cette raison, il lui était de plus en plus difficile de travailler, même comme simple maçon. Trouver du travail était déjà compliqué, mais l’Italie fasciste obligeait à adhérer au parti et condamnait au désœuvrement celui qui s’y refusait.
Je ne sais pas pourquoi Gianni R. a choisi la France, ni pourquoi il s’est établi à Marseille. Lui et son épouse ont trouvé naturel de quitter la Sicile en bateau pour débarquer dans le port le plus important de la Méditerranée et ils n’ont jamais eu l’intention d’aller plus loin. Gianni R. parlait déjà un peu français. Des membres de la famille R. s’étaient installés à Nice quelques années auparavant. Il s’est servi de ses quelques connaissances linguistiques et/ou relationnelles pour s’installer à Saint-Barnabé, un quartier à l’est de Marseille, monter sa petite entreprise de maçonnerie et ne plus jamais quitter cet endroit où il vivrait désormais avec son épouse.
Une fois arrivés en France, Gianni R. et sa compagne ont mis un point d’honneur à rompre avec leurs racines italiennes. Ils vivaient en France et devaient se conduire en parfaits Français. Sur leurs papiers d’identité, ils ont tous les deux changé de prénom. Gianni R. est devenu Jean R. J’ai compris à ce moment-là qu’il y avait de la gêne, de la honte même, à l’égard de leur pays d’origine, ou plutôt de ce qui s’y passait. Tout ce qui pouvait leur rappeler l’Italie, ils s’en éloignaient. Ils n’avaient aucune relation avec d’autres Italiens émigrés comme eux à Marseille. Ils s’entendaient bien avec leurs voisins et avec leurs relations professionnelles, des Français. Au début, le couple communiquait en italien. L’épouse de Gianni, qui ne connaissait pas le français, s’est efforcée de l’apprendre rapidement en discutant avec lui et en lisant Le Pélerin, un hebdomadaire religieux. Tous leurs enfants, deux fils et trois filles, sont nés en France. Ils n’ont jamais appris à parler italien. Ils n’ont jamais connu d’autre culture ni d’autres habitudes en dehors de la culture et des habitudes françaises.
Et cette honte, ce tabou du « Je suis d’origine italienne », s’est ressentie encore quand mon interlocuteur m’a parlé de son père, de son oncle et de ses tantes qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et qui ont dû survivre à l’après-guerre. Les enfants sont cruels entre eux et, pire, ils répètent ce que disent leurs parents sur ces « Italiens fascistes qui ont aidé ces sales Boches à occuper la France ». L’école a renforcé ce tabou, ce jugement que « l’Italie c’était mal, honteux », qu’il fallait être Français pour ne pas se faire lyncher. Les enfants R. savaient bien que leurs parents avaient un accent, qu’ils roulaient les r et qu’ils parlaient avec les mains.
C’est à ce moment-là que Gianni R. a ressenti cette chose inconnue, la discrimination, par le biais de ses enfants qui en faisaient les frais. Il ne leur a jamais raconté avec précision sa vie en Italie, son départ, ses raisons. Aujourd’hui encore, le père de mon interlocuteur ne veut pas parler de cette période qu’il juge sans intérêt.
Ni son grand-père, ni son père ne sont retournés en Italie. C’était une période révolue pour eux, ils ne voulaient plus en entendre parler. Il fallait vraiment rompre ce lien qui les rattachait malgré tout à la Sicile. Leur nouvelle vie était en France, à travailler dans le bâtiment à Marseille. Le père a repris l’entreprise à la mort du grand-père. Sur le plan professionnel, venir en France a permis à Gianni R. de réussir, mais il a quand même dû vivre avec le handicap d’être Italien. Même après avoir obtenu la nationalité française dans les années cinquante. Même si ses enfants et ses petits-enfants sont nés sur le sol français et que rien ne les rattache à l’Italie. Il lui a fallu oublier d’où il venait ou, si ce n’était pas possible, taire son origine, oublier que le pays natal les avait trahis, oublier qu’il était la source de leur échec, oublier qu’il était la cause de leur rejet. Devenir français était le seul moyen de se créer un avenir.
Et pourtant, après tant d’efforts pour effacer toute trace d’Italie dans la descendance, le petit-fils est loin de faire la grimace en pensant à ses origines. Il est fier de savoir que les hommes de sa famille travaillent dans la construction depuis au moins quatre générations et est loin de se désintéresser de la part de mystère que son aïeul essayait de taire. À trop cacher les détails, on suscite la curiosité de les découvrir. Même si la gêne s’est ressentie dans la voix de mon interlocuteur, car il ne lui était assurément pas facile de parler des difficultés rencontrées par certains membres de sa famille, il m’a montré qu’il est possible d’oublier qu’il fallait oublier et de vivre sans gêne le fait d’être un enfant d’Italien. Voire d’en ressentir de la fierté, finalement !
