Citrons en Calabre
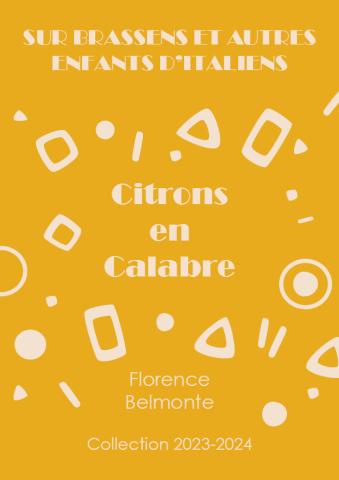
Citrons en Calabre
Au marché de Castelnau-le-Lez, j’ai croisé Catali, une copine corse, professeur d’italien ; elle m’a lancé en riant : « Tu tiens ton porte-monnaie comme les Italiens, tu ne serais pas italienne ? » Les billets tout froissés seraient – dit-elle – une marque identitaire qui ne saurait mentir. Je n’y crois pas, mais la remarque m’a touchée, émue, elle a fait résonner d’autres instants d’émotion, comme la lecture de ce message d’une collègue de l’université, il y a quelques années, annonçant la parution d’un ouvrage où des descendants d’Italiens témoignaient de ce qu’ils gardaient de la langue de leurs aïeux, ou encore la singulière sensation de bien-être ressentie en Italie que je connais peu mais qui ne me dépayse pas, alors que l’Espagne à laquelle rien ne me rattachait, avec laquelle j’ai construit un lien volontaire, dont je connais l’histoire, dont je parle la langue, l’Espagne continue par certains aspects de me dépayser. Et cela fait son chemin. Que me reste-t-il de la culture de mes aïeux paternels ? Notre grand-père était calabrais. J’avais longtemps pensé qu’il ne me restait tout au plus de lui qu’une vague ressemblance, quasiment rien en dehors de quelques phrases restées légendaires dans la famille et auxquelles ses enfants ne semblaient pas accorder de crédit et encore moins nous, ses petits-enfants. Il aurait donc déposé sur nous comme des empreintes italiennes ? Ces billets froissés dans mon porte-monnaie seraient-ils comme une trace de l’aristocratique rapport à l’argent – entre appétit et refus de s’en soucier – de la famille Belmonte ? Certaines de ses phrases passées à la postérité familiale reviennent à ma mémoire amusée : « En Calabre, les Belmonte, nous étions nobles ! » ; « en Calabre, les Belmonte ont porté la pourpre cardinalice ! » et, geste à l’appui, « en Calabre, les citrons étaient gros comme ça ! Et les pastèques aussi étaient très grosses ! ». Ce n’est qu’aujourd’hui que je fixe ma réflexion sur le très fort accent de mon grand-père paternel que nous imitions volontiers, mon frère aîné et moi, sans que personne ne nous reprenne – ça faisait même rire certains grands. Nous ne nous demandions pas s’il venait d’Italie ou d’ailleurs ; je réalise seulement aujourd’hui que si tout le monde l’appelait Zè, c’était certainement parce que pour l’État-civil, il était Giuseppe, encore que les Joseph du quartier pouvaient aussi porter ce diminutif.
Oui, d’accord, peut-être, mais en attendant, nous, dans le quartier Belzunce, historique quartier de transit d’une immigration venue de tous les coins du monde, dans les années cinquante et soixante à Marseille, nous étions de « purs » Français et qui aurait eu l’audace de dire le contraire se serait frotté à la famille qui ne plaisantait pas avec ça, d’ailleurs cela ne serait venu à l’idée de personne. Car dans ce quartier principalement d’immigrés, si nous faisions figure de famille authentiquement française, si nous étions même une sorte de prototype de famille française, c’était simplement parce que nous n’étions ni africains ni arméniens ni grecs. Il faut comprendre aussi que si nous apparaissions comme aussi résolument et indiscutablement français, c’est parce que les immigrés pour nous et tous ceux de notre groupe, c’étaient les autres, enfin, d’autres que les Italiens et leur descendance. Dans le quartier, c’était seulement des hommes venus d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne – à l’époque, on disait d’Afrique noire – et certainement pas les enfants. Non, pas les enfants, d’ailleurs, des enfants nés de familles africaines, il n’y en avait pas beaucoup dans le quartier, ni à l’école publique de la rue des Convalescents que fréquentait mon frère, ni à l’école catholique, l’école Notre Dame de la rue des Dominicaines où j’ai fait mon primaire et, il faut bien le dire, ceux qui étaient là étaient généralement tenus à l’écart. Ils avaient leur rue, la rue des Chapeliers. Je me souviens de Malika, j’étais en CP, après une « affaire » de gomme disparue ; pendant un certain temps, c’est de moi que les religieuses et la maîtresse avaient exigé que je « vérifie » son cartable avant l’heure de la sortie. Avait-elle vraiment été « la coupable » ? Et quand bien même ! Ces religieuses avaient « l’art de la ségrégation » ; elles donnaient aussi du matériel scolaire usagé, des bouts de crayons, des restes de gommes, aux moins fortunées d’entre nous. Nous étions nombreuses dans cette catégorie dans le quartier. Mes parents m’avaient appris à le refuser, même à le rapporter et à dire : « mes parents ont dit que quand on donne, on donne ce qu’on a de plus joli, ce qu’on aurait voulu pour soi ».
Notre grand-père était français par naturalisation mais nous ne le savions pas : notre père et nos oncles parlaient français sans accent italien et si nobles qu’aient pu être nos aïeux en Calabre ou si gros qu’y soient les citrons et les pastèques, personne, mais vraiment personne ne faisait le projet du retour au pays, bien au contraire. Nous – je parle de ceux des petits-enfants de « Pépé de Marseille » qui étaient nés dans les années cinquante et soixante –, nous n’avions qu’une vague conscience, ou pas conscience du tout dans mon cas, de ses origines étrangères. Mon frère qui est mon aîné de trois ans et qui l’a plus fréquenté aussi parce que l’univers masculin et l’univers féminin étaient très compartimentés à l’époque, dit se souvenir qu’il pouvait se mettre en colère en italien. Il nous semblait surtout, et tout au plus, un peu pittoresque, un exotisme que moi je ne rattachais pas non plus à un pays précis, plutôt à une façon d’être. Savais-je seulement à l’époque où se trouvait la Calabre ? J’en doute. Petits, il nous impressionnait : « Incroyable, Pépé avale des piments au petit-déjeuner (j’ai appris depuis qu’il y a d’excellents piments en Calabre) ; incroyable, Pépé dit qu’il faut placer un balai derrière la porte d’entrée chaque soir pour chasser les sorcières » – il est admis dans la famille qu’il y croyait. Plus tard, il devint pour nous une sorte de personnage, la raideur de son port, sa constante théâtralité inspirait nos jeux et, dans son dos, nous l’imitions : Pépé faisant une théâtrale colère, Pépé fou de rage contre Toni, le fiancé de tata Simone, quand elle était en retard, gli spacco la faccia, gli faccio la pelle !, Pépé sermonnant ensuite tata Simone et son Toni – du grand cinéma –, Pépé nous faisant tenir tranquilles le jour de Noël, nous faisant lever aux aurores, tenir droits sur nos chaises, nous laver à l’eau froide, etc. En fait, ses habitudes frustes, sa rudesse, son degré élevé de machisme aussi, digne d’être souligné même pour l’époque, sa façon de parler, ses expressions, son ton et le rythme particulier de son élocution en français, tout ce qui le singularisait, et dont certains éléments l’inscrivaient dans sa culture de naissance – la culture et la langue de zones rurales reculées – crevaient les yeux et les oreilles mais ce n’était pour ses petits-enfants qu’une source de jeux, ce qui nous a détournés certainement de nous sentir alors les possibles héritiers conscients, volontaires et aimants de cette culture, de nos origines, d’une langue grand-paternelle. Oui, d’accord, les hommes de la famille, mon père, mes oncles, disaient des injures en italien et c’était rigolo, mais c’était tout, et nous, les enfants, n’en avions que faire car que ce soit en italien ou dans une autre langue, il ne fallait pas en dire, c’est tout. Mes parents étaient intransigeants avec les enfants sur ces codes de politesses, ils en avaient compris la valeur sociale, ce qui n’empêchait pas mes cousins et mon frère de jurer mais en français. Je revois aussi mon père, toujours fasciné de technologie moderne, s’enregistrant avec les premiers magnétophones à bande, il chantait un air d’opéra italien, comme il pouvait le faire lors des repas de famille, mais en français.
À l’époque, je ne voyais pas non plus en mon père un enfant d’Italien. Pourtant en revenant aujourd’hui au souvenir de la blessure qu’il avait ressentie à plus de soixante ans lorsque, suite à des dispositions prises par le ministre Pasqua il s’était vu refuser le renouvellement de sa carte d’identité parce que nous ne retrouvions plus l’acte de naturalisation du grand-père, cette filiation s’affranchit de l’ombre. J’avais jugé sa réaction excessive, mais le souvenir me revient aussi de la vénération qu’il avait toujours eue pour ce papier d’identité, banal à mes yeux, pas si banal pour lui finalement, fils d’Italien, conscient de l’être. À l’époque de son enfance, il avait dû en entendre des « sale macaroni » ! Et ses frères aînés plus encore que lui, qui était le sixième de sa fratrie et avait été évacué de Marseille pendant la guerre, placé dans une famille paysanne d’Auvergne, comme beaucoup d’autres enfants que leurs familles déjà pauvres ne pouvaient nourrir dans une ville soumise de surcroît aux restrictions et aux bombardements. Peut-être cette expérience a-t-elle d’ailleurs été un moteur de plus dans sa quête constante de reconnaissance et d’intégration, d’élévation sociale. De l’ensemble de sa fratrie, il semble avoir été le seul à désirer ardemment voir ses enfants s’élever par l’école. Lui n’y était presque pas allé, il avait travaillé à quatorze ans et voulait surtout être boxeur, c’était sa voie rêvée d’ascension sociale. Il l’a été d’ailleurs mais contrairement à son désir, cette voie n’a pas été celle de l’enrichissement et du succès escomptés. L’ascension sociale aura été son obsession : intégrer à l’excès les « bonnes manières » à la française, les transmettre, tenter de corriger l’accent du quartier lorsqu’il était hors de la famille. Et ma mère, – française « de souche », blonde aux yeux bleus, éducation à la française – détonnait un tantinet dans la famille où les autres oncles et tantes avaient épousé des fils et filles d’Italiens tous bruns aux yeux noirs comme le reste des Belmonte.
L’ascension sociale ! La réussite ! Un leitmotiv familial ! Pépé de Marseille comptait sur sa progéniture : « Ma fille, mon bâton de vieillesse, m’achètera de belles cravates et de belles bagouzes ! »
De ma grand-mère paternelle, nous ne savons pas grand-chose tant elle était identifiée au groupe des Belmonte. « Plus italienne que les Italiens » au dire de ma mère. Je n’ai pas souvenir d’avoir mangé à sa table autre chose que des plats italiens ou provençaux. Elle était pourtant née en Bourgogne où j’ai eu l’occasion de me rendre souvent et où je n’ai jamais rien identifié qui puisse me ramener à elle. J’ai appris cette origine très tard, alors qu’elle avait disparu depuis longtemps. Et c’est assez tard aussi que j’ai su qu’elle avait été placée très jeune au service d’une famille bourgeoise et qu’elle avait été « fille-mère » des œuvres de son patron. Comment avait-elle échoué ensuite dans le sulfureux quartier Belzunce de Marseille ? Nous ne le savons pas. Nous pouvons calculer, à l’âge de ses enfants, qu’elle y connut notre grand-père assez rapidement. La petite fille née avant ce mariage a porté le nom de Belmonte. Mes grands-parents ont eu huit enfants dont sept sont arrivés à l’âge adulte. La courte histoire des trois aînés qui n’a malheureusement rien d’exceptionnel est une illustration concrète des aspects sombres de la vie de ces familles impécunieuses qui faisaient tout pour maintenir les apparences de la prospérité au prix de beaucoup de sacrifices et d’une grande austérité infligée à ses membres. Ils ont connu les pénuries les plus graves dans l’enfance et l’adolescence et leur trajectoire est marquée du sceau de la tragédie. Paulette, l’aînée, avait très tôt fait des ménages, comme notre grand-mère, s’était mariée à dix-huit ans et s’était donné la mort à vingt-deux, laissant les deux aînés de nos cousins orphelins de mère. François, dit Coco, avait disparu à vingt ans des fièvres typhoïdes et le « petit Raymond », son cadet, dont la mémoire est auréolée d’héroïsme, était mort en captivité en Allemagne. Tous deux étaient pêcheurs, enfin, ils étaient employés à la journée chez des patrons pêcheurs, ce qui signifiait qu’ils n’avaient pas du travail tous les jours. Et Pépé de Marseille ces jours-là n’était pas tendre envers eux, c’est un euphémisme : ils devaient rapporter un salaire pour avoir le droit de s’asseoir à sa table. D’où quelques dérapages picaresques de leur part, il fallait bien manger ! Heureusement, à partir de l’oncle numéro 5, Jean, la situation s’améliorait, la famille avait pris le chemin d’une sorte de happy end social puisque les fils suivants avaient accédé à la classe moyenne – ce qui dans leur esprit signifiait, et c’était important pour eux, ne pas être ouvrier, même s’il arrivait qu’ils gagnent moins qu’un ouvrier – Jean était chauffeur-livreur, il avait passé le permis à l’armée, un passeport social et professionnel, et Jacques (mon père) était employé de base dans une compagnie maritime. Simone, qui avait eu un temps des velléités d’être chanteuse, s’était mariée à Toni et avait donné à la famille ce qu’elle attendait d’elle, trois enfants. Quant à Roger, le dernier, il était pianiste de jazz dans des night-clubs marseillais et, le jour, il aidait à la gestion de la pizzeria de ses beaux-parents. Pour lui, la famille avait financé des cours, le conservatoire. Il a été le seul de la fratrie à recevoir une formation. Tous les autres ont quitté l’école à la fin du primaire et sans Certificat d’Études.
Je repense à Catali et à sa plaisanterie sur mon porte-monnaie... Et je reviens à ma famille paternelle. Le grand-père Zè était né vers 1885. Il avait onze ans à son arrivée en France. Une fratrie de Belmonte, les frères, leurs épouses et leurs enfants respectifs avaient entrepris le voyage de l’émigration vers la France depuis un hameau de la campagne de Reggio de Calabre jusqu’à Marseille. L’inénarrable oncle Rosario – dont la gourmandise, l’appétit insatiable, la générosité et la propension au gaspillage sont restés dans les annales – était le frère de mon grand-père. Jusqu’à sa mort et malgré sa réussite sociale en France avec son entreprise de ferblanterie très prospère, il avait gardé ses habitudes vestimentaires de Calabrais pauvre, ma génération parle encore d’une ficelle qui tenait son pantalon à laquelle il n’a jamais renoncé. Verdict de la famille si pointilleuse sur les apparences, si soucieuse de correction, d’élégance et de bon goût : « Il est fada !» Lorsque ma mère était arrivée jeune mariée à Marseille, les cousines de mon père, les filles de Rosario, l’avaient accueillie avec des tarentelles qu’elles avaient jouées au piano, de la jolie vaisselle et des nappes. Dans cette famille qui pourtant devait rester logée en location jusqu’au milieu des années soixante-dix dans un bel appartement au 29 rue de la Fare de ce quartier Belzunce alors parmi les plus pauvres et les plus dégradés et insalubres de la ville, rien n’était plus important que les beaux objets, les habits du dimanche, les habits de fête, les habits pour les mariages, les communions, les deuils et aussi, oui, le lustre des chaussures ! Mon grand-père était devenu employé de la ville de Marseille, cantonnier, une promotion en quelque sorte dans sa catégorie et dans son esprit car il était devenu fonctionnaire. En tant que petits-enfants de cantonnier de la ville de Marseille, nous avions des prérogatives qui nous distinguaient dans le quartier, comme l’accès à la plage des Prophètes, un temps réservée aux employés de la ville. C’est dire si nous étions français.
Même si nous nous sommes détournés de cette culture d’origine, certainement trop associée à la pauvreté, en y réfléchissant, je me rends compte que j’ai gardé et conserve aujourd’hui consciemment les éléments plaisants de cette racine italienne. Ma surprise amusée à la naissance de mon fils aîné, les cheveux noirs, la peau très brune, les yeux déjà bruns alors que trois de ses grands-parents avaient les yeux bleus et les cheveux clairs. Je ne m’y attendais pas. Et ma fille n’est pas plus blonde... Les fêtes de famille de mon enfance marseillaise, les tablées bruyantes chez tonton Jeannot, les enfants en liberté, les voix qui parlaient haut, ma mère : « Arrêtez de crier ! – On ne crie pas, on discute ! ». Les cours de dégustation de spaghetti dispensés par Annie, l’aînée des cousines qui nous reprochait de les aspirer « comme des Français », les chansons aux repas – et on ne doutait de rien ni dans la famille Belmonte ni dans le reste du quartier d’ailleurs, on s’attaquait au lyrique avec le plus grand naturel. Je me souviens d’avoir chanté un petit air de Mozart debout sur la table à la fin du repas de noces de mon oncle Roger, j’avais cinq ans, mon père m’avait déposée sur la table : « Il faut faire chanter la petite », une véritable gloire ; ensuite, on me l’avait souvent réclamé et je ne me faisais jamais prier, surtout si c’était mon jeune oncle pianiste qui me le demandait. Dans la famille de ma mère, à Pignan dans l’Hérault, on chantait des chansons traditionnelles, pas du lyrique, et on n’encourageait pas les petites-filles à monter sur la table mais plutôt à chanter à la messe ! Aujourd’hui, c’est incontestablement en italien que j’ai le plus de plaisir à chanter, puisque je chante toujours. J’adorais les réunions de tribus, surtout avec les Papatico, la famille de Toni, arrivée en France plus récemment, avec sa maison ouverte, pleine, ses enfants libres comme l’air qui couraient partout et ses généreuses marmites de pâtes en sauce, avec beaucoup de sauce ! Comment ai-je pu ne pas identifier immédiatement avec clarté cette empreinte culinaire laissée sur mon père, sur mon frère et sur moi ? Les pizzas maison, le rejet dégoûté devant les « dérivés écœurants du supermarché » ou même de certains « pizzaïolos de fortune », les sauces associées à un type de pâte bien défini, « faut pas faire n’importe quoi », les cannelloni, le mythe des ravioli maison, les pâtes qui doivent être cuites d’une certaine façon, mon agacement quand quelqu’un les rate – idem pour le riz –, mon père les testant en les lançant sur le carrelage mural de la cuisine, « si elle colle, c’est bon ! », le cérémonial du minutage à la seconde près – mon frère le fait encore. La charcuterie et le fromage ! À Pignan, c’était la saucisse sèche, le jambon glacé, le jambon cru et le table (le cantal) ou le Roquefort ; à Marseille, il y avait des épiceries et des charcuteries italiennes avec toutes sortes de variétés de saucissons, de chapelets de saucisses, de petits fromages rigolos ! On y allait avec tata Rose, on était remplis rien qu’à y entrer ! Et les gâteaux ! Même si ma famille côté Languedoc était gourmande et très généreuse, sa pratique des desserts était simple en comparaison de celle des Belmonte. À Pignan, pour une fête, on commandait un moka et un mille-feuille – ainsi, disait-on, il y en aurait pour tous les goûts –, pour une cérémonie, c’était une pièce-montée, en janvier, il y avait le royaume et le reste de l’année, c’était des gâteaux ou des desserts traditionnels fabriqués à la maison. On préférait le salé. Mais à Marseille, déjà, il y avait des gâteaux à la crème du pâtissier souvent le dimanche. C’était le rôle de mon père d’aller les chercher et ils étaient toujours variés et il y en avait beaucoup. Les princesses au chocolat – avec des cerises confites dans le Kirsch noyées dans une crème de chocolat moelleuse et ferme à la fois dont la couverture croquait –, les petits cochons, les figues et les pommes de terre en pâte d’amande, les oursins – un gros chou au chocolat couvert de pépites de chocolat luisantes –, les pêches – deux oreillons d’une pâte à brioche très compacte soudés par une crème à la vanille et nappés de sucre avec deux jolies feuilles en pâte d’amande verte au sommet –, les choux au caramel, les choux à la Chantilly en forme de cygnes, les religieuses au chocolat ou au café, les éclairs – vanille, chocolat, café –, les mille-feuilles, les tartes aux fruits et à la crème. Et les gros gâteaux à la crème, les Saint-Honoré, les Colombiers de Pentecôte, l’église en nougatine du Mariage « hollywoodien » de tonton Roger ! Les dragées ! Les dragées n’étaient pas aussi étroitement associées à la pratique religieuse que dans ma famille languedocienne ni leur protocole aussi prévisible. Et les glaces, les cornets, les tranches, les cassates, les plombières, mettre une glace à la vanille dans une brioche ! Pour une cérémonie, pour une fête, à Pignan, on s’habillait de neuf et on mettait les petits plats dans les grands, beaucoup de petits plats dans les grands, mais la famille de Marseille jetait l’argent par les fenêtres : les costumes des hommes et les tenues de ces dames, les talons aiguilles de leurs escarpins, leurs chignons crêpés et leurs maquillages noirs très appuyés, j’ai le souvenir du mariage de mon oncle Roger avec Simone, la fille des Staggiano qui tenaient une pizzeria derrière le Vieux-Port : les corbeilles de fleurs – œillets, roses, arums et gypsophile –, la grande robe avec la traîne, l’orchestre, les grandes orgues ! Sur les photos, les petites demoiselles d’honneur dont je fais partie portent des robes de dentelle blanche en décalage avec les moyens réels des parents, mais quel souvenir !
Même le mariage de mes parents survenu une dizaine d’années avant, alors que la famille n’était pas au mieux de ses finances, laisse des photos dignes d’un mariage bourgeois. Encore aujourd’hui, dans mon esprit, un beau marié doit porter un costume noir et un œillet à la boutonnière et je revois amusée mon frère, le jour du sien, sur le pas de la porte de la maison familiale de Pignan, costume noir, chaussures impeccablement cirées, coupe de cheveux à la Mastroianni, comme nos oncles, comme mon père sur sa photo de mariage. Et je pense à mon père, m’apportant un kilo de dragées et une grosse tarte à la maternité le jour de la naissance de mon fils aîné, son premier petit-fils. Il a été le premier visiteur de la journée : « j’en ai pris un kilo, il faut en offrir à tous ceux qui te rendront visite ! ». Et je repense à mon grand-père calabrais et à ses sorties sur le citron de Calabre. Un jour, en suivant l’émission de la célèbre cuisinière Sarah Wiener dans son tour d’Italie, j’apprends qu’il y a de gros citrons en Calabre, énormes ! « Pépé de Marseille, je retire toutes mes moqueries d’enfant, c’était vrai ! » Les origines aristocratiques des Belmonte ? Le résultat des recherches est moins convaincant. Il y a bien un château Belmonte dans la région de Reggio, revendu au XVe siècle par un nobliau ruiné, mais je crains qu’il n’ait rien à voir avec nous, pas plus que le cardinal Belmonte dont parle le personnage de vieil aristocrate ramassé ivre dans la rue, sous un monument, dans les premières séquences du film Les nouveaux monstres de Dino Risi. Et je croise Catali, ma copine corse, professeur d’italien, un dimanche à la pâtisserie Scholler, une des meilleures de Montpellier. Je la taquine : « Quoi ? Tu viens tous les dimanches de Prades pour prendre des gâteaux ici ? » Elle assume : « la pâtisserie, ça ne souffre aucune médiocrité. – Catali, tu ne serais pas un peu italienne ? »
