De l’art d’épouser qui l’on souhaite épouser, même si le destin vous a fait naître fille dans une famille de paysans piémontais à la fin du XIXe siècle
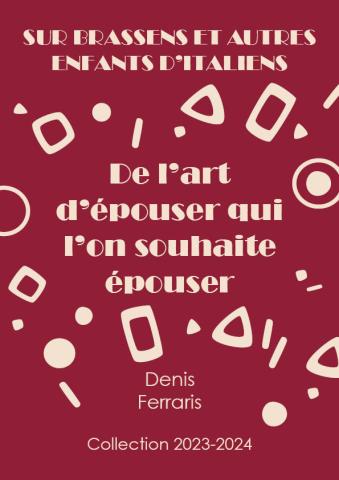
De l'art d'épouser qui l'on souhaite épouser, même si le destin vous a fait naître fille dans une famille de paysans piémontais à la fin du XIXe siècle
J’ai été élevé par ma grand-mère maternelle à Nice (Nizza marittima, disaient mes amis piémontais pour qui il n’y avait qu’une vraie Nice : Nizza Monferrato dite aussi Nizza della paglia). Quand ma mère fut sur le point d’accoucher (au début de 1947), elle décida que la petite charcuterie qu’elle tenait avec une tante et mon père dans le quartier du port rapportait bien assez pour qu’on retirât – je me permets d’employer ce verbe, un peu brutal, car ma mère était une catholique progressiste au verbe haut et incisif et à la poigne sans tremblement – sa mère de la petite fabrique – on disait ainsi – où elle participait au façonnage de chaussures qui ne devaient pas être du haut de gamme. Il est vrai que les conditions de vie de toute la famille étaient depuis toujours si spartiates qu’il suffisait de pouvoir mettre à la disposition de ma grand-mère une petite chambre afin qu’elle s’occupât de moi du soir au matin et du matin au soir. Quant à la nourriture, on s’en remettait à la formule usuelle dans le petit commerce de bouche : « Quand il y en a pour cinq (inclure mon frère aîné et ma présence à venir), il y en a pour six. » Pour ce qui était des vêtements, ma grand-mère portait une robe noire boutonnée sur le col du premier janvier au trente et un décembre – oui, même l’été, à Nice… Elle devait en avoir deux ou trois exemplaires, à peine différentes l’une de l’autre, et à quatre-vingt-dix ans s’obstinait toujours à les laver elle-même à la main (elle n’avait pas confiance dans les machines qui, selon elle, affaiblissaient les fibres et les couleurs et obligeaient ainsi à des dépenses aussi fréquentes qu’inutiles). Elle était née en 1896 dans une assez grande ferme située à l’écart d’un village, San Michele, près d’Alessandria (elle aussi dite della paglia en raison du mortier de terre et de paille – sorte de pisé – dans lequel étaient construites la plupart des maisons). Comme je ne parviens plus, depuis longtemps, à trouver la moindre trace de cette commune sur un document topographique, je dois supposer qu’elle a été littéralement rayée de la carte par la construction d’un énorme nœud autoroutier (celui qui se trouve au croisement de lʼA21 avec lʼA26, me semble-t-il). Pour des raisons que je n’ai jamais pu connaître – mystère des orientations individuelles ? –, ma grand-mère avait commencé, dès sa plus tendre enfance, à développer une haine et un dégoût violents pour tout ce qui pouvait évoquer, de près ou de loin, la campagne. Il y faisait toujours beaucoup trop froid ou beaucoup trop chaud – ce qui est à peine exagéré quand on connaît le climat de sa région natale –, le brouillard à couper au couteau pendant de nombreux mois de l’année vous transperçait le corps jusqu’à la moelle et vous rendait phtisique – inutile d’essayer de lui dire que ce n’est pas très exact du point de vue biologique –, on risquait à tout instant de se noyer dans un fossé ou une rivière ou bien de se rompre le cou en tombant d’une meule de foin ou d’un grenier, de se faire mordre par une vipère et piquer par des moustiques ; quant aux animaux de la ferme, même les plus paisibles a priori, comme les vaches, ils ne songeaient qu’à vous encorner au premier moment d’inattention. Quand elle fut nubile, on décida de la marier au fils de vignerons voisins – cette union compléterait heureusement la production familiale puisque mes arrière-grands-parents ne possédaient aucun arpent de vignes. On, cʼétait mon arrière-grand-mère : quand je regarde l’unique photo d’elle que je possède, je suis fasciné par la beauté de son visage et terrifié par la dureté de son regard qui me donne envie de rentrer sous terre.
Son époux était un être bien trop doux pour diriger une ferme et sa population, notamment depuis qu’une grave chute du haut d’une charrette de foin (voir, plus haut, l’une des accusations de ma grand-mère contre cette chienne de campagne) lui avait brisé l’échine : du coup, il s’était paisiblement réfugié dans le rôle – je pense aux nouvelles de Sand et de Nievo – du conteur vespéral et du fabricant de poupées pour les filles – prière, ici, d’imaginer un instant dans quel mépris cosmique son austerissime et redoutable épouse l’avait dès lors définitivement tenu ; comme quoi, il ne suffit pas de tenir un discours, selon l’expression barthésienne, pour tenir le haut du pavé chez soi : il y a discours et discours… Ma grand-mère portait – du moins dans sa famille – le doux prénom de la protagoniste du livret du Barbier de Séville : Rosina. Comme cette dernière, elle pouvait être una volpe soprafina. Ah, sa mère voulait la marier à un bouseux et l’attacher ainsi pour le restant de ces jours à cette glèbe honnie ? Elle allait voir qu’il n’y avait pas qu’elle à être dotée d’une âme en carbure de tungstène et d’une personnalité bâtie à chaud et à sable. Elle décida donc de mettre sa mère devant un fait accompli, irrémédiable et irréversible – du moins, selon elle : se retrouver enceinte des œuvres d’un individu qui n’aurait rien à voir, mais alors vraiment rien à voir, avec la campagne. Justement, le monde étant parfois bien fait pour una volpe soprafina, depuis quelque temps, il y avait dans le coin un charmant garçon qui semblait pratiquer une sorte de nomadisme professionnel dans les métiers du bâtiment – comme nous dirions maintenant. On l’aura compris – ce que femme veut, Éros le peut – ce charmant garçon – il ne se doutait de rien, alors, l’innocent – était destiné à devenir mon grand-père maternel. Il était né en 1892 – donc, quatre ans avant sa potentielle fiancée – dans un patelin de l’arrière-pays vénitien, lui aussi dans une ferme. Autour de 1896, sa famille, qui ne devait pas être loin de mourir de faim, émigra au Brésil – forcément, si j’ose dire – dans l’intérieur des terres de la région de São Paulo où, durant quatre ans, elle se nourrit de tatous et de cabiais – façon pudique et détournée de dire qu’elle mangea de la vache enragée – et rentra ensuite, la queue basse, au pays natal. Comme ma seule source d’information en la matière était mon grand-père et que celui-ci – plus fort que Tabucchi, sur ce plan là – avait la mémoire complètement laminée par son imagination, il me fut impossible de savoir pourquoi exactement ses parents, au retour, s’arrêtèrent dans le sud du Piémont. Je suppose – mais je suis très ignorant, je l’avoue, en matière de flux migratoires – qu’une fois que le paquebot les eut débarqués, plus miséreux que jamais, à Gênes, ils allèrent déposer leur maigre balluchon dans la première campagne qui pût leur rappeler vaguement la leur et leur permettre de se proposer comme force de travail – et la Ligurie avec ses horticulteurs et floriculteurs – voir, à ce sujet, un intéressant chapitre de la version longue de La speculazione edilizia de Calvino – dut leur sembler bien trop chic et même un peu un peu trop chichiteuse. Mon futur grand-père était alors ce qu’on est convenu d’appeler un joli garçon qui songeait essentiellement à prendre le plus de bon temps possible, le dimanche, en compagnie de camarades de travail avec lesquels il dépensait sa semaine dans des guinguettes (ou équivalents) des environs – on a compris que je cite, indirectement, cette langue de vipère qu’était, dans cet exercice mémoriel, mon adorée grand-mère. Surtout, il portait autour du cou – je le vois, ou plutôt, le devine, sur une photo de l’époque, évidemment en noir et blanc, prise sous la tonnelle d’un caboulot – un petit foulard rouge noué autour du cou – le genre Renaud, première manière. Socialiste, le grand-père ? Non, ni conservateur au demeurant : scandaleusement individualiste – le petit foulard rouge ne pouvant honnêtement être présenté, vu sa dimension, comme un linge permettant d’essuyer sa sueur, je suis forcé d’en conclure que Dieu ou Aphrodite avait suggéré à mon aïeul cette pure coquetterie afin d’attirer l’œil de ma grand-mère. Mais l’essentiel, on l’a compris, était que ce charmant garçon n’avait manifestement rien à voir avec la campagne : on ne pouvait savoir dans quoi on s’embarquait en le suivant mais on ne finirait certainement pas dans l’eau boueuse des fossés d’irrigation. Ma grand-mère le convainquit donc – version tout à fait officielle, maintes fois attestée dans le roman familial – de s’étendre avec elle sur un virginal et épais manteau de neige fraîche non loin de la ferme natale. Pourquoi, me direz-vous, ne pas attendre le printemps ou, plutôt, la fin du printemps pour pratiquer ce genre d’activité vieux comme le monde ? Peut-être songez-vous, ici, à une scandaleuse réplique concoctée par Michel Audiard pour les dialogues du film de Miller Garde à vue ? (âmes sensibles et élégantes, passez votre chemin, au moins jusqu’à la phrase suivante) : « Bander par un froid pareil, faut ʼl faire ! » Vous pensez bien que dès que je me sentis assez alerte psychiquement et verbalement pour avancer cette question, frileuse et misérablement conventionnelle, face à ma grand-mère (disons : dans les années soixante), je le fis. Et vous pressentez la réponse : il y a des choses qui n’attendent pas (le fils du vigneron était une menace terrible que vous avez tout à fait le droit d’associer à un éventuel désir on ne peut plus naturel de ma chère grand-mère : on n’agit pas toujours, heureusement, en réaction négative par rapport à une crainte fondée ou imaginaire). Au meilleur moment de cette rencontre – rêvons un instant –, se fit entendre un bruit caractéristique (ne m’objectez pas que lorsqu’on est « dans cette situation-là » on n’entend plus rien en provenance du monde extérieur : j’essaie seulement de reproduire, le plus fidèlement possible, la narration obstinée de mes grands-parents). El vapur ! Mais oui : la couche de neige était si épaisse qu’elle avait fait perdre au paysage environnant ses formes repérables et les deux adolescents – le substantif vaut surtout pour ma grand-mère qui avait alors l’âge statistiquement réglementaire pour ce déduit-là, à savoir seize ans – s’étaient allongés sur la voie du chemin de fer. Comme le train, à cette époque-là, n’avait rien d’un TGV dans son allure, ils avaient eu largement le temps de se sauver en glissant du remblai dans le fossé. J’entends encore le merveilleux éclat de rire de mon grand-père, la première fois que j’osai lui demander – en quels termes alambiqués ? – confirmation de l’anecdote. Oui, cela s’était bien passé ainsi. Oui, ma grand-mère était déterminée à tout (ou presque) pour échapper au bouseux vigneron. Même, précisa le grand-père, que lorsqu’el vapur eut passé son chemin avec son train de sénateur, la jeune fille obligea – grand-père, voyons, nous frisons là la misogynie… – son partenaire à remonter sur le talus (la neige avait dû demeurer entre les rails) pour reprendre l’activité en question afin d’augmenter les probabilités de survenue d’une grossesse à mettre sous les yeux ulcérés de mon arrière-grand-mère. Malgré tous ces efforts, la grossesse n’arriva pas cette fois-là mais ma grand-mère put agiter assez violemment son spectre sous les yeux maternels pour échapper à la campagne maudite et emporter haut la main le charmant garçon au foulard rouge. Ce petit foulard rouge, objet a priori frivole sinon futile, va jouer, que cela me plaise ou non, un rôle certain dans la dramaturgie qui préside à ma triste apparition en ce monde de larmes. Et quand le hasard fit que le premier texte qu’on me donna à étudier de façon un peu approfondie au début de mes études universitaires fut l’archicélèbre nouvelle de Verga Cavalleria rusticana, je me dis, lorsque j’arrivai au passage dans lequel le narrateur raconte que la nappa del berretto de Turiddu aveva fatto il solletico dentro il cuore de Santa : « Finalement, c’est de là que je viens, en quelque sorte… ».
Dix années passent. Je vous entends : pour un ancien directeur de recherche, c’est un peu vague comme indication. Mais ma seule source familiale à peu près fiable, ma mère, était une enfant à l’époque : impossible d’avoir une date précise (ma mère est l’une des rares personnes au monde qui fût capable à mes yeux, en toutes circonstances, d’avouer très simplement son ignorance). Seule certitude : nous sommes autour de 1920. Mes grands-parents vivent en ville, à Alessandria (je n’ai jamais osé demander à ma grand-mère si c’était vraiment mieux qu’à San Michele). Ils travaillent en usine. Surviennent des mouvements sociaux. Rien à tirer de mon grand-père, toujours dans les années soixante, quand je commence à devenir un italianiste en culottes courtes et essaie, petitement, de compléter les informations livresques par des confidences intrafamiliales. Son système de vie à base d’éclats de rire pagnolesques et de clins d’œil malicieux ne connaît plus aucune faille : je n’obtiendrais de lui, si je m’avisais d’insister, que des galéjades car il a banni de sa vie tout ce qui peut être un tout petit peu sérieux : il dit laisser cela aux femmes (à son épouse et, surtout, à sa fille qui, à l’entendre, tient au plus haut la bannière du matriarcat) et grand bien leur fasse ! Donc, écoutons ma grand-mère. Dans son cas, ce n’est pas l’imagination qui terrasse la mémoire mais l’idéologie (si, si, pour une fois, vraiment dans l’acception marxienne de la notion ou du concept, comme vous voulez – et que lui jettent la première pierre toutes celles et tous ceux qui sont persuadé(e)s n’être jamais trompé(e)s par l’idéologie). « Tu connais ton grand-père : toujours à faire le mariole. Les patrons ont fermé les usines. Les ouvriers les ont occupées et ont cru pouvoir les gérer eux-mêmes et se passer des patrons ! » J’ouvre une parenthèse littéraire : j’ai pensé à elle, immédiatement, la première fois que j’ai lu, dans Senilità, le passage, sans doute en grande partie autobiographique, où le protagoniste socialisant de Svevo doit s’avouer vaincu par la réaction d’Angiolina, fille du peuple qui méprise le peuple car « les ouvriers sont tous des fainéants ! » – je cite de mémoire. « Très vite, les ouvriers n’ont plus reçu d’approvisionnement et, de toute façon, ils se disputaient entre eux et ne savaient pas comment on dirige une entreprise ! Ils ont bien dû abandonner l’usine les uns après les autres. Quand Dieu voulut, les patrons ont commencé à rouvrir les usines et à reprendre les ouvriers mais très prudemment : d’abord les plus dociles et ceux qui ne s’étaient pas fait remarquer. Puis ceux qui faisaient, sincèrement ou non, amende honorable. Les autres sont restés sur le carreau, à commencer par ton grand-père ! » Elle sortait alors une vieille photo bien jaunie qu’elle a fini par détruire hélas et je m’accuse ici de ne pas avoir songé tout de suite à la lui piquer car j’aurais dû me douter du sort qui attendait ce document entre ses mains. On y voyait une cour et un fronton d’usine de taille modeste. Un peu partout, des ouvriers regardant l’objectif. En haut, au milieu, juché à la pointe sommitale du tympan de la façade, se tenant nonchalamment à une sorte de hampe dans une posture déhanchée, presque maniérée, un sourire suavement vénitien aux lèvres, mon grand-père avec, autour du cou, son fameux foulard… « Rouge, le foulard ! » précisait ma grand-mère en haussant le ton et en me regardant bien droit dans les yeux car elle m’aimait beaucoup, j’en suis persuadé, comme elle aimait son cabochard d’époux, mais était persuadée que je tenais de lui, précisément, et donc que j’étais toujours con la testa nel sacco, incapable de me concentrer et de suivre jusqu’au bout le moindre raisonnement, en sorte que sa fille avait tort, un torto marcio, de s’obstiner à vouloir prendre une revanche sociale en faisant de moi un professeur car, étourdi et vain comme j’étais, je ne pourrais, avec ce métier, que faire mon propre malheur et, bien pire, le malheur d’innombrables élèves… À la suite de ce lock-out finalement réussi, mes grands-parents émigrèrent clandestinement et nuitamment – récit apocalyptique de ma mère retrouvant miraculeusement la mémoire pour ces moments-là – vers Nice où se trouvait déjà un autre esprit vain et cabochard, mi-ligure (Bordighera et Sanremo) mi-piémontais (Asti), que le destin facétieux avait placé sur le chemin de ma mère exactement comme Svevo mit Zeno face à Augusta dans un couloir fatal.
