Des fleurs, des fleurs pour toute la vie
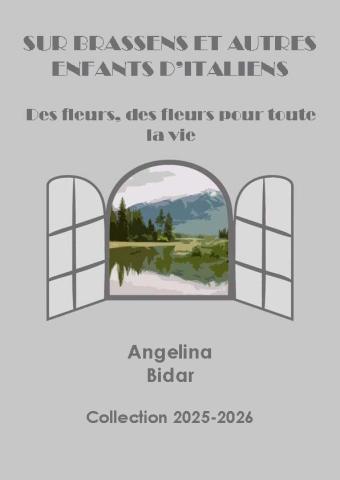
Portée et bercée dans mon enfance par la langue italienne, et plus précisément par le dialecte
sicilien, j’ai connu plus tardivement la musique de la langue et de la littérature françaises.
C’est en apprenant le français à l’école de la République, à l’âge de cinq ans, que la lecture a
été une Révélation. Cependant, je me devais de connaître aussi mes racines en étudiant les
illustres auteurs que sont Dante Alighieri, Petrarca, Goldoni, Leopardi ou encore Manzoni,
Pirandello... Je ne pouvais me sentir « entière » qu’en enrichissant un tableau complexe : j’aime
autant la littérature et la langue italiennes que la littérature et la langue françaises, n’en déplaise
à Monsieur du Bellay ; si certains auteurs, tel Henri Beyle ont été « ravis » par le mythe italien, j’ai
été éblouie et transportée par l’écriture magistrale des écrivains français : de Flaubert à Proust,
de Victor Hugo à Aragon, Camus… Je les aime tous ! Il était important pour moi de concrétiser
cette harmonie et ne plus courir après ma deuxième moitié comme le visconte dimezzato d’Italo
Calvino. Aujourd’hui, je me sens « entière » en enseignant ces deux belles langues, et avec
passion.
Angeliiiina… Angie… Tour à tour ces prénoms ont résonné jusqu’à mon adolescence. Je
suis la troisième d’une fratrie de six enfants ; mon frère aîné a sauvé la lignée et mon père s’est
toujours enorgueilli d’exhiber sa progéniture féminine ; je nous avais baptisé son Fan Club. Un
été, dans le train qui l’emmenait en Sicile pour des vacances, un voyageur rétorqua à mon père
qui nous revendiquait avec fierté : « Oh mon Dieu, combien de paires de draps ! » Cinq filles…
j’étais la seconde, d’où l’heureux héritage du prénom de mon aïeule maternelle, Angela. Les
trois premiers enfants ont prolongé la tradition et portent les prénoms des grands-parents. Notre
cousine Thérèse installée en France depuis peu, désignée marraine de ma petite sœur, ne voulut
pas l’affubler du prénom d’Antoinette, nom honorable de mon grand-père nonno Nino. À ce
prénom désuet et suranné, elle préféra Daniela qui swinguait et correspondait à l’air du temps.
C’était là le premier signe d’intégration de mes parents !
Mon père, d’un caractère enjoué, carapace qu’il se donnait pour occulter sa pudeur, évoquait
avec malice mes origines paradoxales : la Belge che ha la pelle nera com’a pajjia de fave, conçue en
Sicile et née en 1959 à Liège en Belgique. Jour particulier que la date de ma naissance : 17 août.
Quel grand malheur que de naître un 17. Maman, ayant accouché à la maison, voulait me
déclarer le 18, mais la levatrice, la sage femme, s’y opposa et ainsi mon parrain et ma marraine
siciliens belges m’ont offert pour mon baptême un crucifix, bien sûr, mais aussi une médaille
représentant le chiffre 13 !
Ma mère, femme très fine et posée, dotée de l’intelligence des « pauvres », parlant à bon
escient, avait rejoint mon père à l’âge de vingt-quatre ans, emmenant mon frère de cinq ans et
ma sœur de trois ans. La Sicile, terre de douleur, où il n’y a que des cailloux, selon l’expression
de mon père, ne nourrissait plus cette famille de quatre personnes. Mon père n’avait pas
vraiment choisi la Belgique en 1956 et c’est en arrivant à la frontière qu’en fonction des besoins
des entrepreneurs on devenait carreleur ou maçon ou mineur.
Quatre ou cinq ans au fond des mines de Belgique ! Au grand désespoir de maman, qui
avait perdu son beau-frère dans la catastrophe minière de 1956. Sa sœur veuve, Zi’ Pippina, était
enceinte de son troisième enfant lorsqu’elle perdit son mari ; un jour en regardant des photos de
famille avec sa fille, ma cousine Thérèse, j’ai découvert une femme très belle, à l’allure distinguée.
De longues nattes encadraient un visage poupin : c’était ma tante ! Je ne lui connaissais que ses
cheveux courts austères : elle avait coupé ses beaux cheveux longs qui marquaient sa féminité et
sa sensualité. J’ai toujours adoré passer quelques jours de vacances chez elle, en compagnie de
ma cousine. Ma tante adorait danser et elle m’a appris le cha-cha-cha, la mazurka, la valse, alors
que maman avait d’autres préoccupations avec ses six enfants ! Je dansais comme une folle sur
les rythmes endiablés des années yéyé avec ma cousine qui avait toujours les derniers 45 tours.
La pension de veuve des mines de Belgique permettait à ma tante de vivre correctement ; elle
avait le sérieux de ces femmes siciliennes qui ne demandent jamais rien et elle ne s’est jamais
remariée. Elle tenait le rang de femme respectée et respectable quoiqu’elle fasse.
En 1961, naissance de ma sœur Daniela. Mes parents ont quitté la Belgique pour une
ville frontalière de la Lorraine où mon frère et ma sœur pourraient suivre une scolarité moins
décousue : Forbach. Papa part travailler en déplacement, dans le bâtiment en Allemagne, puis en
Alsace, à Strasbourg, et rentre après ses missions. Ces années restent ancrées dans ma mémoire :
heureuses mais très pauvres. Toute la chaleur de la communauté italienne : nous vivions dans
les baracche, sans eau chaude, sans électricité, réchauffés par un immense poêle à charbon où
trônait une bouilloire d’eau pour nous décrasser chaque soir et les toilettes dehors dans le froid
cinglant ou la nuit noire. Le soir nous mangions souvent à la lueur de la lampe à pétrole ou des
bougies.
Nous vivions entre enfants italiens et, n’allant pas encore à l’école, je ne connaissais pas
de petits Français. Je ne connaissais pas encore la discrimination, les brimades et ce fut une
période insouciante de l’enfance.
Les hivers rigoureux, le froid, la neige : je me rappelle ce vin chaud et sucré que maman nous
servait après nos escapades ou encore deux gorgées de ce délicieux café parfumé de rhum ! Nous
improvisions de belles parties de luge avec la bêche de papa, à en mourir de rire, et des parties
de boules de neige. Plus loin, le linge dur comme de la pierre devenait glace sous le vent glacial.
Maman avait les mains bleues à force de laver le linge, au savon de Marseille, sur la pila : elle ne
se plaignait jamais ! Elle était issue de ce monde paysan sicilien pudique qui parle peu.
Tout autour, la campagne et les grillages qui entouraient les mines pour nous empêcher d’y
étendre nos terrains de jeu. Prudence ou couardise, je ne m’aventurais jamais seule au-delà des
grillages ; maman m’en avait dissuadée en me parlant du « monsieur au sac » qui emmenait les
enfants désobéissants. En effet comment préserver ses enfants, qui grandissent dans la nature
tels des étourneaux, qu’on ne peut sans arrêt retenir à la maison, où manquent tous les éléments
culturels : livres, stylo, cahiers, jouets… Quand j’étais toute petite, les jeux de cartes animaient
nos soirées, scopa, briscola, sette e mezzo, et des haricots secs rouges ou des fèves servaient de mise.
Oh maman, c’était extraordinaire : tu nous servais une griotte sucrée de tes fameux bocaux, que
tu préparais avec amour chaque année.
Les premiers jours de novembre consacrés aux morts, nous avons appris que papa avait une
petite sœur Graziella morte jeune emportée par une maladie et je revois l’unique photo de la
petite toute de blanc vêtue pour sa première communion Nous faisions aussi une petite prière
pour la mère de papa qu’il avait perdue à l’âge de dix ans. Tout cela dans la joie et le sérieux,
puisque nous avions un tout petit cadeau ce jour-là. Je voulais une poupée et j’ai eu un tout petit
baigneur ! Jusqu’à l’adolescence, j’ai dit toutes mes prières tournée vers l’image d’une Vierge à
l’enfant que ma mère remplaça ensuite par un crucifix gris.
Noël embaumait la cuisine pendant trois semaines : je t’avais regardée découper à la scie
le manche d’un balai en bois pour façonner les écorces des cannolli. Tu les faisais comme je les
aimais ! Du four s’exhalait l’odeur de sablé (tu ne les faisais pas frire) et, le jour de Noël, tu les
remplissais de crème pâtissière ou de ricotta sucrée.
L’été, c’étaient les maraudes aux cerises, aux fraises, aux mirabelles : nous étions les petits
chenapans du coin. Mon frère, rapide et casse-cou, grimpait à la cime des arbres et nous
attendions avec ma grande sœur, la robe prête à accueillir les fruits verts, acides et rarement
mûrs. En m’efforçant, je revois la silhouette de l’un de nos voisins, le ventre trop gros pour lever
la tête, ne pouvant voir mon frère ni nous rattraper. Je passais de longs moments à observer la
nature, couchée dans l’herbe : les fourmis, les moineaux, les fleurs, les champignons. J’aimais
courir, gambader, sauter à la grande corde, gratter la terre, chanter à tue tête avec ma sœur les
dernières chansons du hit-parade d’Europe 1.
Nous avions un petit transistor rouge à piles : maman écoutait très tôt chaque matin, tandis
que l’odeur du café envahissait la cuisine, la station France inter. Nous avions le droit de le coller
à l’oreille de 16 à 17 heures pour les chansons et SLC « Salut les copains » (il ne fallait pas user
trop vite les piles !).
Et puis ce fut la rentrée en grande section maternelle, j’avais cinq ans… Un nouveau monde,
une nouvelle langue, d’autres centres d’intérêts. Pourquoi ma mère ne m’avait-elle pas inscrite
à l’école avant ? Je lui en voulus plusieurs années plus tard. Elle ne pouvait m’accompagner car
elle devait s’occuper de mes deux petites sœurs aux naissances rapprochées : dix-huit mois de
différence.
J’étais avide de connaître, je ne parlais pas français, mais tout me paraissait facile : associer
les lettres, les couleurs, dessiner, compter… J’aimais les livres, les histoires, les belles images,
cette recherche du décodage des mots… Maman, le soir, tu écoutais et tu suivais nos lectures
attentivement et… au collège et au lycée tu venais emprunter nos livres de poche et tu partais toi
aussi avec le « Sous-Préfet aux champs », tu riais de « La mule du pape » ou des « trois messes
basses » d’Alphonse Daudet. Et que dire quand je t’ai surprise dans la lecture de Stendhal, Le
Rouge et le noir, ou encore de Flaubert, Madame Bovary.
Des livres que je ne lisais pas encore, mais toi oui.
Maman était de la génération des filles que je définis « sacrifiées » : née en 1935, elle avait
connu la guerre et se rappelait la présence des Allemands en Sicile. À la fin de la guerre, les
filles travaillent aux champs et à la maison et elles ne vont pas à l’école. Son grand regret ! C’est
à Catane, à quatorze ans, qu’elle ne laissera pas passer l’opportunité de profiter des cahiers de
son neveu pour apprendre à lire et écrire toute seule, à la dérobée : elle quitte la campagne trop
misérable, pour vivre et travailler en ville avec sa grande sœur Maria et le fils de celle-ci.
À la maison, maman s’occupait de tout : l’éducation, la gestion de l’argent, l’organisation de
la maison, elle avait des doigts de fée et cousait, tricotait… Elle confectionnait presque tous nos
vêtements. Souvent je partais avec elle pour choisir un coupon de tissu.
J’aimais l’école pour tout ce que je ne pouvais avoir à la maison : la pâte à modeler, la
peinture, les cahiers, l’odeur de l’encre, les crayons… Colorier, regarder des images, avoir des
bons points pour obtenir de belles images, lire, chanter, aller chercher la caisse de bouteilles
de lait chocolaté et le boire à l’école, se déguiser et, aux fêtes importantes, fabriquer des objets
à offrir à maman, où j’aurais mis toute mon ardeur et mon application, écouter des histoires :
pour moi c’était Noël tous les jours. Je me rappelle encore du nom de mes deux premières
maîtresses : Madame Mouton et mademoiselle Hartman (mais pas des autres). C’était l’époque
où les premiers de classe recevaient des livres. Mon prix de troisième de la classe en CP : Les
deux nigauds de la Comtesse de Ségur en bibliothèque rose qui a été mon premier livre ; telle une
relique, je l’ai longtemps conservé. Il n’y pas de place pour les livres lorsqu’il n’y pas d’argent.
Ma dernière petite sœur est née en 1967 dans la Loire. Révolution dans la famille ! Mes
parents avaient accepté de déclarer cette petite dernière Française, selon la loi du sol qui venait
d’être votée en France. Nous avons quitté les baraques de la Moselle pour nous rapprocher des
sœurs de maman et, en outre, il nonno e la nonna de Sicile venaient s’installer en France à côté de
la Zi’ Pippina qui avait emménagé à l’Horme, dans la Loire : elle pouvait les aider.
Papa travaillait maintenant dans une usine textile, la nuit pour avoir « un panier », une
prime, et subvenir aux besoins de six enfants, sa richesse comme il le disait : je suis riche.
Il était heureux d’être entouré, lui l’orphelin, de bêcher son immense jardin et d’être toujours
accompagné de l’une d’entre nous.
À la maison nous parlions sicilien, à l’école le français et entre nous, en grandissant, le
français. Nous nous sommes toujours exprimés en sicilien avec mon père : son expression orale
s’est vite arrêtée à l’intercompréhension du français et il n’a jamais fait de progrès, tandis que
maman, très proche de ses filles et confrontée à la gestion des papiers, obligée de travailler à la
naissance de ma petite sœur dans un laboratoire d’analyses médicales, s’exprimait correctement.
Les années de mon adolescence ont été difficiles. La conquête de la liberté passait par la
réussite scolaire et je l’avais vite saisi : l’ignorance est une prison et la connaissance permet
l’indépendance d’esprit, car personne ne viendrait retirer ce que je pensais. Je ne voulais pas
être comme ces Italiennes que je côtoyais, « casées » avec des enfants. Elles se mariaient pour se
libérer d’un père ou d’une mère tyranniques et les illusions s’envolaient après le mariage ; elles
passaient de Charybde en Scylla.
Ce fut une période où je devins plus secrète, introvertie, consciente de ma situation d’émigrée,
de ma position de « femme sicilienne » qui doit subir, obéir, être une ombre, qui ne pense pas et
ne peut avoir d’opinion. Ma mère a tenu bon pour ses cinq filles, devant les nombreuses pressions
de la communauté sicilienne, et mon père faisait toujours le fanfaron et bonne figure dans
la mesure où nos résultats scolaires étaient satisfaisants et que nous acceptions les différentes
corvées d’une bonne éducation de maîtresse de maison. Femme intelligente, ma mère maintenait
des distances avec les ragots et discutait beaucoup avec nous. Elle désirait que nous ayons notre
indépendance financière : pour elle, il fallait quitter le nid familial pour les études, le travail, et
surtout pas pour nous marier. Aucune de nous n’est partie de la maison pour se marier.
Après un baccalauréat série B, je suis allée à l’université à Lyon III où j’ai étudié d’abord
l’italien, puis le français langue étrangère. C’est là que j’ai connu mon mari, étudiant « étranger »
marocain en mathématiques. Son séjour dépendait de la réussite de ses études et chaque année
son permis de séjour provisoire était donné par la préfecture. Cette situation en sursis s’est
arrêtée lorsque nous nous sommes mariés. Depuis peu j’étais naturalisée française (à vingt et
un ans). Cela avait été très long : trois ans de procédure et d’attente car je n’étais née ni sur le sol
français, ni sur le sol italien.
La rencontre de nos deux cultures, berbère et sicilienne, est une richesse, nous nous
complétons et depuis trente-sept ans nous vivons ensemble. À la fin de nos études nous nous
étions donné un an pour trouver du travail, sinon nous serions partis. Notre objectif : ni l’Italie,
ni le Maroc, mais un pays qui nous faisait rêver et qui accueillait la jeunesse dans les années
quatre-vingt : l’Australie. Finalement, nous somme restés car j’ai trouvé rapidement un travail
dans l’enseignement, j’ai réussi d’abord le CAPES d’italien, puis le CAPES de lettres Modernes.
Mon mari, ayant pris la nationalité française, a réussi le CAPES de mathématiques. Nos deux
enfants issus de cette culture mixte ont appris d’abord l’anglais et le parlent couramment, ont
suivi une scolarité dans une école catholique, sont de toutes les fêtes : catholiques et musulmanes
et ont une richesse spirituelle qui ne repose pas sur la religion. Mon époux et moi ne sommes pas
pratiquants et notre mariage est un mariage civil en France. Nos enfants n’ont pas la nationalité
marocaine. Tous deux, un garçon et une fille, étudient à la faculté de médecine de Lyon : mon
fils en sixième année de médecine, ma fille en deuxième année de dentaire. Ce sont des enfants
issus de l’émigration, eux aussi ont dû se construire une identité et je sais que l’héritage que nous
leur avons transmis les a rendus volontaires, déterminés.
Papa, je t’entends encore chanter Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu et toi maman je te vois
toujours calme et posée, en train de coudre ou de lire et sourire.
