J'ai dix ans
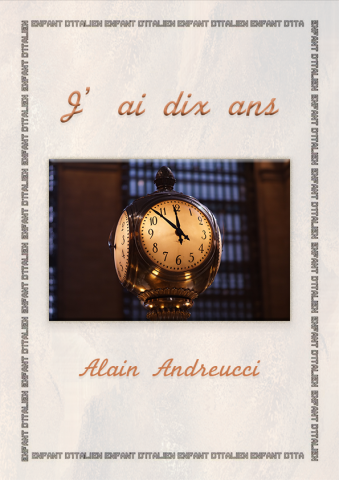
J’ai dix ans. J’ai douze ans. On va chez ma tante – la sœur de ma mère. On s’y rend tous les dimanches. Pour le café. Mon oncle est maçon. On se rend en bus dans la maison jamais achevée qu’il est en train de se construire : il faut aussi beaucoup de ce temps qui dure à l’enfant que je suis et un peu de « nautamine » pour faire le voyage dominical qui a la figure d’une équipée : paquetage vivres médicaments pour le cas où vérifier qu’on a bien les tickets afin d’embarquer dans les deux cars qui nous conduiront du nord de Toulon vers la gare puis de la gare jusqu’au Brusc quelques dizaines de kilomètres et presque un quart de journée plus loin qui séparent l’appartement familial qu’on loue de la solide propriété. Je pense à l’histoire des trois petits cochons j’ai le sentiment qu’on a la hutte de paille celle sur laquelle le loup va souffler que malgré tout notre bagage on n’est pas prévoyants on est inquiets on est toujours inquiets on songe en quittant le domicile qu’il faudra bien veiller sur le cadran doré de la montre paternelle afin de ne pas rater l’horaire du retour. On s’y reporte souvent. Le dimanche il y a l’heure de la messe et les horaires du car qu’on consulte à la station, on vérifie qu’on a bien lu puis encore parce qu’on peut s’être trompé d’une ligne ou avoir confondu celle des trajets hebdomadaires réguliers et celle pourtant d’une autre couleur bleue des dimanches à moins qu’aujourd’hui ne soit férié « le pire » étant « toujours certain ». Le bus nous laisse au pied de la colline on gravit la première pente on descend la seconde on arrive. On s’embrasse avant de gagner le garage dont le sol est encore en terre battue et dans lequel mes oncle et tante habitent car il y a forcément d’infinies finitions à fourbir et qu’il ne faut pas salir le carrelage qui ressemble à une charcuterie vitrifiée pâté ou mortadelle emprisonnés dans une éternité incassable car mon oncle construit « solide » et que ce solide comme le malheur n’a pas de fin. Il y a là dans la cuisine où l’on vit d’autres Italiens d’autres immigrés qui nous ont devancés après une épopée plus ou moins semblable à la nôtre et qu’on peut comparer c’est une entrée en matière invariable et qui donne le ton. On parle un drôle d’italien c’est un patois du Nord qui loin du chant sans cesse hésite guttural entre raucité et férocité et larmes car cette vie est féroce qui leur a donné une fille unique infirme sourde et muette. C’est comme si l’italien qu’on parle là trouvait sa parenté avec cette cousine qui ne peut que pousser des cris de ne pas nous entendre mieux que je n’entends moi-même cette langue ni ces propos dont je comprends cependant qu’ils relatent, ponctués par les dio cane, les porca miseria et les manage sante niente de mon oncle, la catastrophe qui nous cheville à la vie les glissements de terrain au village la maison familiale effondrée le grand-père qui a perdu la raison ou la jeune cancéreuse qui sert de cobaye dans l’hôpital hostile. Il y a là une dame qui vient du Brûlat ses yeux sont toujours bordés par un liseré rouge-violet dont j’observe l’accord qu’il forme avec le nom du village dont elle arrive comme ses yeux tous les dimanches humides pour ne jamais éteindre l’incendie de ce nom et les apocalypses diverses minimes et durables et toujours en bonne santé qu’il transporte.
Alain Andreucci, 2009
Texte publié dans l'ouvrage Enfants d’Italiens, quelle(s) langue(s) parlez-vous ?
