Le mystère des langues
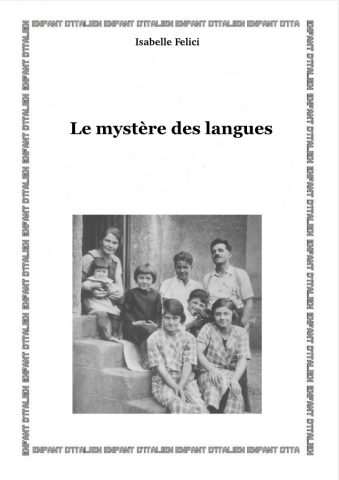
Il me semble que mon goût pour les langues me vient des mystères qu’on a, involontairement, entretenus autour de moi pendant mon enfance, passée dans une famille d’origine italienne en Lorraine. Ma langue maternelle est sans conteste le français, mais un français ayant subi les influences d’autres langues.
La première est germanique, mon petit village étant situé en Lorraine germanophone, à la limite de la Lorraine francophone. Nous étions sensibilisés très petits à ces frontières linguistiques. Est-ce à l’école qu’on nous a appris la différence entre Audun-le-Tiche (deutsch) et Audun-le-Roman ? Peut-être suffisait-il de lire les panneaux routiers, par exemple lors d’une virée à vélo entre ces deux bourgs séparés d’une dizaine de kilomètres ? Nous connaissions aussi le nom allemand des villes et des villages, perdu et regagné à chaque guerre, en somme assez facile à retenir dans cette région où « le nom des patelins se termine par –ange » et par –ingen en allemand. Le Luxembourg est également très proche où l’on parle la même langue qu’en Moselle, le Platt ou, selon le nom scientifique, le francique.
Passer la frontière n’était alors pas un événement anodin. Si les Luxembourgeois de ma génération se souviennent du raisin, des pêches et du vin qu’ils venaient acheter de l’autre côté de la frontière, les Français évoquent plutôt le chocolat, la viande, et bien sûr, l’alcool, les cigarettes et le carburant qu’ils ramenaient (et ramènent) du Luxembourg. Le passage se transformait en aventure lorsque les douaniers faisaient la « grève du zèle » – une notion très abstraite pour la petite fille que j’étais – ou que des restrictions étaient décrétées et qu’il fallait « cacher » ce qu’on avait acheté en trop grande quantité… Autant dire que j’étais rassurée lorsque je reconnaissais, parmi ces personnages en uniforme, un ami de la famille ou, mieux encore, le mari de ma cousine dont le sourire estompait la crainte que les inquiétudes de ma mère avaient fait naître en moi.
Ces échanges avec les voisins luxembourgeois et les villageois de souche lorraine enrichissaient par force le langage quotidien : – Tu veux une schlag sur la schness ? – Ça spritze ! – Viens jouer au kipp – Alors, ça goûte ?, des expressions dont aujourd’hui encore je ne trouve pas d’équivalent français, toujours trop plat, trop grossier ou inexact. Le français parlé se ressentait aussi de l’influence germanique par l’accent, dont notre famille d’origine italienne était toutefois « protégée », malgré les mariages avec des non Italiens (également non Français). Mais on jouait de cet accent : mon oncle luxembourgeois s’amusait à m’appeler « mon amour » avec une telle emphase (mon amoueur) que j’entendais toujours « mon armoire » et je n’ai compris que des années plus tard cette déclaration d’affection. Tout en étant imprégnée de cette musicalité germanique, je n’ai jamais été capable de comprendre les conversations qui parvenaient à mes oreilles. J’ai depuis entamé à plusieurs reprises des cours d’allemand « faux-débutants », sans avoir trouvé, pour l’instant, le temps d’aller au bout de mon apprentissage. Pour moi, le mystère est donc resté presque entier, même si j’ai toujours la sensation, en entendant l’allemand, le luxembourgeois ou le Platt, de reconnaître une musique familière que je suis capable de reproduire, mais sans en comprendre la signification.
J’aurais pu vivre la même expérience avec l’italien si l’année suivant mon arrivée au collège la possibilité n’avait été offerte, aux élèves de quatrième, d’étudier l’italien à la place de l’allemand. En effet, le contexte local et familial m’avait donné à peu près le même bagage linguistique qu’en allemand. Certains mots s’étaient glissés dans le parler quotidien. Je me suis rendue compte très tard qu’on ne disait pas en français une cafétière et qu’on ne calait pas une carte sur le tapis de jeu. Ma grand-mère maternelle, qui vivait chez nous, était la nonà pour tous ses petits-enfants, sauf pour une cousine parisienne qui, ayant été élevée dans une institution religieuse, l’appelait grand-maman, du moins jusqu’à ce qu’elle se lasse d’entendre ses cousins pouffer de rire à ses dépens. Ma grand-mère paternelle était au contraire, selon les habitudes lorraines, « la mémère ». De même mon grand-père paternel, que je n’ai pas connu, était « le pépère » alors que mon grand-père maternel est resté, lui, « grand-papa ».
L’italien était aussi associé aux événements festifs, d’abord sur le plan culinaire, ce qui laissait forcément des traces linguistiques. Si ma mère nous préparait une cuisine variée où figuraient aussi bien des plats français que lorrains, luxembourgeois ou italiens, les menus des repas de fête étaient toujours italiens. Il s’agissait de préférence de pâtes faites à la main, la pastachoutte pour les dimanches et, à Pâques, Noël ou pour les communions, les capélettes (caplettes pour la voisine lorraine) ou cappelletti, dont la préparation était déjà une fête en soi. Il fallait en effet beaucoup de main d’œuvre pour tourner la manivelle de la machine à pâte, faire les ronds de pâte – ni trop gros ni trop petits –, les farcir – ni trop ni trop peu – et donner à la préparation la forme de petits chapeaux. Le moins habile à cette dernière tâche s’occupait de compter les chapeaux (et profitait de l’occasion pour réviser ses tables de multiplication). Il était facile de s’exposer aux critiques et aux plaisanteries car il fallait que les chapeaux soient jolis et présentables et qu’ils ne risquent pas de s’ouvrir en tombant dans le bouillon. L’été, grâce aux légumes du jardin, c’était plutôt la saison des tortelli (les tortelles), une sorte de chaussons remplis d’une farce à base de blettes ou d’épinards qu’on mange aussi bien en sauce tomate que frits. Ces spécialités, et bien d’autres encore, nous venaient de l’Ombrie, la région natale de mes grands-parents paternels. S’y ajoutaient aussi les spécialités du Frioul, la région natale de mes grands-parents maternels. Quand au menu du dimanche figurait la polenta, la nonà préparait le frico, une galette à base de fromage qu’on fait doucement fondre dans une poêle en le retournant constamment jusqu’à ce qu’il durcisse et devienne craquant.
Mon italien sommaire était donc culinaire mais aussi musical : à côté des disques qui reprenaient les airs à la mode et les chansons napolitaines, il y avait les chansons entonnées à chaque grande occasion : Quel mazzolin di fiori et Quando si pianta la buona polenta, le « tube » de mon père qui accompagnait chaque couplet du geste mimant l’action, de la plantation à la mastication et à la digestion, parfois pire. Plus intimes étaient les refrains repris par ma mère, avec, au milieu de mille chansons en français, les comptines, comme celle de cette folle Beppina qui prépare le café avec du chocolat (!), et un air frioulan, O c’è biel chichtiel à Udin.
Étant la dernière des petits-enfants et mes parents étant chacun les derniers de leur fratrie respective, je n’ai pas connu le moment où les membres de ma famille se sont servis de l’italien pour leurs échanges. Il y avait bien, toujours ponctuelles, les cartes de vœux à Noël et à Pâques, venant d’Italie. Il y a eu aussi la visite des cousines de Milan, qui m’appelaient Rita Pavone parce que j’étais rouquine. Avec ces « vraies » Italiennes, il a sûrement fallu parler italien, ce que pouvaient faire sans trop de difficultés, mais pas tous avec aisance, mes parents, mes oncles et tantes et même mes cousins les plus âgés. J’ai donc toujours connu ces possibilités de communication qui, devant moi, n’ont cependant guère été mises en pratique. Le français était bien la seule langue véhiculaire, même si on laissait « échapper » un peu d’italien de temps en temps, notamment des jurons bien plus pittoresques, et surtout plus lénifiants pour celui qui les profère, que les cinq lettres si françaises.
Si ma grand-mère paternelle avait développé un parler bien à elle, avec des croisements amusants, la nonà parlait admirablement le français (mes deux grands-pères aussi m’a-t-on rapporté). Elle le lisait aussi mais s’est toujours refusé à l’écrire, sans doute consciente qu’elle n’en maîtrisait pas toutes les finesses. Elle rédigeait, pour les anniversaires et pour la nouvelle année, quelques mots en italien, puis elle a pris l’habitude de me demander de lui faire le brouillon des petites phrases en français qu’elle recopiait sur les cartes de vœux. Du frioulan, qu’elle parlait parfois avec un voisin qu’on appelait d’ailleurs le Furlang, je connais trois mots, en plus du nom des spécialités culinaires : Schtiampe (Ne reste pas dans mes jambes !), la tchache forade, l’écumoire, un mot qu’on utilisait beaucoup mais surtout au moment des confitures, ce qui peut expliquer qu’il ne soit pas entré dans le lexique de ma grand-mère, et schlapagnote, qu’on adressait au maladroit qui avait renversé son bol ou sali ses habits en mangeant. Il reste aussi le jeu de chcope (la scopa), prononcé avec le chuintement caractéristique du frioulan, et tout le vocabulaire (et les tactiques de jeu…) qui l’accompagne pour désigner les couleurs et les figures du jeu de cartes italien. Je profitais toujours de ces mémorables parties de cartes avec la nonà, la seule de mes quatre grands-parents que j’aie vraiment connue, pour poser mes questions et me faire raconter des histoires.
C’est sûrement autour de ces histoires que j’ai entendues que réside le vrai mystère, car beaucoup de mes questions sont restées sans réponse ou ont reçu des réponses qui ne m’ont pas satisfaite et m’ont laissé des impressions vagues.
Pour résoudre le mystère familial, il me fallait d’abord résoudre le mystère linguistique, ce que j’ai pu commencer à faire au collège, dans une classe de deuxième langue où nous étions tous enfants ou petits-enfants d’Italiens. Je n’ai pas tardé à mener ma première enquête, historique et musicale, autour d’une chanson que ma grand-mère chantait dans sa jeunesse et qui a refait son apparition dans l’univers musical familial, à peu près au moment où je suis entrée au collège, grâce au film de Luchino Visconti, Mort à Venise (1971). On y entend, interprétée par un chanteur des rues accompagné d’une mandoline, la chanson « Chi vuole con le donne » :
Chi vuole con le donne aver fortuna
Non deve mai mostrarsi innamorato
Dica alla bionda che ama la bruna
Dica alla bruna che ha un’altra amata.
Chi vuole con le donne aver fortuna.
En cherchant dans sa mémoire les paroles de la version originale qui venaient compléter la version viscontienne, la nonà m’a raconté l’histoire qui, d’après elle, avait inspiré cette chanson. Avant de quitter l’Italie, elle travaillait au Piémont dans une usine textile où on logeait les jeunes ouvrières. Parmi celles-ci figurait aussi l’héroïne de la chanson, une jeune femme de vingt et un ans qui avait mis fin à ses jours, non pas par légèreté, comme le laisse penser la chanson, mais pour ne pas subir la honte d’enfanter sans être mariée. J’ai retrouvé dans un carton le récit de ma grand-mère que j’avais retranscrit à l’attention de mon professeur d’italien et des élèves de ma classe de Troisième, avec tous les détails, y compris celui du visage noirci de la jeune morte et le nom de l’usine textile, le maglificio Gallo à Chivasso.
D’après les souvenirs que j’ai des récits qu’elle m’en a fait, un peu contrainte et forcée par ma curiosité, la propre histoire de ma grand-mère est moins dramatique, mais tout de même pas très gaie. De Chivasso où elle vivait heureuse – peut-être grâce à l’insouciance de son âge – sa condition de toute jeune ouvrière, son frère aîné l’a rappelée dans son village du Frioul et l’a conduite en France, avec sa sœur. Il avait signé un contrat de travail qui stipulait que chaque homme devait être accompagné de deux femmes. C’est du moins ce que j’ai retenu, car j’étais alors toute petite, du récit de ma grand-mère. Il me semble qu’elle ne s’est jamais remise de cette « trahison », d’autant plus qu’elle a ensuite fait en France des travaux bien plus pénibles qu’à l’usine textile du Piémont, et que, mariée très jeune à mon grand-père, originaire du même village et d’ailleurs lointainement parent, elle a eu ensuite cinq enfants en sept ans. Ma mère est arrivée dernière, six ans après le reste de la fratrie, juste à temps pour subir, elle aussi, les bouleversements liés à la guerre, à l’âge où elle devait entrer à l’école.
Dans cette partie de la France, l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés de l’Allemagne nazie (le « coup de poignard dans le dos » de juin 1940) n’a pas eu les mêmes conséquences pour les Italiens qui, au lieu de se faire transparents, comme dans le reste de la France, ont par force resserré les liens avec l’Italie. Les enfants ont dû aller à l’école italienne, après quelques mois d’école allemande. En effet, après l’« évacuation » vers le centre de la France, en septembre 1939, comme pour tous les habitants des régions frontalières, et, après la « drôle de guerre », ils sont revenus dans une Moselle germanisée, qui a rapidement ouvert la voie aux institutions fascistes. À l’école italienne, les élèves ont endossé la chemise noire et chanté « Giovinezza », y compris les enfants d’antifascistes notoires. Ma mère me racontait qu’on était très fiers des jolies pagelle qu’elle ramenait à la maison. J’ai su beaucoup plus tard que mon grand-père maternel ne cachait pas ses sympathies pour Mussolini. Déjà avant guerre, les aînés étaient partis en colonie en Italie, aux frais du gouvernement italien soucieux d’italianiser les enfants de l’Italia all’estero, et avaient été inscrits aux cours d’italien que dispensaient des maîtres et maîtresses d’école venus d’Italie. On apprenait là aussi des chansons édifiantes que ma tante, soixante-dix ans plus tard, est encore en mesure de chanter :
Italia, Italia, al popol tuo
Non sono confini le Alpi e il mar
Ne son le terre che attorno al sole
Nel nuovo impero a rimirar.
Ma per le aspre straniere vie
Ovunque un figlio d’Italia sta
Ivi di patria un lembo sacro
Un cuor che sempre ti adorerà...
Ces chansons étaient sans doute reprises à la maison et ont pu renforcer le sentiment national de mon grand-père qui n’hésitait pas à afficher, à sa façon, son italianité. Il le faisait avec l’enthousiasme des Italiens de fraîche date – le Frioul ayant longtemps fait partie de l’empire austro-hongrois – sans activisme toutefois puisqu’il n’a pas été interdit de territoire à la fin de la guerre (j’ai vérifié aux archives départementales de la Moselle). La nonà devait partager cette sympathie car j’ai gardé le souvenir de l’avoir entendu évoquer la prestance de Mussolini sur son cheval. Je m’en étais d’ailleurs étonnée car, bien que petite, je savais de façon confuse qu’il n’était pas « bon » d’avoir ou d’avoir eu ce genre de sentiment pour Mussolini. Cela s’est ajouté au mystère et au lourd silence familial dont ce « grand-papa » a toujours été entouré. Sans doute parce que cela valait mieux ainsi.
Parmi les mystères qu’il me reste à résoudre, il y a celui du Frioul, dont je ne comprends pas la langue. J’ai vu tout de même, lors d’une sorte de « pèlerinage », la petite maison de mes arrière-grands-parents, restée debout malgré le tremblement de terre de 1976, et goûté le raisin d’un pied de vigne qui avait résisté au temps et à l’abandon. Il avait lui aussi un petit goût de mystère.
Isabelle Felici, 2007
Texte publié dans l'ouvrage Enfants d’Italiens, quelle(s) langue(s) parlez-vous ?
