Lointaine ascendance
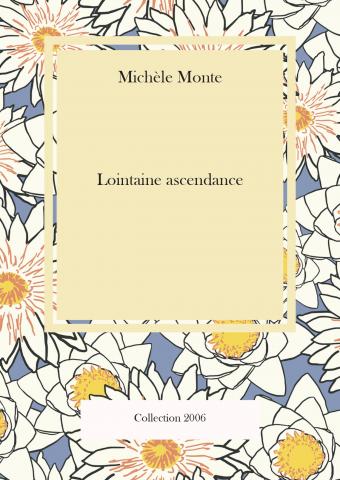
Des noms sur des livrets officiels : Erasmo Monte et sa femme Celeste Lubrano, mes arrière-grands-parents du côté paternel.
Une île au large de Naples, un quartier de Marseille dans l’entre deux guerres où des tantes aux prénoms désuets – Juliette, Ernestine – hébergeaient mon père alors étudiant, des oranges flottant dans le port et récupérées par des gamins avides, quelques bribes de passé familial sans épaisseur.
L’enracinement primordial était ailleurs, dans la Provence inscrite dans l’accent et magnifiée dans sa langue, sa cuisine et son soleil, face à la Bourgogne lointaine que la mort de ma mère privait définitivement de toute grâce et surtout face aux prétentions hégémoniques d’une France d’oïl pour laquelle mon père n’avait que dédain. Mon enfance était bercée de ses jugements qui furent longtemps parole d’évangile : les Méridionaux amoureux du loisir et champions de l’art de vivre en remontraient aux Nordiques besogneux, les Cathares rejoignaient les Indiens et les Noirs dans la cohorte des peuples injustement opprimés, le provençal, dans lequel Dante avait failli écrire la Divine Comédie, était bien plus imagé et riche en vocables que le trop sobre français de Malherbe.
L’Italie somme toute jouait plutôt sa partition pour illustrer le rôle émancipateur de l’instruction faisant de mon grand-père, fils de docker, entouré de sœurs parlant mal le français, un directeur d’école honoré, un peintre estimable et un savant autodidacte dont je découvrais avec étonnement la bibliothèque.
Ce grand-père trop tôt disparu qui lisait Heisenberg, Freud et Bergson, je n’aurai pas pu l’interroger sur son rapport au pays de ses parents. Et d’ailleurs, s’y serait-il prêté, lui qui n’eut jamais la curiosité de se rendre à Procida, lui préférant la Florence des Uffizi, les peintres toscans et vénitiens ?
Les sœurs célibataires mortes sans enfants, la filiation Monte se réduisait à ce qu’en disait mon père. Le pays resta ainsi à la fois familier et distant, le latin et le provençal permettant d’en comprendre la langue sans vraiment la parler. En quatrième, j’appris le castillan, en vertu d’un raisonnement paternel qui rallia mes suffrages : une langue romane par fidélité aux origines et l’espagnol en raison du nombre élevé de ses locuteurs. D’emblée fascinée au plus profond par cette langue à la fois âpre et chantante, passionnée d’autre part par le latin, je ne me sentais aucun lien particulier avec l’Italie d’Erasmo et Celeste. Elle demeura obstinément à l’arrière-plan, comme une évidence distraite jamais interrogée.
Si elle ressurgit plus tard, ce fut à cause de la poussée de rhétorique raciste qui opposa les Français de souche aux bronzés d’outremer. Dans ce concert, les descendants d’Italiens hurlaient souvent avec les loups et des médias complaisants recréaient l’histoire imaginaire d’une intégration harmonieuse. Mon père y opposa ses souvenirs : les courses contre les Babi dans les rues de Marseille, le microcosme de la rue Longue. Je me documentai sur l’immigration de la fin du XIXe siècle et m’identifiai intellectuellement à ces lointaines origines. Mais plus que tel pays spécifique, c’est toujours le vaste ensemble des langues de la romanité qui nourrit mon sentiment d’appartenance et, au-delà, les cultures où sur une terre sèche pousse l’olivier et où des fontaines dispensent une eau rare et précieuse.
