"Montre-toi si tu est un homme !"
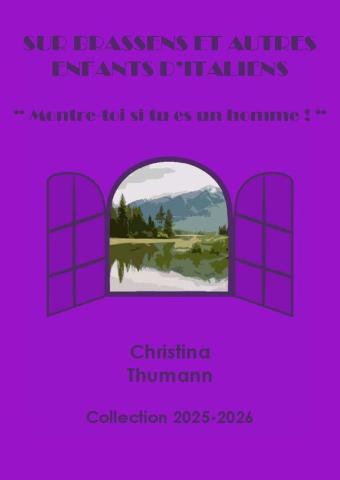
L’histoire familiale de France est pleine d’anecdotes captivantes et tristes. Elle sait bien les raconter,
cette petite dame élégante. Je suis tout de suite séduite par sa joie pétillante, son rire clair et les gestes
vifs avec lesquels elle accompagne son récit. Séduite bien sûr aussi par le vrai café italien dont le parfum
aromatique embaume l’air de la maison et par les biscuits italiens, des cantuccini et des amarettini,
que son époux Gabriel a posés pour nous sur la table.
« Parle-moi un peu de ta famille italienne, s’il te plaît », demandai-je en commençant notre
entretien pour lequel je me suis précipitée deux fois à Sète, la ville natale de France. Étant la fille d’une
mère toscane et d’un père de parents calabrais, elle est une oriunda italienne. Elle a grandi avec, du
côté toscan, l’ambition de vouloir réussir en France, la terre adoptive de sa famille. C’est ce qui explique
aussi son prénom, un remerciement de la part de sa mère à l’Hexagone d’avoir été un pays accueillant
et d’avoir permis un meilleur avenir à sa famille. Cette ambition a voulu aussi que sa grand-mère fasse
toujours en sorte de ne pas parler italien avec France, jusqu’au jour où celle-ci a protesté : Ma nonna,
io capisco già tutto ! Ce besoin d’entretenir ses origines, de faire ressortir cette identité génétique se
reflète dans la décoration de sa maison sétoise : partout, on aperçoit des photos de Venise et des cartes
de la Péninsule collées aux murs, les bibliothèques sont pleines d’encyclopédies et de livres italiens.
– Est-ce que tu te définis plutôt française ou plutôt italienne ?
– Quand les gens veulent savoir d’où je viens, je me présente toujours comme toscane ;
et aussi française ; mais mon père était calabrais. Si je devais choisir une nationalité, ah,
c’est difficile parce que ce sont deux cultures... je resterais française, je ne trahirais pas. Mais
les deux cultures m’ont éduquée. Je suis bi-culturelle. Quand même, je me sens partagée
en deux. Je suis née en France, mais mon cœur est en Italie. S’il y avait une guerre, je
protégerais les deux pays. Ma mère Adima, qui est venue ici quand elle avait deux ou
trois ans, m’a dit qu’elle se sentait toujours déracinée comme une plante. Elle se sentait
différente par rapport aux autres ici en France. Elle était très liée à l’Italie, elle en avait la
nostalgie et voulait toujours y aller. Peut-être m’a-t-elle transmis cela.
– Est-ce que tu peux me raconter les circonstances dans lesquelles ta mère est venue
ici ?
– Mes grands-parents viennent de Toscane, d’Asciano près de Pise. Ma grand-mère
Francesca me parlait de la misère. Par exemple quand la belle-soeur de mon grand-père
Alfredo était enceinte, avec sa famille, ils souffraient tellement de la famine qu’elle a dû
manger de l’herbe. Une fois, ils ont trouvé une pomme de terre. Ils l’ont mise à cuire dans
le feu. Soudain un oncle arrive ; peut-être avait-il senti l’odeur. Pour cacher la pomme de
terre, la femme enceinte l’a mise, toute brûlante, sous sa robe. Elle s’est brûlé la poitrine. Tu
vois, ils sont tous venus en France à cause de la famine. Mais il y avait surtout la situation
politique. Les Toscans sont des gens très têtus et ils réfléchissent beaucoup, voilà les raisons
pour lesquelles ils étaient contre un gouvernement injuste. Mon grand-père Alfredo est
parti pour la guerre en 1914, contre l’Autriche. Il a participé entre autres à la bataille de
l’Isonzo, tu en as entendu parler, je pense. Le jour où mon grand-père est revenu de la
guerre, son père était assis sur une pierre et attendait son fils. Quand il l’a vu, il s’est mis
à pleurer. Voilà pourquoi mon grand-père savait toujours m’expliquer l’histoire de l’Italie.
Parce qu’il en faisait partie. Pendant l’hiver, mon grand-père était maçon et pendant l’été il
travaillait dans les champs. Son épouse Francesca était issue d’une famille plus aisée, son
père possédait des oliveraies.
France me montre une grande photographie ancienne de sa grand-mère avec ses parents, encadrée
et attachée au mur. Entre la mère assise, vêtue d’une longue robe d’une étoffe épaisse et noire, et le
père, debout et habillé d’un complet noir, on voit la petite Francesca, âgée d’environ deux ans.
France continue son récit.
Mon grand-père Alfredo était contre le régime fasciste et les gens connaissaient ses
opinions politiques. Il était socialiste et dérangeait tout le monde parce qu’il ne pouvait
pas accepter Mussolini. Avec les royalistes, il n’avait rien de commun non plus. Un soir,
probablement en 1922, son ami Ruberti, je ne me rappelle plus son prénom, vient chez
mon grand-père et lui annonce : « Ce soir, on va te fusiller si tu ne pars pas tout de suite. »
Ruberti et Alfredo avaient les mêmes idées politiques et ils travaillaient ensemble sur le
même chantier. Mon grand-père a donc dit à sa mère Giulia et à son épouse Francesca
qu’il devait quitter la maison en laissant les deux femmes et son enfant, ma mère. Ma
grand-mère ne voulait pas qu’il parte. Et là, les fascistes ont commencé à tirer contre les
fenêtres et ont crié : « Montre-toi si tu es un homme ! » Mon grand-père voulait sortir
pour les affronter mais sa jeune femme l’en a empêchée. Il est parti avec Ruberti pour
Livourne, ville portuaire située à quarante kilomètres d’Asciano. Là-bas, il y avait un réseau
de volontaires qui aidaient les réfugiés politiques à s’enfuir en bateau. Ils leur donnaient
des billets de transport. Pendant la fuite vers Livourne, il est arrivé un moment où mon
grand-père a dû se cacher et rester un moment sous l’eau. Il a pris un tuyau pour respirer.
Il est parti sans passeport, sans rien, seulement avec les vêtements qu’il portait. En arrivant
à Marseille, il a vu la police sur le quai. Il m’a dit qu’il a failli s’évanouir... Heureusement,
il y avait des personnes du réseau politique qui ont fait semblant de le reconnaître et l’ont
emmené avec elles. Les premières nuits, Alfredo et Ruberti ont dormi dans une auberge,
mais il faut que tu imagines l’endroit comme un sous-sol préparé exprès pour les réfugiés,
avec plusieurs couchettes. Le lendemain déjà, les deux amis sont envoyés sur un chantier
et un certain M. Dumas a donné du travail à mon grand-père. Cet homme lui a dit que
s’il travaillait bien, il lui fournirait des papiers et une carte d’identité. Au bout de deux ans,
grâce à son zèle, il a obtenu un permis de séjour et a pu faire venir sa famille.
Au deuxième entretien, je demande à France pourquoi elle m’a d’abord parlé de sa famille
maternelle et pas de celle de son père. Voici ce qu’elle m’explique :
Ma mère est née en Italie, mais mon babbo est né en France. J’ai un lien plus fort
avec ma mère et avec mes grands-parents maternels parce qu’ils ont eu la bonté de nous
héberger, mes parents et moi, dans leur maison. C’était un endroit moderne pour cette
époque-là. Nous habitions dans l’appartement du haut, donc nous vivions pratiquement
ensemble. Nous partagions tout puisque nous étions dans la même maison. C’était un
partage de choses et aussi d’idées. Leur goût pour la culture m’attirait beaucoup plus...
Dans la famille de mon père, c’étaient des méridionaux. Ils étaient déjà huit chez eux.
Ils étaient moins cultivés, ils ne lisaient pas beaucoup. Ils m’intéressaient moins parce que
je ne me sentais pas comme eux. Ils pensaient être sortis des pires conditions de vie et
pouvoir désormais se laisser vivre... c’est le fait d’être arrivé quelque part et puis de ne
plus rien vouloir changer. Ils étaient pêcheurs, mais moi je ne voulais pas être modeste. Je
voulais toujours être parmi ceux qui dirigent.
Elle me montre encore une photographie, cette fois-ci du grand-père paternel. Sur l’image on voit
un jeune homme au visage mince, avec des grands yeux qui regardent dans une direction inconnue et
une petite moustache au-dessus de la bouche fermée. Il est habillé en costume marin.
Mon grand-père paternel était plus âgé qu’Alfredo. Il était pour les Bourbons, c’est-à-dire
qu’il était monarchiste. Il a fait carrière dans la marine quand il était jeune. Un jour,
en cachette, il a revêtu l’uniforme du commandant et s’est rendu chez le photographe.
Malheureusement le commandant a trouvé la photographie. Il a fait venir mon grand-père
et lui a demandé depuis quand il était commandant. Mon grand-père lui a répondu qu’il
avait voulu offrir la photographie à sa famille. Il parlait un français magnifique et sans
accent. Ma mère le respectait. Il avait des frères et des sœurs qui sont venus en France
aussi. Les frères de mon grand-père étaient pêcheurs. En Italie, ils séchaient des figues
qui servaient à s’alimenter pendant l’hiver. Ils les vendaient aussi, mais cela ne rapportait
rien. C’était une vie très modeste mais ils se sont débrouillés. Après la mort de sa première
femme, mon grand-père en a eu marre de la pauvreté et il est parti avec son fils orphelin à
Gênes. Il a pris le bateau pour la France, c’était un choix et pas une fuite précipitée comme
dans le cas d’Alfredo. C’était plus facile de s’en aller, alors il est parti tranquillement et s’est
installé à Sète. En France, il a connu la mère de mon père, elle aussi originaire d’Italie
du sud. Mais son premier fils restait toujours le préféré parmi tous les autres enfants. Il
était toujours en tête de table. Puis il s’est cru le chef de la famille et il commandait ses
sœurs. Elles le craignaient. Il y avait aussi le frère de ma grand-mère paternelle, l’oncle de
Marseille. Quand j’étais enfant, il est venu nous rendre visite. Il aimait beaucoup s’habiller
d’une manière élégante. Quand il est rentré chez lui, on a cherché une ceinture mais on ne
l’a pas retrouvée. C’est l’oncle de Marseille qui l’avait prise : l’art de l’arrangiarsi. Toute la
famille du sud est venue en France, il n’y a plus personne en Italie. »
Il est tard et il faut que je prenne bientôt le train à la gare de Sète. L’époux de France, Gabriel, nous
demande de nous dépêcher, « France ! Vite, sinon elle va rater son train ! » Il met les biscuits restants
dans un petit sachet qu’il noue en me disant : Tieni... Dai ! Prendi pure. Accroché au mur, à côté du
bureau, je remarque un petit cadre : « Certificat : Meilleur oncle au monde ». Il me reste encore le
temps de demander à France si elle et sa famille ont eu à subir le racisme ici. Elle répond que non, mais
elle a une dernière anecdote à me raconter :
Quand j’étais petite, dans un journal il était question d’un crime et on recherchait
activement le suspect, un individu de type transalpin. J’ai demandé à mon grand-père ce
que c’était, un individu de type transalpin. Il a hésité, m’a regardée et a répondu : « C’est
moi, le type transalpin. »
