Nous, enfants d'italiens, n'avions qu'à bien nous tenir !
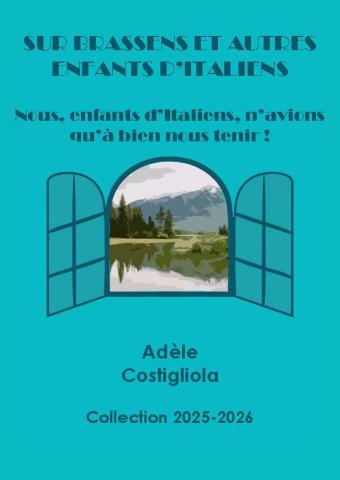
Pour avoir promis de ne pas reprendre la mer, Giacinto, mon père connut la disoccupazione !
L’aide des familles ne suffisait plus, le départ était inévitable. La décision ne dut pas être simple à
prendre. Lorsque vous avez été marin, le vent du large vous obsède face à cet horizon qui n’en finit pas
de vous faire signe.
Donc en 1947, vint ce départ, emmitouflés dans nos manteaux, je me rappelle ce regard que se
lançaient les grands, les adieux... Puis il y eut ce voyage, long, dans ce train dans lequel nous nous
engouffrions. Nous occupions, entre baluchons et valises, un compartiment entier, ma mère Anna
avec ses quatre petits, Rino, Adèle, Enzo et Mario. Un de mes petits frères était malade et moi j’avais
mal au cœur d’être ainsi ballottée. Amplifié par la nuit, le vrombissement des machines déchirait nos
entrailles. Plus nous nous éloignions, plus le train nous rapprochait du père parti un an avant. Ce fut
un 18 décembre, date anniversaire du petit dernier, en plein froid, que nous arrivâmes sur le sol de
France.
Notre arrivée fut marquée par une certaine froideur aussi sur le plan humain, le temps qu’une
famille piémontaise prenne soin de nous accueillir. Cela reste un moment fort, inoubliable ! C’est dans
cette ambiance chaleureuse que nous renouâmes avec le père et nous rapprochâmes de ceux que nous
allions désormais appeler la signora Lina, il signor Francesco, leurs deux enfants, Ugo et Maria. Ainsi
les Baldioli allaient devenir notre deuxième famille.
De notre nouvelle maison, je me souviens du gros poêle dans la grande cuisine presque vide.
Dans un coin se trouvait une malle, que l’on tenait de la grand-mère. Un grand escalier en bois nous
conduisait dans nos chambres ; je revois encore les petits lits en fer et leur couverture sombre. Seul le
parquet grinçait ; nous, nous semblions muets. Nous résidions à la Cité du Bossu, à Nouzon, petite
ville perdue dans un coin des Ardennes. Je ne me souviens pas vraiment de ce premier Noël, peut-être
y avait-il eu des jouets, je ne sais plus ! Ainsi la vie reprit son cours. Me revient le sentier de l’école,
cette école dont sentiments et cultures allaient se mêler et ouvrir une petite porte, autre, à notre esprit
en éveil.
La vie suivait son rythme, chacun vacant à ses occupations. Le père partait tôt le matin et ne
revenait que le soir. On le voyait remonter la côte à pied, avec son vélo sur le côté. Le week-end, il le
consacrait à la terre, chaque maison ayant son bout de jardin. Et c’est ainsi que lui, qui n’en avait guère
le goût, se mit à jardiner, cultivant toutes sortes de légumes. Au bout de ce jardin se trouvait la fosse à
purin faisant le meilleur fumier ; à l’époque il n’y avait pas de WC et nous n’avions pas l’eau courante.
Notre mère, quant à elle, s’était réservé le devant de la maison pour y planter ses fleurs. Elle suivait
la moindre pousse et à chaque éveil du printemps, elle était en osmose avec chacune des couleurs et
des odeurs. Ainsi au milieu de ses fleurs, elle rayonnait d’une touche particulière, détachée un instant
de sa mélancolie.
Nous, enfants, avions très vite trouvé nos repères, entre l’école, la maison et la rue. Le travail avait
pris le pas sur la vie. Mais pour sûr ma mère semblait triste, on ne sentait pas en elle un réel désir de
s’intégrer, mais il fallait bien assurer la vie quotidienne et ses enfants le lui rappelaient. À part ses fleurs
et l’intérêt qu’elle nous portait, elle faisait abstraction du paysage ; en fait Poupa, ainsi l’appelait notre
père, s’était résignée à nous accompagner. J’étais sa fille aînée, dans la maison, je n’entendais que trop
ses silences !
Et si notre mère assumait le rôle de padrona di casa, avec qui pouvait-elle parler sa langue alors
qu’elle était presque toujours seule ? Le père rentrait tard le soir, échangeait quelques mots autour du
repas et ne semblait pas être dans le même monde que le nôtre et très vite il voulait que nous parlions
le français, la langue du pays qui nous donnait à manger. De quoi pouvions-nous bien nous plaindre ?
Notre regard d’enfant observateur silencieux tentait d’interpréter les non-dits. Nous posions rarement
de questions, elles auraient été malvenues.
La vie heureusement ne s’arrêtait pas à nos états d’âmes ! Une petite sœur naquit en plein mois
de janvier l’année suivante, le 24 au petit matin. Le givre marbrait de mille veines argentées les vitres
des fenêtres de nos chambres. Les cris de ma mère me parvenaient aux oreilles, que j’aurais aimé me
boucher. La signora Lina nous prit en mains, le petit déjeuner tout chaud nous attendait, sa présence
nous rassurait avant que nous ne reprenions le chemin de l’école. À coup sûr, l’espace de liberté était
dehors, à l’école, avec les filles et les garçons. Et au fur et à mesure que nous grandissions nous devions
aider les parents, moi pour les tâches ménagères, les garçons pour ramasser du bois ou couper l’herbe
pour les lapins que nous élevions. Le dimanche cela sentait bon le lapin chasseur, avec un peu de
tomate relevée à peine de thym et de poivre. La mère l’accompagnait de pâtes ou de frites, le menu avait
ce mélange à l’italienne, avec cette touche parfois à la française, ou avec de la polenta à la piémontaise.
Faire les tâches ménagères, ce n’était jamais de gaîté de cœur ; j’aurais préféré moi aussi être
dehors, mais pour les filles, la rue avait une connotation bizarre ! Heureusement, il m’arrivait de
pouvoir m’échapper. L’imaginaire sauve des situations frustrantes : il me plaisait d’inventer des
histoires. Bernadette Bastianelli, plus jeune que moi, buvait chacune de mes mimiques inventées en
instantané, là, sur nos pieds, une histoire de rien... Une histoire de gravier geignant sous nos pas et
nous appartenant pour quelques secondes. Lorsque toutes deux accroupies, je traçais de mes doigts
des sillons disparaissant tour à tour par magie, j’affirmais tout de suite après : « Tu vois, il n’y a rien
et pourtant, il y a bien quelque chose ». Pour constater juste après qu’il n’y avait rien ! Et répéter sans
fin qu’il y avait bien quelque chose ! Une histoire folle. Nous étions épuisées à force de rires ; j’entends
d’ici le rire clair de Bernadette puis le mien partir loin en éclats ! Nos histoires n’appartenaient qu’à
nous. Nous ne nous lassions jamais et c’était notre secret.
Vint l’âge où il fallut aller au catéchisme ; je n’eus point de chance, seuls les garçons étaient
autorisés à aller au catéchisme du quartier. Pour les filles, il fallait se rendre, à pied, à cinq kilomètres
de la maison, en ville, et toute seule car les autres filles étaient soit trop jeunes soit ne faisaient pas
leur communion. Personne ne s’en inquiétait, mais la peur au ventre, je suivais mon chemin de croix.
Un jour, je posai la question à l’abbé :
– Dieu était-il un homme, une femme ?
Je me sentis stupide face à la réponse :
– Ni homme ni femme.
Dieu était-il un être asexué ? Ma stupidité déjà était un péché, je rougissais de honte. Nous
grandissions dans ce monde des grands. L’apprentissage se faisait dans la rue, les yeux écarquillés. La
rigueur de l’éducation ne nous empêchait pas d’une certaine façon d’être heureux à notre manière. À
l’école, les règles étaient strictes et il fallait s’y soumettre. Mais dehors nous déjouions les règles. Nous
enfants d’immigrés, nous devions travailler mieux que les autres pour être considérés. Les familles
n’étaient pas toutes logées à la même enseigne, l’alcool dans certaines familles de travailleurs faisait
des ravages. La vraie misère était là, cachée dans certains cris retenus des hommes, ivres de travail
et de vin, devant faire face à de longues journées passées à boulonner des pièces métallurgiques en
tout genre. Le bruit des forges avec ses cadences infernales, ses énormes fours happant la vie des
hommes, les manipulant tels des fers rouges rendus malléables. Sale boulot ! Ces bleus de travail
qui revenaient noirs de graisse, ne protégeant les hommes que superficiellement. Ils respiraient à
longueur de journée cette poussière qui encrassait leur poitrine. Mon père était mécanicien et il signor
Francesco, lui, déchargeait la ferraille par une grue suspendue à un pont qui avançait ou reculait
suivant la manœuvre.
Tout cela me revient en mémoire telle une décharge qui me restituerait l’écho de la douleur. Et
face à cette image implacable du travail dont je n’avais nullement conscience alors, ce sentiment
d’impuissance me rattrapait. Et plus je m’efforçais de l’atténuer plus il se faisait présent. La mémoire
de la Cité a cet étrange attachement face à des êtres subissant sans trop rien dire. Il faut du recul pour
mieux comprendre cette réalité-là et la saisir.
Nous devions donc réussir à l’école pour un sort meilleur. Et nous les macaronis n’avions qu’à bien
nous tenir. Toutefois, un jour que le professeur Martini, d’origine corse, l’interrogeait, en cinquième,
lors d’un cours de géographie : « C’est quand la période en Italie où on fauche les macaronis ? », la
malicieuse Maria répondit avec aplomb : « Maître, c’est quand en France on arrache les patates ! »
C’était l’année du certificat d’études et nous n’étions que deux candidats : Paul et Adèle. D’autres
passaient l’examen en candidats libres. Le maître ne présentait que les élèves susceptibles d’avoir
l’examen. Les autres étaient déjà les laissés-pour-compte ! Je ne pouvais pas me permettre d’échouer
et mettais les bouchées doubles. Le maître me donna des cours spécifiques « Option Arts ménagers ».
Nous devions apprendre, nous les filles de mon âge qui ne rentraient pas en secondaire, tout ce que
devaient connaître les futures fées du logis pour tenir une maison comme il se doit.
Nous devions prouver que nous grandissions au rythme qu’avaient décidé les adultes. C’est sur
le chemin de Neufmanil que se situait la petite fabrique de paniers à salade où nous allions travailler,
surtout pendant les vacances. Le patron était un petit artisan italien, il embauchait les enfants au
noir et cela ne semblait choquer personne. Chez les enfants issus de l’immigration, cela se posait
d’une manière naturelle, surtout chez certains jeunes de famille pauvre. Chez nous, il était coutumier
d’occuper les enfants de notre âge pas seulement pour arrondir les fins de mois mais aussi pour ne pas
nous avoir dans les pattes.
Nous connaissions peu de grasses matinées, à notre âge, même lorsque nous n’étions pas obligés
de nous lever. Notre mère nous disait le dimanche – alors qu’il était à peine neuf heures – que dix
heures allaient sonner et que des tas de choses nous attendaient. Elle-même, dans sa jeunesse, en avait
vu d’autres et des plus rudes, avec la nonna et sa bottega ! Toutes les deux savaient que seul le travail
permet d’aller de l’avant. Fuir la misère pour survivre...
Nous ne manquions de rien et le sens de l’économie se perpétuait ainsi parce que lorsque nous
retournions au pays, l’argent était dépensé sans compter. Comme s’il était important de montrer à
toute la famille que nous n’étions pas vraiment partis pour rester pauvres ! Les émigrés n’ont pas
d’autres choix que d’amasser un maximum d’argent pour démontrer que l’ascension sociale a été en
quelque sorte réussie en toute loyauté !
Il était doux le temps où, jeunes adolescents, nous étions allongés dans le foin, sur le dos bien
droit, nos bras se frôlant. Cachés du regard des adultes, nous semblions croire qu’ils ne se doutaient
de rien. J’ai toujours en mémoire le moment où je dus annoncer à ma mère la venue de mes... règles.
Les hommes ne devaient surtout pas m’approcher, m’avait-elle dit. Ces jeunes gens que je fréquentais
faisaient-ils partie de ces hommes ? Ce n’est que dans la rue, avec les copines, que nous osions parler
de tout ce que taisaient les grands. À nous de percer les secrets ! Au cours de ma quatorzième année,
je vis le ventre de ma mère s’arrondir, mais j’ignorais encore tout de sa grossesse, jusqu’au jour où
Thérèse, une copine de classe, me souffla que j’allais avoir un petit frère ou une petite sœur. J’étais
intriguée par les proportions qu’avait soudain prises le ventre de ma mère. Comme je me hasardais
à lui demander, elle m’affirma qu’elle avait bien trop mangé de soupe aux haricots ! Ce ne fut qu’un
peu plus tard que mes parents demandèrent au maître d’école s’ils pouvaient me garder à la maison
pour la naissance du bébé. Il n’en est pas question, avait répondu le père Albert ! C’était ainsi qu’on le
surnommait bien qu’il ne fût pas religieux. Votre fille a une chance d’avoir le certificat d’études et en
aucun cas elle ne doit manquer l’école ! Je ne quittai pas les bancs de la communale et une jolie petite
sœur rousse naquit le 23 avril 1956, au petit matin. Il me semble encore entendre, de la petite chambre
fermée, les premiers pleurs d’Anna Maria succédant aux cris de ma mère. À sept heures du matin, une
sage-femme était encore là. Le père se préparait à partir au travail.
Il n’y avait rien de plus rébarbatif que d’acquérir certaines notions dans les manuels scolaires...
De la composition de la literie jusqu’aux produits d’entretien ménager. Je fis blocage sur le mot
« encaustique » qui pour moi était aussi mystérieux qu’inutile. On l’utilisait, paraît-il, pour entretenir
les bois et principalement pour faire briller les parquets. Heureusement, à la maison nous n’employions
pas cette fameuse cire. Je voyais mal ma mère se mettre à quatre pattes pour faire reluire le sol. Quant
à moi je n’en avais guère le temps ! À la maison justement les parquets ne brillaient peut-être pas, mais
ils n’étaient pas sales pour autant. D’autant plus que cela devait coûter très cher. Heureusement nous
avions le sens de l’économie.
« Tu es bouchée à l’émeri ! » disait parfois le maître. C’était l’expression qu’il employait lorsque ma
logique avait du mal à prendre ses marques. J’avais droit aux éloges dans les matières plus artistiques,
telles que le dessin, la poésie et bien sûr la couture ! Le maître me présenta à un concours de poésie
et je tirai le mauvais numéro : Jean de la Fontaine ne m’inspirait guère et à cause de l’histoire de la
belette et du petit lapin, je n’eus que la troisième place, certes honorable ! J’avais une préférence pour
les vers du Père Hugo. Lorsque je récitais « Demain dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je
partirai ! Vois-tu, je sais que tu m’attends... », le maître me disait : « Arrête, tu vas nous faire pleurer ! »
Il se révéla que je ne fus brillante qu’en broderie. À tel point que l’on soupçonnait la mère de me faire
l’ouvrage. Je dus faire la preuve devant la dame qui nous enseignait les points que c’était bien mes
doigts qui étaient si agiles !
En revanche, je n’avais guère brillé lorsque, à l’approche des grandes vacances, avec un ou deux
copains de la classe, le maître nous avait invités à dresser l’inventaire des fournitures scolaires. Nous
décidâmes de piquer quelques gommes, crayons et cahiers. Tout heureux de notre exploit, nous fûmes
mis à l’index dès le lendemain, le maître nous pria de rendre ce qui appartenait à l’État ! On nous
avait dénoncés ! Pour clore l’incident, alors que je dessinais, sur la feuille blanche, une rose éclatante
semblant sortir tout droit du jardin, le maître, ironisant, se pencha sur le dessin et reconnut que je
faisais bien la « rosse » ! Je m’en voulais, mais ne risquais pas de le dire à la maison, il valait mieux que
cela ne vînt pas aux oreilles du père !
Entre deux devoirs, nous nous inventions des jeux. Il était courant, lorsqu’un de nous descendait
à la cave, que la lumière s’éteigne soudain dès qu’il se trouvait au milieu des escaliers, dans le noir. Le
temps de hurler et la lumière se rallumait.
Les amusements dehors n’étaient pas tristes, lorsqu’il m’arrivait d’échapper à la vigilance des
parents, nous nous amusions à cache-cache. Derrière les buissons le grand frère venait me tirer par
les vêtements, un jeune garçon charmant s’y trouvait comme par hasard. Celui-là même qui quelque
temps plus tard me suppliait d’aller avec lui au cinéma. Je lui répondais que c’était loin et que jamais
de la vie ma mère me laisserait y aller ! Le prétendant jouait de l’accordéon, lorsque je passais sous sa
fenêtre, cette musique m’était destinée... En tant que fille, je me trouvais bien trop brune de peau et
avec mes cheveux longs frisés. Pourquoi en voulais-je inconsciemment à ma couleur de peau ? Avais-je,
moi-même, cette crainte face aux gens à la peau un peu orangée comme moi ? Qu’avais-je ressenti,
enfoui ?
Me reviennent les rapports avec l’autorité des parents. Azzarino, l’aîné, n’en ratait pas une. Le
père ne badinait pas lorsqu’il le menaçait de prendre la ceinture et parfois de mettre ses menaces à
exécution. Ma mère se mettait au milieu. Il lui était interdit absolument de jouer au baby-foot dans
le petit bar attenant à l’unique épicerie, même si les patrons étaient les parents du meilleur copain
de classe et que tous les deux étaient d’excellents élèves. Rino, quant à lui, suivait déjà les études
secondaires. Pour bénéficier des bourses d’études nous devions consentir à devenir français. C’est ainsi
que les démarches furent faites pour la naturalisation. Une erreur de calligraphie s’étant glissée dans les
archives de l’État, voilà qu’un « i » prit la place d’un « a » en plein milieu du nom, et de Costagliola nous
devînmes Costigliola. De plus, je n’étais plus née le 20 mais le 21 mai. Il fallut exiger les rectifications.
L’intégration pour les adultes se faisait entre Italiens de régions différentes. Pour l’anecdote, lorsque
l’on continuait à traiter mon père de macaroni, il ne trouvait rien de mieux à répondre que « Moi,
au moins, j’ai demandé la nationalité française et je suis donc plus français que quelques-uns. Il y en
a qui ne peuvent pas en dire autant ! » Il était fier de sa réplique et aimait à le répéter à qui voulait
l’entendre ! Les adultes se libéraient certains samedi soirs, autour d’un apéro dînatoire. Leur langue
devenait le centre du monde, avec pour chacun son accent provincial. Ils apprirent ainsi à mieux se
connaître, ces braves Italiens venus des quatre coins de la péninsule. Ils prenaient plaisir à partager
leurs états d’âmes tout en restant très attachés à leur pays certes, mais surtout à leur région !
Quelques airs me reviennent, ces chansons du pays qui faisaient trembler les murs de notre
maison. Mon père se faisait prier pour enfin chanter les fameuses chansons napolitaines, auxquelles se
mêlaient les airs des chansons piémontaises. À son répertoire étaient inscrites Quel mazzolin di fiori,
O sole mio, Torna a Surriento, A Marechiare. Lors des réunions dans la famille piémontaise, un oncle
enseignant entamait toujours le chant des partisans. Je garde encore intacte l’émotion à travers ce chant
pour la liberté. « Amis entends-tu... au loin... » ! À la maison nous évitions ces sujets politiques, mon
père ne voulait pas s’en mêler. Eux cependant, lorsqu’ils faisaient allusion à leur départ, semblaient
avoir fui le fascisme. Ces soirs-là, les grands nous lâchaient un peu et nous, nous les voyions sous un
autre angle, différents...
Après la naissance de la petite dernière, hélas, ces samedis s’espacèrent. Cette année-là nous ne
pûmes aller en Italie. Nous passions donc nos grandes vacances à l’atelier, les paniers à salades nous
attendaient. Mais le travail ne nous faisait pas peur. Ensemble nous n’avions peur de personne. La
même envie d’assumer la difficulté nous animait. Une certaine fierté à partager. Ensemble encore nous
avions le génie de la distraction. Nous inventions des jeux bizarres, un concours à celui qui tiendrait le
plus à compter sans respirer. Et c’étaient des éclats de rire ! Lorsqu’il y avait trop de chahut, une voix
montait et nous redevenions calmes tout en nous regardant. Le rythme revenait, nous tirions sur le
fil du dévidoir et nous étions repartis pour un tour jusqu’à ce que le fil galvanisé vienne entièrement
habiller le squelette du panier. Il était tenu entre nos jambes serrées, habillées d’un vieux pantalon du
père. Nous étions les trois aînés à travailler à la fabrique ainsi que Maria, la fille de la signora Lina. Il y
avait aussi Paul et Jeannot Moulin qui venaient de perdre leur mère. Personne ne pensait à se plaindre.
Pourtant je languissais la rentrée, en septembre j’allais enfin aller au centre d’apprentissage, bien
sûr pour y passer les CAP de couture et d’art ménager. Au fur et à mesure, j’avais l’impression de
grandir dans une autre atmosphère. On me prenait un peu plus au sérieux grâce à mes bons résultats
au lycée professionnel. On m’acheta alors un vieux vélo d’occasion que l’on repeignit avec la seule
peinture antirouille argentée qui donnait l’impression du neuf. C’est ainsi qu’avec lui, je roulais vers la
liberté !
