Résonances frioulanes
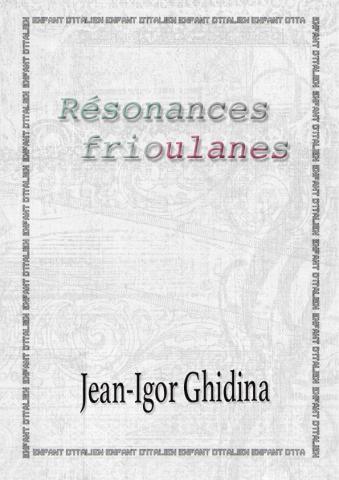
Mon rapport aux langues est tributaire du contexte familial dans lequel je baignais, mes parents ayant émigré définitivement d’Italie en France peu avant ma naissance. La langue qu’ils m’ont apprise était donc le frioulan dans sa variante carnique, mais je dois ajouter que ma grand-mère paternelle était slovène et que sa sœur institutrice, une fois mutée d’office en Toscane en raison de la réforme Gentile[1], conversait avec nous en un italien toscanisant. Peut-être s’agit-il d’une interprétation d’adulte quelque peu fallacieuse, mais je devais identifier l’italien, à l’époque, à la luminosité céruléenne de la Versilia. D’emblée, le fait de devenir locuteur frioulan ne préjugeait pas d’une sensibilisation plurilinguistique et, oserais-je dire, multiculturelle. D’abord le Frioul ancestral, encore havre d’une civilisation sylvo-pastorale, puis la Slovénie faisant partie de la Yougoslavie du maréchal Tito, enfin l’Italie perçue sous un aspect plutôt idyllique de dépaysement balnéaire et sans doute artistique grâce à la splendeur marmoréenne de la Piazza dei miracoli de Pise. En fait, je regrette énormément que mon père ne m’ait pas également appris le slovène que je ne connais que par réminiscences, riches de sonorités captivantes, mais dépourvues de syntaxe. J’aurais pu en quelque sorte rendre hommage à son cousin tragiquement disparu en 1945, dont je porte le prénom.
Si j’examine les langues qui présidaient aux échanges intergénérationnels, je dois reconnaître aujourd’hui encore que la situation relevait d’une certaine complexité. Mes parents et mes grands-parents maternels ne s’adressaient à moi qu’en frioulan, sauf ponctuellement devant d’un interlocuteur étranger, auquel cas, comme par mimétisme, ils adoptaient son idiome, c’est-à-dire le plus souvent le français ou l’italien. Mes référents fondamentaux de l’univers domestique, de l’environnement surtout naturel et des sentiments appartiennent sans ambages à ma langue maternelle, ce qui peut expliquer parfois une certaine tergiversation paradigmatique, lorsque aujourd’hui je dois choisir un vocable français ou italien, car il m’arrive de ressentir une sorte d’insatisfaction, de déphasage autre que purement sémantique. Si je traduis un texte de Giono où apparaissent les occurrences telles que prairie, champ, foin, rocher, ruisseau, immédiatement le substrat frioulan me propose une myriade de termes renvoyant très précisément à la connaissance empirique des fenaisons et des monts de la Carnie. Les équivalents italiens conviendront bien sûr, car en jouant sur l’implémentation et le transfert, ils traduisent à peu près la même chose ; il n’empêche que l’espace d’un instant s’est glissée une interférence qui soit s’éclipse en une nostalgie fugace et inavouable devant un auditoire, soit laisse miroiter une digression qui risquerait d’apparaître comme logorrhéique, impromptue et narcissique.
Ma grand-mère slovène n’avait jamais réussi à parler cursivement le frioulan, si bien qu’elle n’employait presque toujours qu’un italien qu’elle avait commencé à assimiler dès son enfance lors de l’occupation de Caporetto/Kobarid en 1915 et pendant les brefs séjours chez ses cousins de Trieste. Ce qui m’a frappé plus tard, c’était d’abord son registre de langue relativement soutenu pour une simple couturière, peut-être du fait d’une certaine propension bibliophile et polyglotte qu’elle avait héritée de mon arrière-grand-mère germanophone ; par ailleurs, ses calques phonétiques ou prosodiques du slovène qui me font penser spontanément aux émigrés polonais vivant dans les pays néolatins. Je devrais ajouter que des emprunts lexicaux ou des locutions idiomatiques frioulanes et slovènes dont étaient parsemés ses discours rendaient l’italien en quelque sorte dialogique, parce que je ressentais en elle une identité de frontière. Je percevais dans ses mots et son intonation que son adoption de l’italien, à la suite d’événements politiques et personnels, ne tarissait pas son identité plurielle de slovène ayant d’abord grandi, appris à lire et à écrire dans l’empire austro-hongrois, s’étant familiarisée avec l’italien dès la première guerre mondiale au milieu de soldats souvent débonnaires et analphabètes, entre deux cannoneggiamenti, enfin projetée au milieu de carniques à l’idiome roman, certes, mais aux voyelles longues parfois étranges pour une slavophone plus encline aux groupes triconsonantiques suivis de diphtongues et du yod.
En présence d’autrui, lorsque je séjourne au Frioul et dans les vallées ladines des Dolomites et dans les Grisons, je dirais que je suis partagé entre d’une part l’adoption de l’italien courant et d’un allemand rudimentaire afin d’établir une communication efficace et de l’autre un plurilinguisme découlant d’une sédimentation mémorielle. Autrement dit, certains termes frioulans que j’ai enfouis en moi depuis mon enfance font irruption pour partager avec mon interlocuteur une relation au monde toute particulière. Une conversation très anodine avec un sculpteur suisse qui semblait devoir durer de simples minutes, se prolongea environ une heure parce qu’après nous être entretenus de questions pratiques en allemand, mon allusion à mes origines déclencha un dialogue romancho-frioulan, pétri de complicité, où étaient scandées des paroles en quelque sorte surdéterminées qui renvoyaient à des notions ou à des objets pour lesquels nous ressentions comme un écho très lointain, une fascination intemporelle : sorêli, biel, vias, ciaspes. Question de Weltanschauung qui inhibe l’acquiescement à une transposition réductrice, comme lorsque je prononce, en m’imprégnant du panorama sublime qui s’épanouit devant mes yeux, le vocable ladin enrosadira. Moment ineffable et mystique où je me sens subjugué par l’extraordinaire chromatisme crépusculaire des Dolomites.
L’innocence idyllique du monde de l’enfance, la croyance béate en une concorde qui rassemblerait ciel et terre, parents et grands parents, voisins et villageois lors de retrouvailles animées. Telle serait ma première réminiscence enfouie au tréfonds de ma mémoire, lorsque j’essaie d’évoquer le sentiment qui est associé à ma langue maternelle. Une succession de découvertes primordiales où chaque mot voire même chaque phonème assimilé est intimement lié à la découverte, à la préhension, à la stupéfaction bouleversante face à la majesté de l’univers, recelant des trésors inouïs même dans le moindre détail. La verbalisation comme fondement de l’ontologie, car désigner leurs composantes du monde environnant signifie prendre conscience de leur existence et de mon être. Rétrospectivement, l’appartement vétuste et exigu de Suresnes, les vicissitudes voire les tribulations qu’endurèrent mes parents pour aménager un certain confort étaient sublimées par notre langue frioulane qui établissait une relation intense entre notre microcosme allophone et notre berceau ancestral que nous retrouvions en été. Le parc des propriétaires Khan que je parcourus par la suite, c’était en quelque sorte la réplique en miniature des vastes dénivellations sylvestres jouxtant la ferme de mes grands-parents, mais aussi le prélude à un cheminement intérieur, à une introspection. In-fans, l’être qui ne profère pas encore, qui ne fabule pas, car il entretient un lien viscéral, tellurique avec la terre, en enregistrant les mots qui lui permettent d’exister dans ce monde. Peut-être s’agit-il en partie de l’Ursprache, du non parlabile qu’évoque Claudio Magris[2] ?
Par delà la prime enfance, ma langue maternelle est inexorablement associée à la contemplation émerveillée de la nature qui suscitait en moi un sentiment poignant d’admiration quasi mystique, de vénération devant une telle beauté ineffable propice à une prière de louanges. Sans doute un élément de mythe personnel baignant dans le merveilleux. Mais à cela s’ajouterait également la perception encore labile d’une quête métaphysique.
À cet égard, la dernière ascension en montagne avec mon grand-père représente un moment mémorable, abstraction faite de la nostalgie envers une personne chère qui a disparu. Le frioulan carnique de mon grand-père, c’était un réceptacle linguistique et culturel, l’instrument d’une appréhension à la fois synchronique et diachronique de sa terre natale nuançant mon approche quelque peu arcadienne, sans pour autant provoquer une spoliation, la chute d’une fascination. Viodistu chel cuel ? À travers son pas mesuré et inlassable de montagnard, lors des pauses, se faisait jour tout un concentré d’histoire. Tel rocher témoignait de l’étape de la transhumance en faisant revivre des dialogues, des impressions et des émois de personnes jadis connues : samponc’, bovalamens. D’un côté, je me délectais de cette profusion d’anecdotes qui donnaient comme un sens à cette nature que quelques années plus tôt je préférais désanthropisée pour ne pas compromettre son pancalisme. Le flamboiement magique des cimes des Dolomites se revêtait d’une dimension encore plus fascinante, car j’éprouvais alors le lien ténu mais réel entre toutes les générations auxquelles avait été prodigué ce spectacle, comme si nous étions en symbiose avec ces glasinâis, sengles, cres, gâis et gravons. Ces lieux qui ont structuré ma perception du réel constituent des chronotopes où se sont stratifiés des éléments significatifs de l’acculturation. Tel passage de Dante, Pétrarque, Manzoni ou Giono était intégré et surtout savouré grâce au tropisme d’un lieu mythique. La littérature italienne et française me permettait par là même de dépasser une circularité particulière pour envisager grâce à une autre langue une réinterprétation du réel.
Gotes di rosade, rôes di Navolis, autant de lexies fort banales si elle n’étaient traduites que dans une optique exclusivement référentielle. Pourtant, elles recèlent encore en ce jour une mélodie enfouie aux accents de mélopée, à l’unisson du scintillement magique de la végétation luxuriante et de la silhouette d’une forêt d’épicéas dont le vert sombre se détachait d’une part sur la grave du Tuement et de l’autre sur les à-pics vertigineux de la chaîne conduisant au Clap savon. Les eaux libres et jaillissantes si suaves au toucher dont le murmure lointain résonnait encore plus distinctement après le crépuscule, alors que le clignement étoilé de la voûte céleste contribuait à susciter une impression synesthésique d’une ravissante beauté. Ingénuité du mythe, régression infantile et égocentrique sans doute, mais que n’ai-je le privilège de retrouver un bonheur simple et viscéral en proférant ces paroles en frioulan, quand je ne peux me résoudre à admettre les avatars du progrès ? Plus tard, l’ode à l’eau qui coule, je l’ai retrouvée magnifiquement exprimée dans le Cantico di frate sole. L’italien incipiente de saint François s’est sans doute greffé sur mon frioulan pour conférer une dimension transcendante à la vision quelque peu panthéiste de mon enfance. Tout se passe comme si lors de mes monologues intérieurs se stratifient deux voix orchestrant chacune une relation toute particulière au monde laquelle, à considérer les bouleversements qu’ont apportés les derniers lustres, pourrait être battue en brèche.
Les eaux assimilées à une ressource à exploiter, à un potentiel économique, les montagnes devenues elles aussi un territoire à dominer, à rentabiliser, à réifier, inexorablement. Hier, d’abord, les barrages bouleversant les repères, provoquant une onde de choc d’une puissance atomique, vallée du Vajont dénaturée à jamais, détruisant une civilisation peut-être archaïque, mais qui n’exsudait pas l’orgueil démesuré, l’hubris qui sévit à notre époque postmoderne. Mais que laisseront-ils derrière eux ces décideurs éhontés ? Moins spectaculaires de nos jours, mais révélant la même folie dévastatrice, les sources captées ou déviées ou rescapées, désormais captives de barbelés, parce que bradées à une société qui tirera ses bénéfices de ses truites nourries au mangime acheté à vil prix dans on ne sait quelle contrée, pardon unité de production délocalisée, bientôt transporté par un TIR qui roulera sur la nouvelle superstrada, surplombant la chapelle San Laurens, aux fresques de la Renaissance si peu admirées. Diktat de la viabilité forcenée qui n’est qu’une involution tautologique. La distribution de l’eau potable bientôt privatisée – l’eau bondissante que la nature nous versait avec prodigalité – et les flancs et les sommets des montagnes sectorisés en fonction de besoins ad hoc : villette a schiera, rete stradale per i fuoristrada, rifugio raggiungibile in pochi minuti, poligono militare vietato l’accesso, parco naturale dove si esplica una vera tutela ambientale …(et ailleurs ?). La vaticination de Pasolini quant au déferlement de l’homologation culturelle en Italie se trouve indéniablement confirmée. Laips di âghe dal gno paîs… Comment puis-je parler hic et nunc l’italien, emblème d’une littérature qui m’accompagne, alors qu’il se mue en vecteur du libéralisme sauvage, sans renier le témoignage et les valeurs de mes ancêtres ? Des voix, des cris, des scènes resurgissent incoercibles et tendent sans doute à occulter les côtés malgré tout bénéfiques du progrès. Mais s’agit-il de se complaire dans la nostalgie d’un passé encensé en position de laudator temporis acti, reclus dans la désuétude ? Pourtant, si au moins ils prenaient en main leur destin en ne jaugeant pas leur langue à l’aune de la rentabilité ! Pourquoi se résigner à cette spoliation de l’identité ? J’entends retentir les tiroirs soumis à l’effraction des chemises noires, mon arrière-grand-père maternel humilié devant ses proches, lui le simple cordonnier, l’operaio Giuseppe/Žef Sala candidat aux élections législatives de 1913, emmené comme sovversivo, lui si pacifique, jeté en prison, le temps que Vittorio Emanuele III, roi d’Italie, di stirpe guerriera, puisse visiter devant une foule unanime les cimes, il sacro confine patrio tant péroré par les bellicistes, arc-boutées vers l’ennemi. Grand-mère Livie, ton alliance, pas question de l’immoler pour la guerre d’Éthiopie, ni d’être dupes des vociférations bellicistes des étudiants du GUF, montés de Trieste en juin 1940 : « Duce, guerra ! Duce, Guerra ! ». 26 mai 1944, l’expédition punitive des nazi-fascistes déferle au lance-flammes sur le village covo di partigiani lequel s’embrase comme une torche. 23 avril 1945, peu avant la fin des combats, Giovanni, mon grand-père paternel, membre actif de la Repubblica partigiana della Carnia, arrêté après une délation, fusillé avec d’autres résistants antifascistes via Spalato à Udine. Hiver 1974-1975, la celere, ameutée par un maire sans scrupules, venue réprimer les irréductibles paysans s’opposant à la mainmise de sociétés privées, de connivence avec les potentats locaux, héritiers indignes de l’idéal de justice qu’ils prétendaient incarner. Les voix de ce peuple montagnard résonnent en moi en frioulan et me demandent de respecter la langue dans laquelle furent proférées les paroles de résistance à l’oppression, de défi et de ténacité. Localement, il m’est très peu naturel d’utiliser l’italien avec les compaesani qui symbolisent une communauté de destin. Je me sentirais, en effet, en proie à une extranéité qui me couperait de mes racines.
Je ne juxtaposerais cependant pas en une dichotomie infranchissable un frioulan libérateur et un italien coercitif. Pour moi, l’italien est associé depuis mon enfance à une image de villes éblouissantes et de personnes étrangères ou périphériques. Je pense par exemple au regard que portaient mes amis slovènes sur un pays qui, en, dépit des exactions du fascisme, conservait d’immenses vertus. Une façon privilégiée aussi de percevoir un italien polyphonique, désinvesti de la charge traumatisante qu’il avait pu induire, grâce à des récits humoristiques et grâce aussi à une permanence de l’entre-langue : prosim, nasvidenje, come sarebbe a dire, eh ninin. En outre, le Frioulan est historiquement un migrant si bien que la narration des vicissitudes liées à l’émigration était indissociable d’un rapport de brassage linguistique et d’ouverture, même labile, sur d’autres mentalités et d’autres rapports culturels, économiques et sociaux. Autrement dit, parler le frioulan n’était pas synonyme d’autarcie voire d’ostracisme culturel. Par les confidences des membres de ma famille, d’emigrans, se faisait jour une confrontation à l’envergure cosmopolite. L’expérience de l’émigration se teintait des couleurs de l’épopée et acquérait une portée hétéroglossique, car des récits enchâssés en français, en espagnol, en allemand ou en russe se greffaient sur la trame en frioulan. Ainsi, je revivais la confrontation de mon grand-père avec le milieu ouvrier français en Seine-et-Marne dans les années 1930, les relations de mon père avec des maçons italiens issus de maintes régions de la Péninsule, ainsi que les revendications face à l’exploitation patronale, la longue traversée de ma grand-tante en 1947 de Gênes à Buenos Aires et son installation, comme gringa campesina, au pied des Andes, le retour au pays de Vigi, ancien charpentier de la Transsibérienne, encore imprégné des effluves de la taïga et du panorama grandiose du lac Baïkal.
Quelle langue adopter avec les générations issues de l’émigration ? À quelle nature linguistique appartient le lien intragénérationnel ? Il n’existe pas de réponse univoque tant les situations linguistiques et l’horizon d’attente des interlocuteurs diffèrent voire divergent. D’abord, je vois évoluer quelques francophiles indéfectibles qui ne sont là que pour se prêter au rite du retour au pays de leurs (grands) parents et demeurent plutôt en vase clos, y compris lorsqu’ils essaiment à travers les rues villageoises. Si je les apostrophe en italien ou en frioulan, ils font mine de ne pas comprendre. Heureusement, avec la majeure partie des reduci, j’ai le loisir d’employer une langue hybride franco-frioulane modulée d’après le sujet abordé. En gros, le discours rationnel, professionnel en français, mais les anecdotes et les souvenirs en frioulan. Une conversation où peuvent s’intercaler tout de même des mots et des phrases en italien notamment pour évoquer les événements sportifs. Ah oui, jô, c’impensistu cette fameuse soirée au cinéma paroissial, mais quel film est-ce qu’il nous projetait Don Dionisi ? C’était avec Roger Moore et Tony Curtis. Alors, le plurilinguisme générait des joutes oratoires et des situations cocasses. Comment prononçait-on ? Tony Curtis, en oxytonant à fond, ou plutôt à la fornesse, Tony Curtis qui signifie Tony au couteau. Heureusement, même certains autochtones des années 1975, téléspectateurs avertis, savaient grâce à l’inénarrable RAI qu’il fallait prononcer à l’anglaise, quelque chose du genre Tony Queur:tis. Diatribes phonétiques futiles ou indices de la résonance d’une parole issue d’un film culte ? La conformisation était sans doute déjà en marche et je pourrais rapprocher ce phénomène d’accentuation, en quelque sorte précurseur, de l’engouement actuel des jeunes italiens y compris carniques pour l’accentuation à l’anglaise, de la proparoxytonite, en obédience à la norme médiatique qui vampirise le canon linguistique traditionnel : Furlan au lieu de Furlan, Benetton au lieu de Benetton.
Quant à l’utilité de transmettre le frioulan et l’italien en tant que système de valeurs familiales, culturelles et spirituelles, j’en suis intimement persuadé, même si la différenciation sociologique entre les générations et leur localisation centrifuge forment des entraves indéniables. Suis-je crédible face à la communication intersubjective immédiate, aux media pervasivi, à l’ubiquité contemporaine d’une présence désincarnée qui se mue en absence à soi et à autrui, aux regards qui ne voient pas ou qui glissent subrepticement pour se réfugier dans le virtuel ? N’est-ce pas là un combat d’arrière-garde, une chimère totalement déplacée eu égard aux enjeux planétaires, une régression imposée à mes enfants qui pourraient aspirer à se fondre dans la masse ? Il n’en demeure pas moins que je persiste à croire qu’avec l’amnésie de la langue disparaîtrait inéluctablement la connaissance de l’histoire familiale et locale, ainsi que la capacité de se situer, de se repérer dans l’espace-temps. Ne plus savoir désigner les toponymes, du moins en milieu rural ou alpestre, c’est également saper les postulats transcendantaux, le topos qui conduit à considérer sa propre finitude tout en ouvrant sur un infini qui ne saurait résider dans une technologie qui tendrait à conjuguer anthropocentrisme et déshumanisation.
Les nouvelles générations s’insurgeront peut-être un jour d’être confondues avec des vieux qui, loin de représenter les dépositaires vénérables de leur humbles origines, leur rappelleront trop l’ignominie de ne pas correspondre totalement à l’image consumériste pleine de vacuité et de condescendance qu’ils pourraient avoir introjectée. Ce sentiment d’être déphasé relève, soit, d’une idiosyncrasie, pourtant je me reconnais dans ces lignes de Gesualdo Bufalino : Febbre del consumo, la chiamano, ma meriterebbe un nome più empio. Peste unta ad ogni cantone da manifesti, giornali, insegne, scritte ruvide come pugni. Peste che esala dai video, dagli audio, venticinque ore ogni giorno ; e ci comanda, pena lo scandalo, di correre, di gridare, di vegliare, di ardere[3]. Si l’univers naturel est ravalé à un territoire à réifier, si ses composantes deviennent fongibles, nous assistons à une mutation anthropologique majeure qui transforme la langue hégémonique en un instrument purement pragmatique et utilitaire. Dès lors, le monolinguisme s’apparente à la pensée unique, à l’absence de connaissance véritable du monde et de soi. Il faut au contraire offrir un enracinement salutaire à sa progéniture, parce que ce n’est qu’en approfondissant la recherche de son identité à travers le patrimoine de ses ancêtres, qu’elle accédera à l’altérité du monde contemporain. Tout ne peut être résorbé par l’immédiateté, par l’acceptation délétère d’un statut de consommateur hédoniste. Parler plusieurs langues, surtout si elles reflètent les pérégrinations familiales, signifie garder à l’esprit une certaine conscience de l’humilité et un respect pour autrui quelles que soient sa condition matérielle contingente et son origine géographique, car ton arrière-grand-père, pour que sa joie demeure, percevait la gratuité du don de soi jusqu’au sacrifice de sa vie, car tes grands-parents, après une dure matinée de labeur, savaient égayer une maisonnée en apprêtant une polenta fumante et un délicieux civet de lapin ou une omelette aux cèpes, cueillis au point du jour, dans des sous-bois odoriférants, car tu es un descendant de migrants. La pause méridienne était aussi l’occasion d’une évocation de l’histoire locale, d’une transmission de faits et gestes à l’abri de toute cacophonie. Cette langue frioulane correspondait donc parfois à des moments privilégiés, ne relevant pas d’une convivialité factice, mais d’une disposition sereine et enjouée de l’esprit, comme pouvaient en témoigner les chants de registre élégiaque, commémoratif et protestataire : se biel čascel a Udin, su la plui alte cime, La nave Sirio, Addio Lugano bella. Certes, au quotidien, les enfants issus des familles italiennes, sont soumis de nos jours à une déperdition du cheminement terrestre et du contact avec la faune et la flore sauvages, en raison de notre mobilité motorisée qui avale les distances tout en annihilant le temps nécessaire à la méditation. Mais, précisément, moduler le français, l’italien, le frioulan voire l’allemand et le slovène d’après les personnes chères et ce qu’elles symbolisent enrichit mutuellement ces langues et affine les processus cognitifs.
Je conclurai par un embrasement lyrique, comme si j’avais impérieusement besoin de la poésie en frioulan pour exprimer en quelques vers une profusion de sens.
Las rôes di Navolis
Ta las mons çargneles
Al é distirât il gno paîs
Norbies las sôs tavieles
Par vons e aves, sanes radîs
Fra i monti carnici
È adagiato il mio paese
Ubertose le sue praterie
Per gli avi, sane radici
Discôls ta la sôls, struçâ’l
Zei par mateâ, nulî flôrs,
Cun vôli curiôs, davur il sorğâl,
Spiâ avoles di colôrs
Scalzo nell’andana, ribaltare
La gerla per trastullo, annusare fiori,
Con occhio curioso, dietro pannocchie
Mirare guizzi di colori
Zî’n Zauf pa las fursieles,
Plens di snait, passons
Lizêrs sul mulisit, in Fantigneles
Laips di âghe glassade sot i gravons
Salire in Zauf per le forcelle,
Pieni di estro, passi
Felpati sulle foglie, in Fantigneles
Vasche di acqua algida sotto i canaloni
Glâsines, mûes, frâes
Savôrs sapulîs donge ruvîs,
Mandi salotes, biades plâes
Scrafeades da pacares tal fundîs
Mirtilli, lamponi, fragole
Sapori sepolti presso burroni,
Addio acque zampillanti, misere piaghe,
Spiaccicate da ruspe divoratrici
A spars ta la vile
Cun machines ingartiade,
Cui ca s’inacuars di une sisile
E di dalbides tune çase disbatiade ?
A spasso per il paese
Di macchine ingarbugliato
Chi si accorge di una rondine
E di zoccoli in una casa sbattezzata ?
Scûr e peis tal cûr pens,
Beif businâ dal Tuement,
Sîl limpit e simes lusens
Impeades di amôr ardent
Buio e peso nel cuore pregno,
Bevi sussurro del Tagliamento,
Cielo limpido e cime lucenti
Accese di amore ardente
Fantat, ten a mens,
Sbrissant viars Vinêsie
Onore in San Laurens
Il fornes e la tô glêsie.
Ragazzo tieni a mente
Dileguandoti verso Venezia
Onora in San Lorenzo
Il fornese e la tua chiesa.
Le ç et le ğ frioulans correspondent phonétiquement au son des graphèmes italiens ci et gi. Le -s est souvent chuinté.
Jean-Igor Ghidina, 2009
Texte publié dans l'ouvrage Enfants d’Italiens, quelle(s) langue(s) parlez-vous ?
[1] Elle visait également à expurger les terres irrédentes des enseignants allophones.
[2] Claudio Magris, Microcosmi, Milan, Garzanti, 1997-2001.
[3] Gesualdo Bufalino, Museo d’ombre, Palerme, Sellerio, 1982, p. 19.
