Teresa
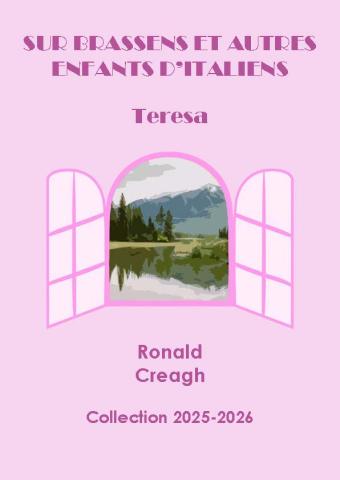
Plutôt maigre, les cheveux blancs, toujours vêtue de noir, Teresa, ma grand-mère, était de
taille assez moyenne, pour ne pas dire petite. Sa famille n’avait pas dû être sans ressources,
car elle avait reçu une éducation assez poussée pour une jeune fille de l’époque : elle parlait
couramment le français, l’italien, l’anglais, et sans doute l’arabe, et jouait admirablement du
piano.
Son père, Antonio Ponelli, originaire de Palerme, était un homme simple et bon, très moral
et physiquement fort, selon ce que rapporte l’un de ses petits-fils, Guido Peroni, neveu de Teresa,
dans un manuscrit qui contient des souvenirs et anecdotes, intitulé Memorie destinate ai giovani.
Selon le même document, la mère de Teresa, Giuseppina Cantà Lamantia, d’origine espagnole,
était une femme de grand jugement. Pour le couple, Port-Saïd, ville nouvelle, créée de toute
pièce en 1859 sur un côté du canal de Suez avec la terre et le sable qui en avaient été extraits,
apparaissait comme une nouvelle mine d’or. Antonio et Giuseppina s’y établirent.
Antonio, qui était contremaître, savait tout faire de ses mains : il fabriqua même des jambes
orthopédiques pour les personnes amputées, ce qui lui rapporta « des livres sterling en or ». Il prit
en adjudication la construction de bâtisses, notamment celles qui sont situées le long du port et
qui portèrent longtemps le nom de leurs propriétaires, rappelant le caractère cosmopolite de la
ville : Hasyck, Royle, Laheta, Zikeklis, etc.
Antonio était un homme honnête et bon. Lors de la grande fête musulmane, ses ouvriers
venaient lui offrir des gâteaux traditionnels. Ses factures n’étaient jamais contestées et il effectuait
les réparations sans donner de devis tellement ses clients lui faisaient confiance. Aussi mourut-il
dans la pauvreté.
Giuseppina, sa femme, était généreuse elle aussi. Enfants et amis faisaient appel à elle lorsque
se manifestait quelque maladie. Il arriva même qu’elle dût loger plus de vingt personnes à la fois :
il fallut mettre plusieurs tables comme pour un banquet et à cette occasion on tua deux porcelets.
Excellente cuisinière, elle transmit cette qualité à ses filles.
Le couple donna la vie à plusieurs enfants, Amedeo, Paoletta, Antonietta, plus jeunes ou
plus âgés que Teresa, qui ainsi, fort heureusement, se trouva bien entourée. Son frère Amedeo
épousa une Écossaise ou une Anglaise. Il s’installa probablement au Caire, mais les contacts avec
la famille à Port-Saïd étaient assez fréquents pour que j’aie gardé le souvenir de ses enfants, à l’exception de Willy, qui, selon Guido, partit vivre en Éthiopie. Un de ces cousins de mon père,
Toni, me laisse l’impression d’avoir été un homme assez bien établi, mais le reste de la fratrie,
Candido, Giorgio, Pina et Lucy, ne semble pas avoir roulé sur l’or.
Guido était le fils d’une soeur de Teresa, Paoletta. Elle avait épousé Pietro Peroni, dont le
père était ébéniste à Faenza, en Italie, et possédait une entreprise d’au moins une douzaine
d’ouvriers. Il était propriétaire de sa maison ainsi que de l’atelier au rez-de-chaussée. Pietro avait
travaillé en Italie, à Trieste, pour une entreprise dirigée par un certain Singer, qui s’occupait du
transport d’animaux vers l’Europe pour le compte du marchand Carl Hagenbeck. Dans son
manuscrit, Guido rapporte quelques anecdotes que lui racontait son père. Parmi les animaux
qui avaient été débarqués, il arriva qu’une fois, sans être vu par les douaniers, un éléphant avait
mangé le contenu de deux ou trois caisses d’oranges et en avait eu une indigestion. Le vétérinaire,
appelé d’urgence, alla courageusement enfiler son bras jusque dans l’estomac de l’animal lequel,
humilié, résista passivement et patiemment. Il arriva aussi que deux éléphants prirent la fuite
dans les rues de Trieste avec leurs cornacs respectifs pendus à leurs oreilles ; il fallut partir en
voiture pour les capturer. Une autre fois, une panthère noire avait gratté pendant une moitié
de la nuit la partie la plus délabrée du sol de sa cage pour tenter de s’enfuir. Pietro fut appelé à
la maison des gardiens et dut s’armer d’un revolver pour aller dormir dans le hangar aménagé
comme ménagerie ; mais il préféra s’enfermer dans une cage vide où il se fit mettre un matelas
et s’endormit du sommeil du juste.
C’est ainsi que, connaissant son intérêt, et sans doute surtout ses compétences en matière
d’animaux sauvages, l’entreprise Singer le muta à Port-Saïd pour y organiser un centre de transit
où les bêtes fauves attendaient d’être transférées par bateau vers Hambourg ou d’autres zoos en
Europe. Ce fut probablement dans ces circonstances qu’il en vint à connaître son futur beau-père
sicilien et surtout sa très belle fille, Paoletta, qui avait alors dix-sept ans. Pietro et Paoletta eurent
plusieurs enfants : Guido était l’aîné et fut suivi par Arduino, Lisa, Dora, Tomy et Pina.
Parmi ces cousins de mon père, j’ai surtout connu Guido, qui épousa une Aveyronnaise,
Blanche Lafont. Ils eurent deux filles, Paulette et Marcelle. La famille vivait à Gênes et venait
nous rendre visite à Port-Saïd. Paulette, qui travaillait comme secrétaire dans la grande compagnie
de navigation Costa, à Gênes, acquit après sa retraite une certaine notoriété dans le monde de
l’art du macramé et du tissage, une notoriété dont on trouve encore des traces sur la toile.
Une autre des soeurs de Teresa, Antonietta, plus jeune qu’elle, vécut un certain temps à Port-
Saïd. Elle gérait probablement une des maisons que leur père avait construites. Il semble que la
gestion consistait surtout à suivre les rebonds d’un procès fait aux usagers qui avaient fini par se
l’approprier. Antonietta, Zia Nina comme nous l’appelions, devint sans doute la plus aisée de la
famille, grâce à un mariage avec Siméon Achcar. Tous deux s’installèrent plus tard définitivement
dans la ville de Gênes, avec leur fille Gina qui fut ma marraine. Celle-ci, par mariage, s’associa
à la famille Preti dont la pâtisserie était un sujet de conversation familiale. Antonietta revint
rendre visite à sa soeur peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle partageait sans doute
l’enthousiasme des Italiens pour Mussolini : elle nomma en effet son petit chien Nasibu, du
surnom qui avait été donné au Négus.
Ainsi frères et soeurs, neveux et nièces étaient nombreux, surtout au Caire, et Teresa ne fut
jamais trop seule car tous venaient souvent lui rendre visite à Port-Saïd.
Teresa épousa le fils d’un employé d’entrepôt londonien, Edward, qui transitait par le Canal
de Suez sur un navire où il était ingénieur électricien. Elle l’avait suivi en Angleterre chez ses
beaux-parents ; ils y vécurent un certain temps. Pourquoi le couple revint ensuite en Égypte est
un des nombreux mystères entretenus dans la famille. Leur fils Laud naquit à Port-Saïd ; Amedeo
Ponelli accompagna Edward Creagh pour déclarer sa naissance au consulat britannique, comme
l’indique sa signature sur l’acte d’état-civil.
Quand l’enfant eut atteint les deux ou trois ans, son père déserta le foyer conjugal et on
n’en entendit plus jamais parler. Peut-être avait-il été séduit par quelque belle Égyptienne moins
austère que sa Sicilienne : Laud me raconta plus tard que sa mère n’était sans doute plus la
seule femme d’Égypte à porter le nom de Creagh, son mari. Pour employer une des expressions
favorites de Teresa, Laud allait devenir plus tard « son bâton de vieillesse ».
Femme seule au foyer, Teresa trouva son principal soutien, l’appui psychologique et surtout
religieux dont elle avait besoin, en la personne de son directeur de conscience, don Gerbo, un
prêtre salésien italien, pas très grand lui non plus, doté d’une énorme barbe noire et de cheveux qui
disparaîtraient progressivement avec le temps. Elle le rencontrait régulièrement au confessionnal
de l’église italienne de Port-Saïd. C’était sans doute son seul contact, hors de la parenté, avec
la communauté italienne qui était très active et bien implantée dans l’ensemble du pays. Il est
possible que la confession permît à Teresa de maintenir les liens avec la langue de son enfance
car désormais, à Port-Saïd, on parlait surtout le français. Quant à l’anglais, elle le réservait aux
moments privilégiés où elle nous rappelait à nos obligations : Little children go to bed. Quant
à notre père, il devait insister pour que nous parlions anglais et n’oubliions pas nos origines
britanniques. Il me reste aussi quelques traces d’une comptine que nous répétait souvent ma
grand-mère, mélangeant divers idiomes dont sans doute des éléments de l’espagnol de sa propre
mère. Je la retranscris comme je m’en souviens :
Chico ratita Martina,
Qué moça
Qué fiorita que sta
Ti volie casar conmico ?
E tu comerà ?
À deux rues de la maison se trouvait un couvent de religieuses, les soeurs de l’hôpital de la
Délivrande. Celles-ci envoyaient régulièrement des élèves auxquelles ma grand-mère donnait
des cours de piano. Le dimanche, durant les messes et même en semaine pour quelque fête
religieuse, Teresa accompagnait le chant des cantiques sur l’harmonium de la chapelle. Ainsi
Teresa mena-t-elle une vie partagée entre la famille et les gens d’église. Mais elle nous légua, à
son fils et à moi, l’aîné de ses petits-enfants, l’amour de la musique de chambre et de la musique
classique en général.
Il lui fallut élever son fils, ce qu’elle réussit avec brio : Laud fut envoyé au Collège des Frères
des Écoles chrétiennes plutôt qu’à l’école italienne. À ce sujet, son cousin Guido raconte qu’à
cause de la somme excessive qu’il fallait verser au Collège des Frères, quarante francs plus,
souvent, cinquante francs pour les livres, alors que dans sa famille on gagnait tout juste deux cent
cinquante francs par mois, on profita de l’ouverture des écoles italiennes pour lui faire changer
d’établissement, ce qu’il regretta amèrement :
Les écoles italiennes furent créées justement à cette époque et mon père nous
y inscrivit, mon frère Arduino et moi. Quelle différence. Chez les Frères des Écoles
chrétiennes, discipline de fer. Comportement irréprochable. Éducation avant toute
chose. Camarades de classe de notre milieu et même de milieux plus élevés dans
l’échelle sociale. Tandis qu’à l’école italienne, indiscipline, vulgarité des camarades
de classe, surtout des fils de pêcheurs originaires des Pouilles. Une instruction qui,
par rapport à celle qui était dispensée chez les Frères des Écoles chrétiennes, nous fit
beaucoup régresser !! Et cela alla de mal en pis. En trois ans, les bons élèves que nous
étions étaient presque devenus des élèves indisciplinés ! Quelle erreur (ou plutôt quel
malheureux événement !). Mon père fut obligé de nous remettre chez les Frères et au
bout de trois ans nous dûmes redoubler la classe que nous avions quittée trois ans plus
tôt ! Une vie ratée !
Ce jugement, exprimé sur le tard (Guido a cinquante-sept ans lorsqu’il met ses souvenirs sur
le papier), reflète le préjugé que les Italiens du nord ont souvent à l’égard de leurs compatriotes
du sud. Sans compter qu’il existait une hiérarchie non écrite entre les diverses nationalités.
Les Français étaient tout en haut, suivis de près par les Anglais. Les Maltais, quoique plutôt
italianisants, se proclamaient haut et fort britanniques. Puis venaient les Italiens et les Grecs.
Et tout en bas les Égyptiens. En réalité, ces différences se fondaient surtout sur les revenus
financiers inégaux. Il est possible que les élèves des Salésiens aient appartenu à des familles plus
pauvres. Ayant enseigné dans leur école, je n’ai guère eu l’impression d’enfants particulièrement
indisciplinés, bien au contraire.
Laud ne semble pas avoir eu une enfance défavorisée. Port-Saïd n’était sans doute pas la
ville la plus excitante du monde, mais il y avait les cousins et cousines et surtout la culture qui,
avec le souci d’être au fait de l’actualité, furent des grandes passions de sa vie. La variété des
points de vue qu’il découvrait, l’idée d’un monde toujours en progrès nourrirent ses convictions
jusque tard dans la vie et lui permirent de s’assurer une totale indépendance intellectuelle qu’il
convenait, bien sûr, de masquer soigneusement, car il était de nature timorée. Ouvert à toutes
les nouveautés, il s’intéressait à la culture physique et au naturisme : la maison était décorée de
photos encadrées où l’on voyait des jeunes gens et jeunes filles nus. Ils ne disparurent, sous les
recommandations de Teresa, que lorsque j’atteignis les huit ou neuf ans. J’étais l’aîné, j’allais
entrer dans l’adolescence, il fallait donc bannir toute tentation de péché.
Après ses études, Laud réussit à trouver un très modeste emploi de comptable à la société
Worms & Cie, entreprise qui assurait les formalités et le ravitaillement des navires en transit
sur le Canal de Suez. Il s’inscrivit aussi dans un club de correspondance, ce qui lui permit de
faire la connaissance d’une jeune femme de religion maronite, Gladys, qui était née dans la
grande cité d’Alexandrie où elle vivait avec sa mère et sa tante. Les deux jeunes gens prirent
l’initiative, audacieuse pour l’époque, de partir en camping au Liban. Gladys devint l’épouse de
Laud et lui donna trois enfants : Ronald, Audrey et Frank. Mon nom de baptême n’avait aucun
rapport avec un quelconque saint, mais faisait référence à un grand séducteur du cinéma muet,
Ronald Colman. Le grand plaisir de mes parents était la danse, qu’ils pratiquaient à l’occasion
des fêtes ou même à la maison, avec une grande élégance. Dans la vie quotidienne, Gladys faisait
le marché, – elle parlait couramment l’arabe – tandis que la cuisine était dirigée par Teresa,
aidée par une femme de ménage égyptienne. La famille se nourrissait à la manière italienne :
macaronis, spaghettis et autres pâtes, tandis que pour les fêtes maman révélait à son tour ses
dons pour créer des spécialités libanaises qui faisaient le délice de ses enfants.
Teresa ne dirigeait pas que la cuisine : c’était la mamma sicilienne de la maison. C’est elle
qui prit en main l’éducation des deux premiers petits-enfants, ce que notre mère semble avoir
d’ailleurs bien apprécié, car elle préférait nous conduire à la plage durant les nombreux beaux
jours de l’année, où elle nous surveillait tout en s’activant à quelque éternel travail de tricot.
Teresa rendait régulièrement visite à ses amies de Port-Saïd, mais ne les recevait que très
rarement à la maison ; c’était plutôt sa belle-fille Gladys ou son fils Laud qui accueillaient les leurs
au domicile commun. Il y avait notamment une famille, sans doute de parenté plus
lointaine, chez qui nous nous rendions assez régulièrement, ma grand-mère et moi, Zia
Françoise et ses enfants. Ceux-ci étaient de jeunes adultes, Berty et Claudine ; cette dernière
devait plus tard se marier avec un cuisinier et partir vivre en Australie, de sorte que les liens se
prolongèrent au-delà de l’Égypte.
Outre les soeurs de la Délivrande et les Salésiens, Teresa était aussi en étroite relation avec
les religieuses du bon Pasteur. C’est là que je fus placé à l’école maternelle, sans doute le seul
garçon au milieu d’un tas de petites filles. Cela ne dura pas très longtemps car un jour je revins
à la maison en sanglotant. J’avais été puni, on m’avait mis un bonnet d’âne et j’avais été envoyé
au piquet. Je crois que mon séjour chez les soeurs prit fin ce jour-là.
Lors de la déclaration de la guerre de 1939, la communauté cosmopolite de la ville se trouva
soudain à un tournant de son histoire. L’Allemagne et l’Italie étaient en guerre avec la France et
la Grande-Bretagne et leurs avions viendraient bombarder Port-Saïd. Tous les hommes italiens
furent placés dans un camp de concentration. Une des épouses, Irma Amato, amie de Laud et
Gladys, mes parents, logea chez nous pendant quelque temps. La Casa d’Italia, de pure architecture
fasciste, où Laud allait souvent jouer du violon avec l’orchestre italien, fut définitivement fermée.
Lorsque la guerre fut déclarée eut lieu une grande réunion familiale dans la salle à manger, avec
les cousins du Caire. À un moment donné, Laud quitta la table ainsi que sa mère et tous deux
vinrent au salon où je me trouvais. Teresa s’adressa à Laud :
« N’oublie jamais que je suis italienne ! »
