Une fille de ritals professeur de français
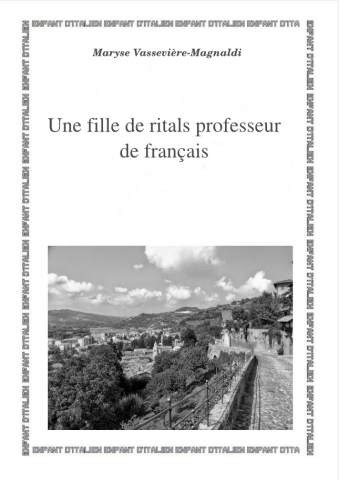
Mon itinéraire tient en peu de mots : j’étais fille d’immigrés italiens et je suis devenue professeur de français. Et il y a évidemment un lien entre les deux… À l’origine de cela il y a peut-être l’inévitable racisme dont sont victimes les immigrés, les Italiens autrefois, dans les années cinquante, comme les Maghrébins aujourd’hui. Ma Provence natale était peu accueillante aux immigrés italiens, parce que c’étaient des « gens de peu[1] », des bûcherons, des ouvriers agricoles, des maçons qui avait fui la misère de leur pays, de leur région – essentiellement les vallées pauvres du Piémont – dans l’espoir de trouver du travail en France, en faisant les travaux pénibles que déjà les Français répugnaient à faire. Et lorsque les études m’ont fait sortir de ma condition sociale et que le mariage m’a fait perdre mon nom italien, il s’est trouvé une mauvaise langue de mon village où l’on n’aimait pas beaucoup les « bàbi[2] » pour dire que j’héritais d’un bien joli nom et que je gagnais au change… La question de la langue parlée par les enfants d’immigrés est donc pour moi intimement liée à celle de la dure condition de l’immigré et au corollaire de l’intégration.
Je parlerai donc des souvenirs de mon enfance et de ceux de ma mère venue en France après son mariage en 1948, car l’immigrée c’était elle, mon père ayant quitté l’Italie à sept ans en 1926, ayant grandi en France, ayant même acquis la nationalité française en 1936 par la naturalisation de sa mère, mais ayant tout de même fini après la guerre, les aléas de l’histoire, de l’histoire familiale et de l’amour aidant, par aller prendre femme dans son village natal du Piémont.
Le nécessaire oubli de la langue
Ma mère, c’était donc elle l’immigrée : une nouvelle fois, après avoir connu l’émigration en Argentine dans sa propre enfance, il lui fallait affronter l’exil en France où allait se dérouler sa vie. Elle qui avait d’abord quitté l’Italie petite fille de quatre ans sans être encore jamais allée à l’école et ne parlant que le dialecte piémontais, elle qui avait d’abord appris l’espagnol à l’école de la pampa pour les immigrés italiens et n’avait vraiment appris l’italien aux cours du soir qu’à son retour en Italie à seize ans en 1938, voilà qu’il lui fallait encore quitter l’Italie, et définitivement, et qu’il lui fallait apprendre une langue nouvelle qu’elle ne connaissait pas. C’est en même temps que ses enfants qu’elle apprendrait le français. Elle finira par le parler très bien, sans le moindre accent mais sans savoir l’écrire correctement : ses lettres seront toujours en italien.
Mon père, lui, était déjà intégré : il parlait et écrivait admirablement le français, ayant suivi ses études primaires en France jusqu’au certificat d’études. L’instituteur aurait voulu le pousser à continuer mais à onze ans, à la mort de son père, il est allé travailler comme manœuvre à la scierie du village. Il ne parlait donc que français avec ma mère : pourtant il savait aussi le dialecte qu’il parlait lors de ses séjours dans sa famille au Piémont et il savait aussi assez d’italien – à la mort de son père on l’avait envoyé dans la famille italienne pour quelques mois, il était allé à l’école et avait rattrapé trois années en une – pour en faire la langue de sa correspondance amoureuse avec ma mère quand elle vivait encore en Italie… Car pour ma mère, il n’était pas question de rester une déracinée, il lui fallait s’intégrer, ce qui signifie se faire oublier comme étrangère, oublier sa différence et devenir comme les autres : il lui fallait devenir une Française à part entière, et pour cela s’approprier une langue qu’elle n’avait jamais étudiée. Comme elle me le répète souvent maintenant, pour ne pas handicaper ses enfants, pour permettre notre intégration, elle a voulu nous donner le français comme langue maternelle : il lui fallait donc un peu oublier la sienne et apprendre vite la langue du pays qui était maintenant le sien. C’est ce qu’avant elle avaient fait sa belle-mère et ses belles-sœurs, qui parlaient en français ou même en provençal entre elles, parfois piémontais avec elle, mais jamais italien. C’est à ce prix que le français serait ma langue maternelle tout en n’étant pas celle de ma mère. Paradoxe de cette langue maternelle[3].
Du plus loin qu’il me souvienne j’entends ma mère parler français et je ne me rappelle pas l’avoir entendue baragouiner cette langue : peut-être cela s’est-il produit au début mais elle a dû l’apprendre assez vite, en même temps que moi. Sa langue maternelle à elle de toute façon c’était le piémontais : peut-être me l’a-t-elle parlé quand j’étais bébé ou dans son ventre, peut-être m’a-t-elle chanté des comptines dans sa langue et cela a-t-il laissé des traces…
Mais à Cuges où nous habitions, comme ailleurs en Provence, les Italiens ne se réunissaient pas, il n’y avait pas de culture de l’exil mais le nécessaire oubli de la langue car c’était là le dilemme de l’intégration. Peut-être même y avait-il une certaine honte à surmonter : pour entrer dans une vieille famille provençale, comme l’a fait une de mes tantes, ne fallait-il pas oublier jusqu’à ses origines, et accepter que sa propre fille lui reproche de porter des espadrilles vertes, aux couleurs de l’Italie…
Pas de langue italienne donc dans le quotidien de mon enfance, sauf quand à Noël nous avions la visite de mes grands-parents, toujours chargés d’un beau panettone pour les fêtes : ni en famille, ni à l’école entre enfants d’immigrés, ni à la radio où l’on écoutait des stations bien françaises qui donnaient les informations, le « disque des auditeurs » ou la publicité Paul Beuscher. Pourtant…
Mais le doux refuge des racines
Pourtant la langue italienne est entrée dans mon cœur et l’Italie a été mon paradis perdu de l’enfance… Car si ma mère avait tenu à réussir son intégration, elle n’en avait pas pour autant oublié ses racines, comme c’était un peu le cas dans la famille de mon père : chaque année nous sommes allés passer les vacances d’été dans la ferme de mes grands-parents maternels au Piémont. Mon père était ouvrier, il avait des congés payés, et chaque été nous partions en Italie, souvent sous le regard désapprobateur – mais peut-être aussi envieux – des villageois et de la famille de mon père : qu’avions-nous besoin de dépenser notre argent en un voyage coûteux et de manifester notre amour pour un pays qui n’était pas le nôtre ? Et pourtant si, c’était encore le nôtre, et jamais mes parents n’auraient raté ce merveilleux rendez-vous annuel, qui était aussi un ressourcement dans les affections familiales et dans la langue.
Car pendant un mois, nous ne parlions plus français, sauf un peu entre nous. Nous étions ouverts à d’autres langages, d’autres habitudes, d’autres nourritures, d’autres fêtes. C’est donc ainsi que j’ai appris l’italien et le piémontais : sur le tas. Paradoxe aussi de ce bilinguisme qui n’en était pas vraiment un[4]… J’ai appris le piémontais d’abord, en le parlant avec mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes cousins. Il y a chez moi une véritable délectation du dialecte, si bien qu’aujourd’hui encore, même si je ne parle plus le piémontais comme c’est le cas de tout le monde au Piémont, je me régale à l’entendre parler encore par quelques vieilles personnes ou quelques jeunes originaux écologistes, dans ma famille même, qui veulent en maintenir l’usage contre l’uniformisation culturelle de la société de consommation, comme je vibre d’une joyeuse connivence quand j’en découvre des traces dans quelque roman d’Umberto Eco par exemple[5].
Mais j’ai appris aussi l’italien en l’écoutant dans les magasins, en le parlant avec des visiteurs de ma famille, des vacanciers, des enfants des villes en vacances à la ferme et qui ne parlaient pas le dialecte. Merveilleux baragouin des enfants : j’ai appris l’italien pour jouer à la marchande avec Maria Grazia, et une génération plus tard ma fille a fait de même, qui de temps en temps interrompait son jeu et accourait au grand galop demander à sa grand-mère les mots qui lui manquaient pour continuer à jouer (« Mémé, comment on dit… ? »). Si bien que l’italien aujourd’hui a toujours pour moi cette saveur du paradis perdu de l’enfance.
J’ai tout de même appris l’italien au lycée et avec lui découvert la littérature italienne, puisque de tout temps il était dit que je choisirais l’italien comme langue vivante. Si l’italien n’a pas pu être ma première langue au lycée où l’anglais dominait, il l’est devenu en classe préparatoire et à l’ENS de Fontenay, où Claude Perrus qui enseignait l’italien, m’a convaincue sinon d’abandonner les Lettres Modernes, du moins de faire une double Licence au Grand Palais. Mais je n’ai pas poursuivi l’italien au-delà de la Licence : je ne pouvais pas être professeur d’italien, il fallait que je sois professeur de français, moi fille d’immigrés italiens, peut-être pour répondre au souhait secret de mes parents.
Puis mes rapports avec l’italien comme langue savante et objet de recherche se sont distendus, mais j’ai continué à maintenir le lien avec la langue vivante en allant toujours en Italie pour les vacances d’été : c’est ainsi qu’à leur tour, mon mari et ma fille ont aussi appris l’italien sans l’avoir jamais étudié au lycée mais en le parlant avec ma famille italienne où l’usage du dialecte a maintenant disparu, à quelques exceptions près.
L’italien sera donc toujours pour moi – aura donc toujours été – malgré tout une langue familiale, sinon une langue maternelle. Paradoxalement, à la fois une langue occultée, oubliée et une langue chérie, une langue de l’affectif et de la mémoire, car pour moi, comme pour ma mère et mon père, il y avait les deux côtés de la langue et de l’identité : la France et l’Italie[6], le réel et les vacances, l’intégration et les racines. Pas plus que ma mère, je n’ai répondu à l’humiliation d’être étrangère en me réfugiant dans la langue : comme ma mère avait affronté cette douleur de l’exil en apprenant à parler français sans accent, j’ai surmonté celle des insultes anti-italiennes de certains de mes petits collègues de la communale, provençaux de souche, en devenant professeur de français. Il y a là une sorte d’ivresse et de fierté que j’imagine doivent éprouver aussi mes étudiantes de CAPES, jeunes beurettes de banlieue entrées à l’université et qui se retrouveront à leur tour professeurs de français.
Maryse Vassevière-Magnaldi, 2007
Texte publié dans l'ouvrage Enfants d’Italiens, quelle(s) langue(s) parlez-vous ?
[1] J’emploie ici le terme du sociologue et philosophe Pierre Sansot qui a magnifiquement étudié la culture populaire dans son livre Les Gens de peu, PUF, 1991.
[2] Il me faudrait faire une longue note sur ce mot d’infamie venu d’on ne sait quelle langue, et dont, tout comme mes parents, j’ai senti les effets dévastateurs dans mon enfance. C’est le nom méprisant et malveillant qu’en Provence on donnait aux Italiens, le mot « rital », manifestement « parisien » et argotique, étant inconnu dans mon village près d’Aubagne pour désigner les Italiens. Ce mot n’évoque rien en français ni en provençal et cela n’a évidemment rien à voir avec le « baby » anglais. Par contre en piémontais, ce mot existe et désigne le crapaud… comme si l’injure raciste était plus cruelle d’être dans la langue de la victime. Ou faut-il y voir un lien avec le radical onomatopéique bab- que l’on retrouve dans de nombreuses langues pour exprimer le mouvement des lèvres (en langage populaire dans le Midi « faire les bèbes » c’est faire la moue) et en français, selon Pierre Guiraud, dans plusieurs mots (baba, babiole, babouin). Comme par une sorte de retour à l’italien, le « bàbi », ce babouin, serait le babbeo, un niais à grosses lèvres… Pas besoin d’être noir pour susciter l’expression physique et injurieuse du refus : il suffit d’être italien et pauvre…
[3] La problématique aujourd’hui n’est plus du tout la même pour ma fille qui a fondé une famille franco-allemande à Berlin. Elle parle français à son fils qui ne parle pas encore et qui entend son père parler allemand : comme pour tous les enfants bilingues, le français et l’allemand seront ses deux langues maternelles… Il faut dire que sa mère n’est pas en situation d’immigrée et que le milieu social et culturel n’est plus celui de son arrière-grand-mère, dont d’une certaine manière ma fille reproduit l’itinéraire en choisissant de vivre loin de son pays natal. La manière dont les jeunes couples européens d’aujourd’hui (franco-allemands ou franco-italiens ou italo-allemands) posent et vivent la question du bilinguisme avec leurs enfants était impossible à imaginer pour la génération de ma mère, parce que c’était une immigration de la misère qui touchait des catégories sociales défavorisées : en choisissant de ne pas nous parler italien, ma mère voulait nous aider à mieux réussir à l’école. Peut-être le sacrifice de sa langue était-il trop lourd et se trompait-elle ? Je ne le crois pas, si l’on voit le parcours scolaire des enfants d’autres immigrés, espagnols, portugais ou maghrébins de mon village dans les années Cinquante et Soixante et si l’on se souvient du handicap de la langue dans l’échec scolaire.
[4] Car c’est moi qui baragouinais le piémontais et l’italien. Ainsi je me souviens d’avoir bien fait rire les jeunes amies de mes tantes encore à marier, en leur racontant notre voyage à Turin lors de l’exposition « Italia 61 » et en leur expliquant le saint Suaire (« ‘l lünse und ‘l fü anvurtuia nussgnur »… j’essaie de transcrire comme je peux…). Des phrases surnagent ainsi dans ma mémoire, comme ces proverbes ou aphorismes que ma mère aimait répéter dans sa langue – car elle n’avait pas leur équivalent en français ou pour leur donner plus d’autorité – : « erba voglio non ce n’è, nemmemo nel giardino del re », pour faire taire nos caprices, ou « ci sono solo le montagne che non s’incontrano », cela dit plutôt en piémontais et pour formuler une sorte d’optimisme fondamental. Et aussi quelques chansons inoubliables : Quel mazzolin di fiori, La montanara, Bella ciao…
[5] Pas besoin de note pour comprendre les phrases en piémontais insérées dans Le Pendule de Foucault…
[6] Dans mon enfance, des cousins de mon père me demandaient quel pays je préférais, la France ou l’Italie, et cette question m’irritait : c’était une fausse question car il était évident que j’étais française…
