L'arrivée à Bruxelles
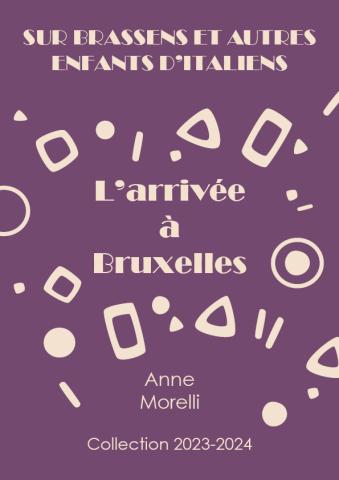
L'arrivée à Bruxelles
Mes grands-parents paternels ont eu un itinéraire migratoire qu’on classerait aujourd’hui dans l’immigration politique. D’extraction bourgeoise (lui capitaine au long cours, elle directrice de la première école Montessori de Naples), leur antifascisme et leurs sympathies pour le communisme de Bordiga, fondateur du Parti communiste d’Italie, plus tard exclu du Parti pour avoir critiqué Staline, les ont obligés à quitter l’Italie de Mussolini.
Ils ont vécu pendant huit ans en Union Soviétique, puis ont connu – avec cinq enfants – une vie d’errance. Il leur était impossible de rentrer en Italie. Le dossier de Nonno au Casellario politico centrale, le fichier politique central conservé aux archives de Rome, mentionne effectivement qu’il est un « communiste trotskyste dangereux à arrêter à la frontière ».
La Suisse, après un an de réflexion, leur refusa le permis de séjour et la France les expulsa alors qu’ils avaient transporté leurs pénates dans un village de Haute-Savoie et commencé à s’y « intégrer ». Les solutions encore possibles n’étaient pas légion et la Belgique avait le double avantage d’être francophone et d’abriter à Bruxelles un petit noyau de bordighistes (ces communistes « oppositionnels » étaient bien représentés dans l’immigration italienne en Belgique), dont certains étaient connus de Nonno, déjà à Moscou ou en Italie. C’est ainsi que par un beau 1er mai la famille Morelli débarqua en Belgique.
Alors que sur d’autres péripéties familiales les témoignages que j’ai recueillis concordaient, l’« accueil » reçu en Belgique a fait l’objet de points de vue très différents selon les membres de la famille. Nonna était dithyrambique quant à l’accueil de ce petit pays qui, au contraire des précédents, leur avait permis d’y vivre paisiblement (ou presque !) jusqu’à la guerre au moins. Mon père et ses frères ne partageaient pas son enthousiasme. Ils m’ont souvent parlé des humiliations subies à l’école, des instituteurs racistes ou de l’infirmière qui refusait de soigner les enfants de « ceux qui viennent manger notre pain ». Mais aussi, en parallèle, ils ont évoqué avec reconnaissance ce professeur qui s’est rendu compte que s’ils ne suivaient pas, ce n’était pas par manque d’intelligence mais parce qu’ils ne connaissaient que les caractères d’écriture cyrilliques et leur a offert un cahier d’écriture à trois lignes pour y faire des exercices qu’il proposait et corrigeait bénévolement. Il y eut aussi le médecin qui obligeait l’infirmière à soigner « même les enfants étrangers » ou cette famille de province qui accueillait chaleureusement mon père, simplement parce qu’il était l’ami rencontré en milieu scolaire de leur fils.
Nonno intervenait peu dans ces témoignages contradictoires. Il évoquait en riant les mille francs (une somme énorme à l’époque) que le commissaire de police de Bruxelles lui avait extorqués à titre personnel pour prix de la régularisation du séjour de la famille. Mais il ne nous a jamais parlé de l’arrêté d’expulsion, reçu en 1939, que la guerre empêcha d’exécuter et dont j’ai découvert l’existence bien après sa mort. En revanche, il nous a souvent expliqué toutes les difficultés à pouvoir louer à Bruxelles un logement pour une famille italienne, qui plus est avec cinq enfants ! Lorsqu’il voyait l’annonce d’un logement libre, il téléphonait mais, débusqué à cause de son accent, il s’entendait immanquablement répondre que le logement avait déjà trouvé preneur. Il s’amusait alors à tout de même obtenir une visite de l’appartement ou de la maison. Sa belle prestance, sa voiture et sa distinction faisaient souvent se raviser le propriétaire mais Nonno décrétait après la visite que le logement était trop petit car il n’y avait qu’une chambre de bonne et que cela aurait obligé la servante à dormir avec le domestique alors que ce n’était pas un couple marié ! Il pouvait ensuite rire intérieurement des solutions ingénieuses proposées par les propriétaires flairant le locataire riche et solvable, solutions qu’il écartait systématiquement…
En réalité la famille de sept personnes resta pendant une année entière dans un hôtel meublé et ses finances furent fortement écornées par cette dépense démesurée. Ensuite elle tâta des médiocres logements du quartier italien de Bruxelles avant de découvrir un vaste appartement. Il faisait partie d’un immeuble de sept appartements, un peu isolé, dans un quartier tranquille. Une veuve de « bonne famille », dont le mari artiste-peintre était mort très jeune, gérait leur location pour les propriétaires. Elle vivait dans un des appartements avec sa mère, veuve d’un médecin militaire, et sa fille adolescente qui commençait des études d’enseignante chez les Ursulines. Lorsque Nonno se présenta pour louer l’appartement libre, la gérante fut aussitôt impressionnée par sa courtoisie et sa bonne éducation. Au retour de l’école elle apprit à sa fille qu’elle avait promis un bail en bonne et due forme à ce monsieur si distingué, italien, père de cinq enfants. L’adolescente la couvrit de reproches : sa mère avait-elle oublié tous les ennuis déjà encourus avec des étrangers ? et des Italiens en plus ! dont les enfants s’avèreraient sûrement sales et bruyants… Elle n’aurait jamais dû accepter. La digne veuve n’avait cependant qu’une parole et le bail fut signé, malgré les reproches de sa fille. Celle-ci poursuivit un temps ses sarcasmes. « Les macaronis sont de sortie » annonçait-elle en les regardant par la fenêtre s’engouffrer dans leur voiture, pour une excursion dominicale. Et quand des amis italiens venaient leur rendre visite et que les chansons napolitaines traversaient le plafond, elle annonçait, moqueuse, à la cantonade : « Le début des lamentations de Jérémie ! ». Mais elle finit par remarquer que l’aîné des « enfants » était en fait un long jeune homme brun, à la moustache séduisante. Quand elle le croisait dans l’escalier il était très courtois et ses amies, envieuses, lui avaient fait remarquer qu’il était très beau parce qu’il ressemblait à Tino Rossi ! Par des ruses fort transalpines (!) il réussit à l’approcher plus régulièrement. En effet la jeune fille était inscrite à un cours de danses de salon et il lui assura que lui aussi brûlait d’apprendre à danser mais que ses moyens d’étudiant ne lui permettaient pas de payer l’inscription au cours. Comme son frère pouvait manier le gramophone, accepterait-elle de lui apprendre chaque semaine les pas nouveaux ? De fil en aiguille, quelques mois plus tard mon père demandait en mariage celle qui allait devenir… ma mère.
Il ne faut jamais dire « Fontaine je ne boirai pas de ton eau » !
