La famille Battista : vie de pêcheur émigré
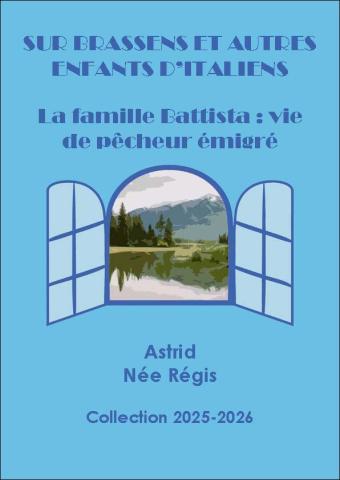
Je suis allée à la rencontre de monsieur Battista, à Sète. Représentant de la troisième
génération d’immigrés italiens, il m’a raconté les détails de la vie de pêcheur italien tels que l’ont
vécue son père et son grand-père.
L’arrivée à Sète
Le grand père d’Éric Battista est originaire de Gaète, près de Rome. Il est arrivé à Sète entre
1880 et 1885, à l’âge de vingt-trois ou vingt-quatre ans, accompagné par des cousins et des amis.
Il était alors célibataire. Il s’est par la suite marié à Sète avec une Italienne et neuf enfants, dont
le père de monsieur Battista, sont issus de ce mariage.
En Italie, son grand-père naviguait pour une compagnie qui possédait des bateaux à
moteur et à voiles. Il était maître-voilier. Il voyageait sur des bateaux qui faisaient le tour du
bassin méditerranéen. Une fois arrivé à Sète, le port lui a plu et il décida de s’y établir quelques
années plus tard, lorsqu’il aurait fait des économies. S’installer dans cette partie de la côte était
pour lui très intéressant car c’est un lieu beaucoup plus poissonneux que celui qu’il pratiquait
habituellement en Italie. Ici, il lui serait plus facile de vivre de la pêche. Ce fut par conséquent
une émigration professionnelle.
C’est généralement en train que les émigrés arrivaient, « avec le ballot sur la tête », mais
certains ont voyagé avec des compagnies de navigation. Ces compagnies possédaient des voiliers
ou des bateaux à vapeurs, sur lesquels les émigrants pouvaient s’engager comme matelots ou
manutentionnaires. Ils descendaient dans le port de leur choix. Le grand-père de monsieur
Battista, par exemple, s’est arrêté à Sète, après avoir travaillé comme matelot durant le voyage.
Il a par la suite fait venir des cousins, des oncles, des amis qui avaient eux aussi besoin d’un
emploi. Lorsque sa famille est arrivée en France, ils ont tous vécu dans la même maison. C’était
pratique pour eux : tous les matins, il tapait à la cloison et réveillait l’équipage pour partir en mer.
Toutes les familles de pêcheurs italiens faisaient de même. Sa femme vendait le poisson pêché
dans la journée. Ses deux sœurs habitaient dans la même maison : ils vivaient tous ensemble et
pour monsieur Battista, « c’est un souvenir qui n’a pas de prix ».
Il garde de très bons souvenirs de cette vie en famille : les repas en commun, la présence
de ses grands-parents, de ses tantes qui s’énervaient quand le grand-père cousait des voiles et
réparait les filets dans le salon. En effet, en plus de la pêche, il fallait entretenir le matériel, « ce
qui, hélas, ne se fait plus de nos jours ».
La vie de pêcheur
Les Italiens venus à Sète de toutes les régions d’Italie ont créé une sorte de communauté de
pêcheurs si unie qu’ils se mariaient et avaient des enfants entre eux. Quand ils étaient établis,
les Italiens faisaient venir leur famille et leurs amis. Ils ont commencé à construire des bateaux
en bois, des barques catalanes (pour la pêche au poisson bleu) ou des bateaux bœufs (car ils
pêchaient à deux). Ils payaient la construction des bateaux petit à petit, à crédit. La première
colonie s’est installée du côté du port, sur le lieu de travail. Leur rythme de vie se faisait en
fonction du temps : pour sortir en mer il fallait du vent, mais pas trop. Les Italiens ont occupé
deux, trois quartiers, qu’on appela « quartiers des pêcheurs ». C’est durant la guerre que les
bateaux et donc la pêche se sont modernisés.
« C’était une époque assez difficile pour les pêcheurs », me raconte monsieur Battista, car
il n’y avait aucune assurance : « si on perdait un filet, une voile, un outil de travail, on ne
remboursait rien ». Les pêcheurs avaient donc une vie très frustre et humble. Mais ils avaient
une vie saine. Ils ne tombaient quasiment jamais malades, mangeaient bien et étaient très en
forme. Ils se levaient à deux ou trois heures du matin et sur les bateaux ils buvaient du vin et
du rhum (boisson traditionnelle du pêcheur). Quand ils n’avaient plus d’argent, ils buvaient du
pastis : c’était leur manière de se réchauffer en pleine mer.
Sur les neuf enfants des grands-parents de monsieur Battista, deux sont devenus pêcheurs,
dont son père à l’âge de douze ans. Tous les enfants de pêcheur faisaient leur service militaire
dans la Marine Nationale. Il fallait par la suite choisir entre la pêche et les études. Le père de
monsieur Battista aurait donc continué la pêche s’il n’avait pas décidé de poursuivre dans la voie
des études. Si les enfants décidaient de ne pas travailler, il fallait dans ce cas-là, absolument avoir
le certificat d’études (le certificat d’études se passait à onze ans). En revanche, s’ils avaient choisi
d’être matelots, ils n’avaient pas de vacances, parce qu’il fallait travailler par tous les temps. Les
pêcheurs travaillaient sans répit.
Les cafés étaient des lieux de rassemblement pour les pêcheurs italiens. À l’époque, il
n’existait pas de centre culturel et les cafés étaient un peu comme une maison de la culture. On
y échangeait des idées tout en buvant « un café dans un verre et non dans une tasse ». Chaque
café avait son groupe de pêcheurs habitués.
Culture et traditions italiennes
Les premières familles d’Italiens à Sète vivaient donc de la pêche, mais avaient aussi apporté
leurs propres coutumes culinaires (les pâtes, les tielles, etc.). L’immigration italienne était aussi
l’immigration d’une population très religieuse. Le grand-père de monsieur Battista, comme
beaucoup de pêcheurs italiens immigrés, était très attaché aux rites de la religion catholique.
Tout le monde était baptisé, allait au catéchisme, faisait la communion et la confirmation et
finissait par se marier. Les enfants matelots étudiaient le catéchisme en mer et devaient ensuite
aller voir les bonnes sœurs pour qu’elles les fassent réciter. La paroisse Saint-Louis à Sète était
la paroisse des pêcheurs et c’était par conséquent la plus riche de Sète car ils faisaient beaucoup
de dons d’argent.
Le culte de la mamma italienne était fort dans les familles d’immigrés. La mère de famille
régnait dans la maison et était respectée de tous. C’est aussi elle qui vendait les produits de
la mer présentés sur un chariot tiré dans les rues de Sète. À cette époque, il n’y avait pas de
glacière et on devait vendre le poisson le jour même. Le respect de la femme, des anciens, des
traditions religieuses et professionnelles, ainsi que la répartition des richesses et des biens étaient
et restent important pour les Italiens. Il n’y avait à l’époque pas d’antagonisme entre le patron et
les matelots, ils repartaient tous avec les mêmes kilos de poissons.
Les Italiens étaient contents d’être en France, car ils avaient une clientèle pour leur pêche.
En Italie tout le monde était fauché, c’était la crise. C’est donc grâce au fruit de leur travail qu’ils
ont pu acheter des maisons et qu’ils se sont installés définitivement.
Intégration
L’intégration des Italiens en France a, selon monsieur Battista, tout de suite fonctionné. La
preuve en est que son père a épousé une Française. À la maison, il fallait absolument parler
français et il fallait aller à l’école. Il était strictement interdit de parler italien. Ceux qui n’ont
pas voulu continuer la pêche sont allés travailler dans d’autres domaines. Monsieur Battista,
par exemple, est devenu professeur d’éducation physique à l’Éducation Nationale. Il y a eu une
dispersion des fonctions des gens, ils ne sont plus devenus pêcheurs de père en fils. Cependant,
lorsque son grand-père est arrivé en France, il était hors de question que les enfants aillent à
l’école, pour lui, ils devaient être pêcheurs. Ce n’est devenu un métier rentable qu’après la guerre.
La modernisation de la flotte (bateaux à moteur) et la possibilité de congeler le poisson ont
permis d’améliorer les revenus et les Italiens ont commencé à faire partie de la classe moyenne.
Les Italiens émigrés à Sète n’étaient pas très bien considérés à l’époque, mais quand ils se
sont mélangés aux Français, toute cette discrimination s’est estompée (voir les noms de famille
italiens dans l’annuaire téléphonique). Ils ont organisé la vie des marins en fonction des fêtes
votives, par exemple la fête des pêcheurs s’est prolongée jusqu’à maintenant (Saint Pierre est le
patron des pêcheurs et de la ville de Cetara).
Ils parlaient entre eux le patois italien et avec leurs enfants, ils s’efforçaient de parler en
français, car il y avait interdiction formelle de parler italien. Monsieur Battista ne parle donc
pas italien, mais il aurait bien sûr aimé avoir appris la langue de ses ancêtres. De ce qui est de la
culture italienne, la transmission s’est faite naturellement : les enfants baignaient dedans (vie en
famille, cuisine italienne, dimanche à la messe, etc.).
L’exemple le plus convaincant de l’intégration italienne à Sète serait celui de François Liberti,
maire de Sète de 1996 à 2001, fils de pêcheur italien. Il est issu de la même génération que
monsieur Battista et ce sont aussi de bons amis.
Communication avec l’Italie
À cette époque, il n’existait aucune communication avec la famille en Italie, on ne recevait
aucune nouvelle (absence de télévision, de téléphone, de journal). De temps en temps arrivait
une lettre. Le grand-père Battista n’est jamais retourné en Italie pour des raisons financières.
Ces immigrés étaient, en quelque sorte, coupés de l’Italie. Ils avaient constitué leur propre
communauté à Sète. Cependant, ils écrivaient à leur famille quand ils avaient besoin d’un
homme d’équipage ou quand il y avait une place disponible à la maison. Monsieur Battista
se souvient qu’un jour sa tante avait acheté un phonographe ainsi qu’un poste de télégraphie
sans fils en 1935-1936. Toute la famille a ainsi pu avoir des nouvelles et écouter des chansons.
Monsieur Battista me raconte que les Italiens sont des amoureux de la chanson napolitaine et
du bel canto.
Aujourd’hui, monsieur Battista n’a quasiment pas de contact avec sa famille d’Italie. Son
cousin s’est rendu dans le village des grands-parents, mais il n’y a trouvé qu’un ou deux Battista,
soit à cause de l’émigration, soit parce que les filles ont changé de nom par mariage.
Pour conclure, monsieur Battista recommande l’ouvrage de son ami Paul-René Di Nitto, De
Cetara à Sète et de Sète à Cetara. De Cette à Sète (Montpellier, Espace sud, 1995).
