Svizzera : la frontiera che mi ha ridato speranza - traduction par Clément Hégray
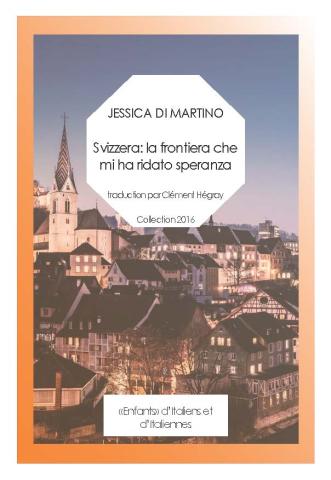
Svizzera: la frontiera che mi ha ridato speranza - traduction par Clément Hégray
C’était un après-midi tranquille, comme tant d’autres chez ma grand-mère. Nous préparions
un thé, c’était l’heure de la collation, elle prenait ses excellents biscuits faits maisons. Nous nous
sommes installés et avons commencé à parler. Je lui ai demandé : « Mamie, ça te dirait de me
raconter quand tu es arrivé en Suisse ? » Elle m’a répondu : « Que veux-tu que je te raconte ?
- Tout ce que tu voudrais me raconter, mamie. » Elle se tut un instant, son regard changea,
elle posa la tasse qu’elle avait en main, soupira et dit : « Par où commencer... »
Mon nom est Antonietta, j’ai soixante-quinze ans et je n’ai jamais baissé les bras dans la vie.
J’ai grandi dans le sud, à Orsara plus précisément, un petit village au nord des Pouilles, dans
une famille d’ouvriers. Moi, la plus jeune des cinq sœurs, à seulement cinq ans je pouvais manger
avec ma famille dans les champs. Chaque matin à l’aube on faisait quelques kilomètres à pied pour
rejoindre le terrain, mais ce qu’on produisait ne suffisait pas nous nourrir. On n’avait aucun salaire,
on avait seulement la campagne, mais elle ne suffisait pas pour qu’on mange tous les sept.
Chaque matin, à quatre heures, nous allions à pied jusqu’à notre terrain, avec nos affaires sur
nous puisque nous n’avions pas de bêtes. Nous n’avions qu’un vieil âne qui est mort peu de temps
après. Nous devions alors faire venir d’autres personnes pour labourer notre terrain, avec leurs
animaux, puis nous, pour les payer, comme nous n’avions pas d’argent, nous allions cinq jour
travailler leurs terres. Tu ne peux pas imaginer ce que signifie ramasser les fèves, récolter le maïs à
la main avec une petite pince de bois, enlever les mauvaises herbes de ces terrains énormes, cueillir
les olives et les fruits, et surtout, travailler pour rien… Je me rappelle que, un jour, je voulais de
nouvelles chaussures parce que les miennes étaient vieilles et me serraient les pieds, mais ma mère
m’a frappé car, l’argent pour les acheter, elle ne l’avait pas. J’avais seulement une paire de
chaussures de cuir, faites par le cordonnier de mon village, que j’utilisais tous les jours pour
travailler dans les champs, puis le samedi et le dimanche je les lavais avec soin. Je les mettais aussi
pour aller à l’église. On n’avait vraiment rien, on mangeait seulement des fruits et du maïs. C’est
tout ce qu’on avait à la campagne. On allait chercher l’eau avec un seau qu’on portait sur la tête.
Nous n’avions pas non plus les toilettes, on faisait nos besoins dans un panier de paille, et on le
jetait ensuite dans un canal commun voisin. J’étais très triste, je me dirigeais vers le désespoir. Tous
les huit jours ma mère finissait la farine et se demandait comment aller en acheter d’autre pour
faire le pain qu’on mangeait. Notre grain ne suffisait pas. En outre, nous étions obligé de vendre
tellement de choses pour acheter quelque chose. Quand on tuait le cochon, on vendait le jambon,
on vendait les œufs des poules pour des allumettes. Tout était rationné. On mangeait un peu de
pain avec des olives, parfois un peu de lard. Et encore, nous étions chanceux car nous avions un
terrain. Quand on allait au four on devait rester attentif car les gens te volaient le pain des mains.
Ce n’était absolument pas facile. Nous avions tout de même une maison, un vieil âne, des poules et
quelques lapins.
Seule notre tante d’Amérique, parfois, nous envoyait des colis contenant des chaussures,
des vêtements et d’autres choses pour vivre. C’était la sœur de mon père, elle était émigrée à
Philadelphie. Cette femme a eu une dure vie. La pauvre, un malheureux du village a voulu
l’emporter loin de chez elle par la force, et elle tomba malade de douleur. Dans ces temps là, les
femmes n’étaient que des esclaves, les hommes s’en fichaient d’elles, les utilisaient seulement pour
procréer, mais se désintéressaient ensuite de leurs enfants.
Mon père, avec l’aide de quelques cousins, est allé la récupérer fusil au poing. Elle ne s’est
jamais faite toucher, elle n’aurait rien fait, et même s’il l’avait épousée ! Le problème était que,
cependant, une fois partie de la maison avec un homme, personne ne l’aurait épousée au village. Ce
n’était pas comme aujourd’hui, où les gens peuvent dormir ensemble même s’ils ne sont pas
mariés. Après cet épisode, vers la fin des années 30, vint un lointain parent d’Amérique, un veuf qui
avait cinq enfants et qui lui proposa de l’épouser. Elle accepta, juste pour partir d’Orsara. Ils
partirent ensemble en bateau et eurent encore après deux enfants.
Mon père, enfant, était stable économiquement parlant, mais ses parents moururent très
jeunes. Ils attrapèrent le choléra et furent emmenés au lazaret du village. La mère mourut à
seulement trente-sept ans, de douleur, après la mort de son mari, du moins c’est ce qu’on m’a
raconté. Ils avaient quatre enfants, le plus jeune avait deux ans et le plus grand, mon père, en avait
seulement sept lors de cet événement. Ses oncles l’adoptèrent, prirent tous leurs biens, deux
maisons et quelques terrains que les parents lui avaient laissé. Ils avaient aussi un trésor, hérité par
mon père, mais des voleurs le lui prirent alors qu’il achetait du linge. Ma vie au village se répétait
globalement jusqu’à ce que j’aie dix-huit ans, jusqu’à ce qu’un jour je reçoive la nouvelle qu’une de
mes sœurs, la seconde, celle partie en Australie quelques temps plus tôt, était décédée. En
novembre 1959, à seulement vingt-quatre ans, elle mourut en couche. La petite qu’elle portait
faisait six kilos et durant l’accouchement, sans césarienne, elle eut un infarctus. La petite mourut en
premier, d’étouffement, puis elle aussi. L’Australie, pour ma sœur, c’était le paradis, elle avait
travaillé comme une esclave au village, mais elle mourut avant de pouvoir en profiter.
Pour cette raison, il y a deux ans, je voulais à tout prix aller en Australie, pour au moins voir
où elle était enterrée. Alors on voulait faire quarante jours de bateau mais on n’en a pas eu la
possibilité. Elle était partie pour l’Australie seulement dix mois avant sa mort, pour rejoindre son
fiancé qu’elle avait connu au village, Gerardo, qui était parti peu avant elle et qui avait trouvé un
travail.
Dans les années 60, un an après la mort de Michelina, voyant qu’au village il n’y avait aucun
espoir mais seulement de la misère, je pris la décision de partir.
Je choisit par ma propre volonté de partir en Suisse. Je n’arrivais plus à vivre, à Orsara, dans
ces conditions d’extrême pauvreté, on ne pouvait rien acheter. C’est ainsi qu’un jour je dis « Ca
suffit ! Maman, papa, je m’en vais ! »
Par chance, un oncle de Michele, mon actuel mari que je connus plus tard, me fit un contrat
de travail et je le rejoignis ainsi à Zurich, là où il travaillait déjà depuis quelque temps. Sans contrat,
par contre, je n’aurais jamais pu partir tellement les contrôles de l’immigration à la frontière Suisse
étaient stricts.
Ainsi, à dix-neuf ans, je suis partie à Zurich, avec mon oncle avec qui je n’avais pas vraiment
de contacts, à part ce voyage en train que l’on fit ensemble. La première impression était plutôt
triste, voir dure. Je ne connaissais pas la langue, je me sentais seule, seule. J’avais deux choses, les
deux petites choses que je possédais et que j’avais apporté dans une valise de carton. A peine
arrivés à la frontière nous fûmes soumis à de multiples contrôles, mais puisque nous avions un
contrat de travail régulier nous n’eûmes aucun problème.
A peine sortis du train, mon oncle m’accompagna rapidement à la cafétéria où j’aurais dû
commencer à travailler le lendemain. Je ne me rappelle plus de quel jour c’était, c’était un soir de
février, je me rappelle seulement qu’ils m’assignèrent une chambre pour dormir, dans laquelle la
patronne m’enfermait à clef. Je ne comprenais pas ce qu’elle disait mais pour autant je savais ce
qui m‘attendait. Le matin suivant, je commençais à travailler. En premier lieu, on me fit peler les
patates avec des machines similaires à celles qui, aujourd’hui, servent à peler toutes choses. Je me
rappelle que c’était une salle pleine de ces machines te que, à la fin des services, on les nettoyait
toutes. Il y avait des petits trous desquels il fallait enlever les résidus de patate avec le couteau
pour qu’elles soient prêtes pour le service suivant. Il y en avait beaucoup, chaque employé
endossait un uniforme et un tablier blanc.
Après quelques temps, un matin, ils changèrent ma mission et du pelage je passais à la
caisse et à la préparation des repas. Mon travail était de servir ceux qui venaient prendre à
manger. Je travaillais ici un an et huit mois, j’appris bien le métier et je commençais à bien
comprendre l’allemand.
Je prenais aussi mes repas en semaine à la cafétéria. Ce n’était pas extraordinaire, mais les
repas étaient diversifiés. Il y avait de la purée, de la salade avec de la sauce, du wurstel… Je
m’adaptais et je mangeais de tout. Certes, pour moi, tout était nouveau, je n’avais jamais rien
mangé de tel. Nous mangions ensemble avec les collègues, mais aucun ne parlait italien alors je
dus me débrouiller en allemand. Même mon oncle, que je voyais parfois, parlait allemand et ainsi,
pour chercher à me faire comprendre je commençais à écouter et un peu après j’apprenais. Ma
famille me manquait, mais je travaillais, je n’y pensais pas, et seul l’argent m’importait. On
travaillait bien et le salaire était très bon, je gagnais aux alentours de cent cinquante francs, qui
équivalaient à environ deux cent mille lires. C’était vraiment beaucoup d’argent. Et tout ce que je
gagnais je le mettais de côté. En fin de semaine, on me donnait cinq francs car la cafétéria était
fermée et que cet argent devait servir pour manger autre part, mais je cherchais toutefois à sauver
le plus d’argent possible. Je me rappelle que j’avais besoin de soigner quelques unes de mes dents
et après quelques temps je réussis à me faire plomber à Zurich par un brave dentiste. Pour ce
travail, je le paya bien cent soixante-quinze francs, plus d’un salaire, mais après soixante ans j’ai
encore une de ces dents.
Je passa presque deux ans à me décider de changer de travail, j’allai chez une riche famille
de Zurich, parce que j’avais senti que le salaire était très élevé comparé à la cafétéria dans laquelle
je travaillais avant. Je fis alors le service sous des combles. C’était un poste sombre, difficile. J’avais
un tapis avec des vers en dessous, ce n’étais pas un très beau post. Ils sonnaient la cloche et je
devais courir pour les servir. Je restai dans cette famille quarante jours puis, comme le travail ne
me plaisait pas et qu’il était très simple, je décidais de partir.
Je trouvai un travail dans une usine, où le salaire était aussi légèrement plus élevé que ce
que j’avais gagné jusqu’à présent. Je dus aussi me trouver une chambre, laquelle était cependant
très loin de l’entreprise, mais pour m’économiser les cinquante francs du tram, je me rendais au
travail à pied. Je devais cuisiner dans ma chambre, j’avais un petit meuble avec un petit four au
dessus et j’essayais de ne rien salir. J’ai toujours été une personne organisée et propre, même dans
ma vie avant que je parte en Suisse. J’allais au bain quand les patrons n’étaient pas là et je cherchais
à être la moins bruyante possible. Ma présence dans cette chambre avait été signalée aux
autorités, pour que je sois sous leur contrôle les jours de permanence et que je paie de suite les
taxes dues. La situation était complètement différente de l’Italie où tout le monde pouvait faire à
peu près tout ce qu’il voulait et où ce genre de contrôle n’existait pas. Là, quand j’étais malade, le
médecin venait vérifier si c’était vrai, et c’était au médecin de décider combien de jours je pouvais
rester chez moi.
Les premiers temps je me mis à travailler à la pièce, mais l’environnement était très sale. On
travaillait aux stores avec quelques ouvriers qui semblaient recouverts d’un matériau noir et sale
semblable au goudron. Après quelques temps ils me mutèrent de poste, j’emballais les bobines de
cuivre dans le carton. J’y suis resté neuf mois et ce fut ma dernière expérience de travail en Suisse.
Mon salaire était très bon et je me fis aussi des amis qui, quand je rentrai en Italie, me firent chacun
un cadeau. Je conserve encore une serviette de toilette qu’ils m’offrirent et aussi une carafe. Les
méridionaux l’appellent terun, mais je n’ai jamais eu de problème. Avec moi, tout les gens que je
rencontrais était toujours très gentils.
A Zurich il y avait aussi une communauté de villageois et quelques fois, le dimanche, après être allés
à la messe, nous mangions tous ensemble. La seule chose est qu’ils étaient vaudois, et moi
catholique, mais je n’ai rien dit. Un grand nombre d’entre eux ne retournèrent jamais en Italie, ils
restèrent là, j’en ai rencontré encore certains il y a quelques temps, les autres sont morts.
Mon départ, bien qu’il fût difficile car j’ai dû laisser ma famille, fut pour moi une sorte de
renaissance. La Suisse était mes Amériques. C’était dur mais je connus un nouveau monde, il y avait
beaucoup de choses que je n’avais jamais visitées comme des résidences de luxe ou même le tram.
Là bas, nous n’avions rien, pour moi, ici, c’était un paradis. Je pouvais aller au marché, et acheter
des pièces de viande. Dans les Pouilles, je n’avais jamais quitté le village, je n’avais même jamais été
à Foggia.
A Zurich je m’adaptai directement. J’appris plutôt bien l’allemand, alors qu’au village je
n’avais même pas la possibilité d’étudier. J’étais très douée à l’école, étudier me plaisait, mais pour
autant je n’avais pas d’argent. Mais étant donnée que j’étais une élève attentive, la maîtresse
m’offrit le livre de cinquième année pour que je puisse finir l’école. Si j’en avais seulement eu la
possibilité, moi aussi j’aurais étudié comme vous. J’aurais tellement voulu le faire, ça m’aurait
beaucoup plu, mais ça n’a malheureusement pas été possible.
Quand j’ai décidé de partir, mes parents furent tout de suite d’accord. Alors, au village, ceux
qui partaient n’étaient pas mal vus. Tous partaient à la recherche d’une vie meilleure, mais si l’Italie
avait été un meilleur endroit, personne ne serait parti pour l’Australie ou l’Amérique. Seulement,
dans les années 60, arriva le boom économique et les gens, plutôt qu’aller à l’étranger, allaient au
nord qui était plus riche et qui était en mesure d’offrir du travail.
Chaque mois je leur envoyais une partie de l’argent que je gagnais pour que ma mère puisse
rembourser les dettes qu’elle avait contractée pour le mariage de sa première fille. Je payai tout,
contrairement à comment se passent les choses aujourd’hui. Dans ces temps, c’étaient les enfants
qui s’occupaient de leurs parents.
Avec l’argent de côté, je m’achetai une jupe et une paire de chaussures neuves. J’achetai une
montre pour mon mari, pour son père et aussi pour mes sœurs Amelia et Maria. J’apportai à ma
mère des couteaux, des couverts, et j’achetai aussi des choses utiles pour la maison. Je fis un
cadeau à tout le monde. Je pouvais, en plus, m’acheter le mobilier pour me marier et ma mère
m’acheta de la lingerie comme cadeau de noces. Je restai à Zurich pendant deux ans et quatre
mois, puis je retournai au village pour me marier avec Michele. Au début je ne le connaissais pas,
mes parents le connaissaient avant, ils nous présentèrent durant des vacances en Italie quand
j’étais à Zurich, et à cette occasion nous nous fiançâmes. Il habitait dans le village, mais il était parti
loin d’Orsara durant de longues années pour son service militaire, à Foggia puis à Trieste, puis pour
chercher du travail à Turin. Avant de se marier, alors que j’étais à Zurich, nous nous écrivions des
lettres pour rester en contact. Certes, après un temps je m’habituai à la distance, et même si je ne
me sentais pas mal en Suisse, mais j’étais toujours à l’étranger, ce n’était pas chez moi. Je décidai
alors de retourner en Italie.
Alors nous sommes mariés, dans ces temps où les gens n’avaient rien, ni même l’eau ou la
lumière. J’achetai ma première radio à une de mes voisine dont le mari travaillait comme cantinier
du village. Nous allions nous balader devant chez elle avec sa radio. Elle n’achetait jamais rien, elle
faisait tout chez elle.
A mon retour, la situation à la maison s’était améliorée, on n’avait plus de dettes à payer. Je
me mariai et partait vivre à Turin avec mon mari. Ma sœur Amelia, entre temps, avait rejoint son
mari en Suisse, où était née leur première fille, mais après quelques années eux aussi retournèrent
en Italie et vinrent vivre, pendant trois mois, à Turin avec Michele et moi. J’ai continué à aider ma
famille, à Turin aussi, en accueillant tout le monde pendant qu’ils cherchaient un travail. Après les
noces, ma situation économique était très stable, que ce soit mon mari ou moi nous avions un bon
travail et vivions une belle vie.
Je peux vraiment dire que j’ai connu la misère, et ce n’est pas une belle expérience. Mais
désormais, on a trop. Désormais, les enfants ne connaissent plus certaines valeurs, nous les anciens
nous savions nous adapter, mais pas les jeunes. Nous vous avons trop habitué au bien être et c’est
entièrement notre faute !
Dans la vie, on doit savoir économiser. Si nous n’accumulons pas au cas où se présente une
difficulté, si on dépense tout, alors on reste ensuite sur la paille. Comme c’est le cas de beaucoup
de personnes aujourd’hui en Italie. On doit apprendre que là où on prend sans remettre, nous ne
trouvons plus rien. Ma mère le disait toujours, petit à petit l’oiseau fait son nid. Des gens qui étaient
plus riches que nous auparavant sont aujourd’hui mal en point, nous nous n’avions rien et nous
avons dû apprendre à survivre.
Je suis partie avec soixante mille lires en poche et une valise de carton après les noces. J’ai
toujours travaillé et aujourd’hui, puisque nous avons su économiser, nous menons une vie sereine,
nous pouvons aider nos enfants à bien vivre. Nous pouvons leur garantir une maison, les faire
étudier, les amener en vacances, leur acheter des vêtements. Et nous sommes seuls, parmi ceux qui
ont encore une retraite et un travail pour faire tourner ce pays qu’est en train de devenir l’Italie.
Après autant de sacrifices, on n’a même plus le droit d’avoir un travail, on est en train d’enlever la
dignité de ce pays, des jeunes.
Certes, je n’ai jamais rien fait manquer à ma famille, mais il ne suffit pas d’avoir assez
d’argent, il faut savoir le gérer, il faut apprendre à l’utiliser. Je refusais de sortir en vespa le
dimanche, mais au moins la famille se portait bien, nous vivions dans le luxe et d’autres ont tout
perdu et ont faim. Les gens ont tout dépensé, ils ont joué aux seigneurs sans pouvoir se le
permettre, ils demandaient prêts sur prêts, dépensant tout. Ces personnes désormais vivent avec
deux sous le mois, et encore ou bien ils refusent du travail ou bien n’en trouvaient pas en
demandant trop. Le travail est une bénédiction, on doit du respect à ceux qui nous donnent à
manger. Le respect du travail et le respect de l’argent que l’on gagne sont pour moi fondamentaux
pour bien vivre. Il ne faut pas pour autant se vanter de travailler, on doit apprendre à être humble,
mais toujours la tête haute. Je l’ai fait, et je ne m’en vante pas. Les jeunes ! Apprenez de nous ! Si
même la société s’élève contre vous, continuez à lutter. Ne perdez pas espoir et ne vous arrêtez
pas. Celui qui saura se retrousser les manches réussira toujours à obtenir quelque chose.
N’attendez pas de vous faire écraser par les décisions du gouvernement, réagissez. Nous avons
lutté pour obtenir nos droits, et même si on veut nous les retirer depuis des années, on n’est rien
sans vous. Vous êtes le futur de cette Italie. Ne vous la faites pas voler.
