Une implantation simple et une transmission toujours active
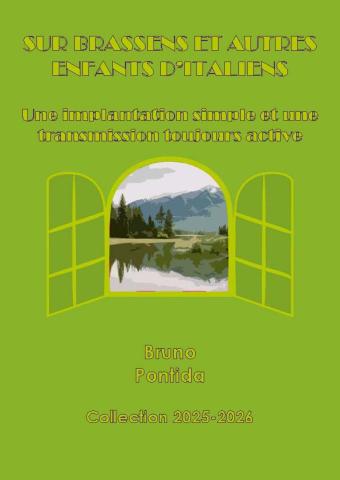
En tant que fils d’immigrés italiens, dans ma relation aux Français « de souche », je distingue deux
périodes : la première, que j’ai passée dans le cocon familial, à Thionville, en Lorraine, va de la prime
enfance jusqu’au baccalauréat ; la seconde, que j’ai vécue, et que je vis, en Alsace et en Bretagne, de
l’après-bac à aujourd’hui. Pour ce qui est de la transmission de la culture italienne, celle-ci en est déjà
à la troisième génération, celle de mes enfants.
Pendant l’enfance et l’adolescence, j’ai le souvenir très net d’avoir ressenti deux choses a priori
contradictoires : je me voyais différent de mes camarades français/lorrains « de souche » mais je
n’avais pas de sentiment d’appartenance à la communauté italienne. Je me sentais plutôt appartenir
à mon quartier, la Côte des Roses, où la population était composée de nombreux immigrés italiens,
certes, mais aussi, espagnols, portugais, polonais, marocains... Et mes meilleurs amis s’appelaient
Muller, Koslovski, Brocker.
En revanche, ce qui primait dans mon esprit d’enfant, c’est la classe à laquelle j’appartenais et
avant de me sentir italien, je me sentais fils d’ouvrier métallurgiste comme nombre de mes camarades.
Je vivais dans un quartier populaire, constitué essentiellement de HLM, ce qui fait qu’il n’y avait pas
de frontières entre les enfants d’immigrés et les enfants de Lorrains qui n’étaient, économiquement,
pas mieux lotis que nous.
Les écoles que je fréquentais étant très populaires, à aucun moment de mon enfance et de mon
adolescence je n’ai subi d’ostracisme ni de stigmatisation de la part de mes camarades du fait de mes
origines, à une exception près : j’ai ressenti une vraie frustration, dès le collège, en cours d’allemand.
Mes parents avaient choisi allemand première langue pour leurs enfants car c’était synonyme d’élitisme.
Or la majeure partie des jeunes qui suivaient l’enseignement de cette langue la connaissaient déjà
car elle était parlée dans leur famille par leurs grands-parents qui avaient grandi à l’époque où la
Moselle était allemande. Aussi le niveau était-il élevé. Les enseignants ne faisaient aucun cas des fils
d’Espagnols ou d’Italiens.
Arrivé au lycée, lorsque j’ai choisi l’italien comme troisième langue, j’ai connu un sentiment
original : j’ai commencé à avoir l’impression que savoir parler l’italien apportait une sorte de prestige
et, à la langue, s’ajoutait la fréquentation d’une culture riche à laquelle, au demeurant, la France devait
beaucoup. Ensuite j’ai quitté Thionville pour poursuivre des études et ce sentiment s’est maintenu
jusqu’à aujourd’hui. En effet, toutes les personnes dont j’ai fait la connaissance, qui apprenaient que
j’étais italien (enfin pratiquement), prenaient aussitôt un air enchanté. C’est une sorte de carte de visite
prestigieuse, chacun y va de sa fréquentation de l’Italie, de ses merveilleux souvenirs de vacances et
j’entends, certes, des clichés mais aussi une description très favorable du pays et de ses habitants. Les
Français qui sont allés en Italie, et je dois dire plutôt les Françaises, sans doute plus sensibles à cela,
font l’éloge de la bonne humeur permanente des autochtones, de la détente qui règne partout et la
comparaison avec l’ambiance en France est nettement favorable à l’Italie, comme si le raccourci de
Nicole Croisille dans sa chanson Une femme avec toi, « gai comme un Italien quand il sait qu’il aura
de l’amour et du vin », était devenu une sorte de vérité absolue.
J’ai bénéficié aussi, et bénéficie encore, de ce regard positif, lorsque les gens constataient que
je parlais italien à mes enfants. Je l’ai fait sans vouloir maintenir ou transmettre un lien culturel ou
des racines particuliers, un peu par jeu et défi envers moi-même, beaucoup par la conviction qu’être
bilingue précoce est un atout dans la vie et aussi influencé par le témoignage de Claude Hagège
(L’homme de paroles, 1985) que j’avais découvert à un « Apostrophe » de Bernard Pivot (à quoi ça
tient !). Mais, avec le recul, je pense pouvoir affirmer sans me tromper, qu’inconsciemment, je voulais,
par là, garder en moi et la faire vivre, une souche encore plantée dans le sol italien.
J’ajoute enfin qu’au prestige dont je bénéficie grâce à mes racines italiennes, s’en ajoute un autre :
mes parents sont siciliens et lorsque j’en parle, on touche à des représentations de toute évidence
romanesques auxquelles la trilogie du Parrain de Coppola n’est pas étrangère.
Reste l’actualité de tous les jours, ma relation à mes élèves dans l’exercice de ma profession : là
aussi, c’est indéniable, quand ils apprennent que je suis d’origine italienne, ce qui peut arriver lorsque
je prononce le nom des artistes italiens, c’est automatiquement bon pour moi : il faut bien le dire, je
monte dans leur estime !
Aussi, je peux affirmer que, dans ma relation aux autres, être d’origine italienne et surtout pratiquer
la langue italienne et savoir parler de la culture de ce pays est un atout lorsque l’on vit en France,
les gens vous regardent alors de manière bienveillante et ils sont friands de récits, d’anecdotes, de
témoignages sur un pays qui, de toute évidence, parle aux Français favorablement, et, c’est récurrent,
on me demande de dire quelque chose en italien, c’est une langue qui chante et est douce à leurs
oreilles.
Concernant les contacts de mes parents avec les Français, ma mère témoigne qu’ils ont été très
bien accueillis, mon père est arrivé en 1948 et ma mère en 1953. Cette année-là, le patron de mon
père, à Manom, près de Thionville, leur avait même trouvé un logement loué très peu cher. Ma mère
n’a jamais eu affaire à aucune désobligeance de la part des Français. Le deuxième logement où ils se
sont installés, toujours à Manom, était tenu par une Française tellement gentille qu’ils en ont fait la
marraine de leur premier enfant, mon grand frère, né en 1955.
Pour ce qui est de la langue française, elle l’a apprise sur le tas ou presque, car elle la connaissait
déjà un peu pour l’avoir étudiée à l’école, et mon père, qui était en France depuis 1948, la parlait déjà
bien, aussi n’avaient-ils pas particulièrement de problèmes d’adaptation ni de compréhension, par
exemple quand ils faisaient les courses.
Pour ce qui est de la transmission de la culture italienne entre mes parents et nous, la grosse affaire
fut la langue : ma mère avait décidé qu’elle nous parlerait italien et uniquement italien, ni français, ni
sicilien, considérant que l’italien était une langue de valeur et que ce serait une richesse pour nous, ce
en quoi elle avait tout à fait raison.
De la même manière, elle n’a jamais cuisiné autre chose que des recettes siciliennes, elle trouvait
les ingrédients aisément au marché de Thionville dont je me rappelle l’importance et où l’on trouvait
fromages, charcuteries italiennes, baccalà (morue séchée) mais aussi des fruits et légumes que les
Français de cette région ne connaissaient pas, comme les aubergines, car la communauté italienne de
Thionville était importante. J’ai plaisir à me rappeler que le mot melanzana (aubergine) est le dernier
que j’ai appris, enfant, en français. En effet, de tous les mots que j’avais appris dans ma petite enfance
en italien et dont j’ai vite appris l’équivalent français dans la rue, le dernier à vivre une traduction dans
mon vocabulaire italien d’enfant fut melanzana (ce qui n’a rien de surprenant vu le peu d’usage de ce
mot au quotidien). J’étais en première année d’école maternelle.
Quand je rêve de nourriture, ce qui m’arrive par exemple quand je suis à l’étranger, la liste de ce qui
me vient à l’esprit est immédiate : lasagne, ravioli (faits maison bien sûr) parmigiana, (un régal mais
ça demande tellement de travail !). Je dois dire aussi que les choses évoluent car depuis une vingtaine
d’année j’y ajoute sincèrement la choucroute et le boudin que j’ai découverts, adulte, en Alsace. Je me
concocte parfois pour le plaisir une spécialité italienne : insalata d’arancia e cipolla con olive nere
e verdi e succo di limone, olio d’oliva, pepe. Je n’y pense jamais mais je constate qu’effectivement les
pratiques italiennes sont ancrées et pendant tout le temps où les enfants étaient à la maison, je faisais
des pâtes tous les deux jours. C’était une évidence.
Ma grand-mère aussi m’a transmis une passion : le pain fait maison dans sa maison de Caltagirone
en Sicile. L’envie d’en faire est chez moi tenace et je cède régulièrement à cette envie, repensant à
chaque fois à cette époque où nous passions les vacances avec les cousins et ressentant la chaleur du
four (bien superflue en plein été) dans la maison à Caltagirone.
La transmission est passée à la génération suivante : mes trois enfants, immigrés de troisième
génération donc, sont tous trois évidemment de culture française, mais la marque italienne est forte
chez eux. Ils cuisinent les pâtes à la perfection (et ne comprennent pas comment leurs amis français
peuvent les rater !) et fabriquent leurs pizzas, pâte incluse évidemment, avec les ingrédients de leur
grand-mère, en particulier acciughe e capperi. Du reste, ma mère ne leur a toujours parlé, à eux aussi,
que l’italien. Tous les trois comprennent parfaitement cette langue, ma fille cadette l’a choisie pour
spécialité dans le cadre d’un master LEA et elle a été assistante de langue en Italie. Mes deux filles ont
eu l’occasion d’aller voir la famille en Sicile et la benjamine a particulièrement aimé l’architecture de
Catane et Palerme, l’ambiance dans les rues. Elle s’est parfaitement entendue avec les deux filles de ma
cousine mais, et en toute chose l’esprit humain va à la facilité, c’est en anglais qu’elles ont conversé !
Le contact s’est maintenu, même s’il s’est réduit au fur et à mesure des décennies, grâce à ma fille
cadette et à la fille ainée de ma cousine en Sicile, et je serais curieux de voir ce qu’il en restera dans
vingt ans.
