Les pâtes au corned-beef
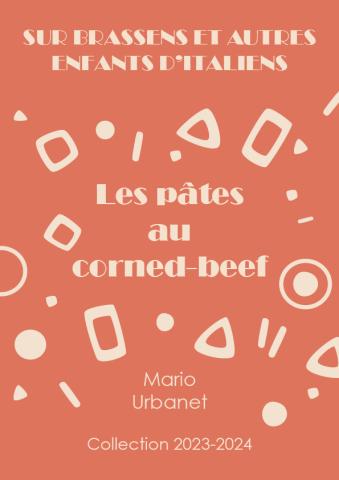
Les pâtes au corned-beef
La TSF le laissait entendre depuis quelques jours. Cette fois c’est fait ! Ils sont là, au passage à niveau ! La rumeur est venue jusqu’à nous que l’on appelle les macaronis. Je trouve ça idiot, mais comme dit mon père : on ne les changera pas ! On finit par ne plus y faire attention.
Je file à travers champs pour les voir. L’avenue Pasteur est envahie, on dirait un jour de marché, mais avec d’autres gens ou plutôt les mêmes, transformés. Les éclats de voix tranchent avec les attitudes résignées à l’ordinaire. C’est comme si une partie d’eux-mêmes, confisquée par l’occupant, se révélait intacte après toutes ces années pour éclater en rires, en pleurs essuyés, en regards éblouis.
La colonne est abritée à l’ombre des tilleuls épais qui remontent paresseusement jusqu’au carrefour de la Croix Rouge. En tête, une auto bizarre, sans toit, aux formes carrées. C’est une Jeep. Un combiné téléphonique y est installé. Sur le capot, une étoile blanche est inscrite dans un cercle, différente des étoiles jaunes que portent notre médecin, le cordonnier, le pharmacien et plusieurs élèves de mon école (dont Sarah, la plus jolie de toutes). Cette étoile-là n’a que cinq pointes. À la suite, des tanks plus petits que les « tigres » allemands, d’une couleur hésitant entre le beige et le caca d’oie, attendent à la queue leu leu.
Enfin je les vois ! Les libérateurs. Ils sont grands, un rien nonchalants, gentils, souriants. Avant je ne connaissais d’eux que le bruit lourd de leurs escadrilles, le tremblement des vitres au tomber de leurs bombes, les sifflements lugubres jusqu’aux explosions sourdes. Elles avaient détruit en grande partie des villes proches de chez nous. Le hurlement des sirènes nous poussait, mal réveillés, à descendre aux abris, emmitouflés dans des couvertures. Ma tante Lisetta portait la mallette de premiers soins contenant la précieuse « eau de mélisse » souveraine contre les évanouissements. Mon grand-père paternel qui avait été mobilisé sous François-Joseph, qui occupait la Vénétie à l’époque, refusait de descendre sous terre, disant : « si je dois mourir, au moins que ce soit confortablement, dans mon lit ». Pauvre nonno. C’est bien là qu’il est mort sans avoir connu ce jour fabuleux, ni revu sa petite ferme laissée au Frioul, alors que mon grand-père maternel, qui lui avait été blessé à Verdun, en bleu horizon, peut éprouver aujourd’hui la joie de la libération.
Depuis peu, on les voyait en plein jour, leurs forteresses volantes, entourées de petits nuages ronds, impacts des tirs de DCA. Parfois un bombardier s’enflammait avant d’être attiré par le sol en une vrille mortelle. Des parachutes s’en extirpaient, des hommes étaient alors livrés au ciel, semblables à ceux-ci. Des alliés. Les hommes d’ici paraissent vieillis avant le temps, ceux-là sont jeunes, très jeunes. Leurs uniformes sont disparates, froissés, allant du beige clair au vert olive. Ils n’ont pas l’air d’être plus riches que nous. Certains sont noirs de peau, je n’en avais jamais vus. Tous sont fatigués, mal rasés sous leurs casques bizarres. Leurs souliers sont enveloppés de guêtres de toile. Ils sont très différents des soldats d’occupation, vert de gris, sanglés, bottés, marchant raide, au parler brutal. Ceux-là parlent doux, en laissant traîner des phrases incompréhensibles. Ils ont l’air de grands-gosses qui joueraient à la guerre.
Monsieur Ligné, un voisin qui comprend leur langue, explique à la cantonade que ces hommes, nourris de conserves, sont menacés du scorbut, ils ont besoin de vitamines. Il faut leur apporter des tomates ! Lecteur de Jack London, le scorbut je connais, c’est une maladie terrifiante. Je détale à travers champs de toute la puissance de mes semelles en pneu de récupération. Je pense subitement que je devais faire de l’herbe aux lapins ! Nonna va encore me gronder. Je contourne la maison pour atteindre la fenêtre de la cuisine. Sur la margelle, ma grand-mère expose les tomates mûres pour en affiner la saveur. Gorgées de ce surcroît de soleil, elles concourent à rendre ses sauces sans pareille, tomates, ail, basilic et beaucoup d’amour, c’est sa recette. Je chipe la sauce du soir en un tournemain.
Au premier étage, la fenêtre ouverte laisse échapper le bruit familier de la machine à coudre, laissant place par intermittences à la TSF. Rina Ketty chante « J’attendrai, le jour et la nuit… ». J’imagine les pieds nus de ma tante Emilia, leur mouvement souple sur le balancier qui entraîne l’aiguille à une vitesse folle, telle un marteau pilon miniature. J’aime bien lorsqu’elle me permet de pédaler à sa place. Je me sens utile. Ses mains poussant le tissu, en tournant pour suivre le bâti, me fascinent. Dans ces moments privilégiés elle me raconte comment c’était avant la guerre, le paradis perdu là-bas, au village, dans l’Italie du nord.
Je reprends ma course échevelée. J’ai des vies à sauver moi ! Bianca, notre chèvre, attachée à son piquet n’en revient pas, ça fait deux fois qu’elle me voit passer sans m’arrêter pour lui caresser le museau. Je lui lance : « pas le temps ! on est libérés ! » Ses yeux très doux simulent l’étonnement, mais je suis sûr qu’elle m’a compris.
Je débouche, rouge et essoufflé, sur l’avenue Pasteur. La colonne y est toujours. La foule a encore grossi. Mes tomates sont vite repérées. Un immense gaillard me soulève de terre et m’embrasse. Il sent la sueur et ses joues noircies d’une barbe d’au moins trois jours me râpent la peau. Il m’emmène à l’intérieur de son char pour une visite guidée. Un de ses copains dort, plié exactement aux dimensions exiguës d’un recoin. Des armes traînent, poignards impressionnants dans leur nudité, revolvers énormes. Les ogives de petits obus étincellent de tout leur cuivre rouge. La chaleur est insoutenable dans l’air raréfié. Mon guide m’installe sur le siège du tireur. Je vois dehors comme au cinéma, par le truchement d’un périscope. Des cercles concentriques et une croix désignent la cible. C’est la maison d’Ida, une amie de la famille, venant elle aussi d’Italie et qui m’offre à chaque visite des tranches de son merveilleux strucul. Mon mentor me fait comprendre qu’en appuyant là : boum ! Plus de maison, juste par une pression du doigt sur un bouton de bakélite noir.
Après avoir rangé mes tomates dans un casier, les puissants bras de mon Américain me propulsent par l’ouverture de la tourelle. Il me montre trois casques allemands accrochés en trophées, à l’avant de son char, il prononce un mot accompagné d’un geste. Devant mon air ahuri il ajoute : kaput ! Là, je comprends. Un afflux de tristesse voile un court instant, la joie intense dans laquelle je baigne depuis ce matin. La guerre c’est des morts, toujours des morts. C’est peut-être là que s’est ancrée en moi cette aversion viscérale que je vais ressentir pour toutes les guerres qui vont suivre, en particulier celle d’Algérie dont je ne sais pas encore que l’on m’y enverra.
Avec un regard d’une tendresse insoupçonnée, mon protecteur me leste les mains d’une boîte métallique où je lis : corned-beef et d’un petit paquet bizarre enrobé de papier brun. Je découvre ma première gomme à mâcher. Mes yeux font de leur mieux pour remercier. Il me râpe encore les joues, en me serrant fort. Je pressens vaguement qu’il doit avoir, très loin, un fils. Brusquement des ordres poussent les soldats à réintégrer leurs coquilles monstrueuses. Ils nous font signe de nous écarter. Ils ont enfilé un deuxième casque par-dessus l’autre, emprisonné dans un filet (pareil à ceux que mettent mes tantes avant de se coucher, pour protéger leur mise en plis). Maintenant, nos libérateurs ont des allures de géants venus d’un autre monde. Le ronflement des moteurs, les sonnailles aigrelettes des chenilles sur le goudron, la fumée âcre qu’ils laissent dans leur sillage, les rendent irréels. Ils lèvent deux doigts en forme de V. Dans dix-huit kilomètres, ils vont combattre pour libérer Paris.
Nous sommes en août 1944, j’ai huit ans et demi, nous venons d’être libérés. Maintenant je vais enfin savoir ce que recouvraient ces mots prononcés par les grandes personnes avec un soupir de nostalgie : « avant-guerre ! »…
À la maison, ma nonna m’admoneste en frioulan comme toujours. Je lui donne la boîte que j’ai reçue en échange des tomates, qui disparaît aussitôt dans la poche de son tablier. Au premier étage c’est l’effervescence. On fabrique les drapeaux pour pavoiser en l’honneur des alliés. C’était çà le bruit de la Singer. Le plus dur, c’est l’anglais avec ses bandes dans tous les sens. Heureusement, la double page en couleurs du vieux Larousse vient à la rescousse. Avec Galliano et Ottone, mes cousins, nous découpons les étoiles de la bannière américaine dans un vieux torchon. Ma mère sacrifie son corsage rouge, pour les soviétiques.
Nonna s’époumone : È pronto ! Elle s’étonne que personne n’ait confectionné le drapeau italien. Mon père lui explique patiemment que ce drapeau ne serait pas apprécié, car il a beau être le nôtre, il est surtout perçu comme celui du fascisme. Ce fascisme qu’ils ont fui en 1929 pour trouver refuge ici ! Ma pauvre grand-mère ne sait que répondre : O Dio, Dio, Dio ! Comme à chaque fois que quelque chose d’inévitable la dépasse.
Ce soir, faute des tomates offertes aux libérateurs, la pastasciutta est agrémentée de sa nouvelle sauce magique : ail, basilic, corned-beef, et toujours beaucoup d’amour. Dans l’euphorie, on évoque même la fin des restrictions ! Après dîner, nous grimpons en famille tout en haut du village. Au-delà du Mont Valérien le ciel est rougi par la bataille de Paris. Je pense à mon ami tankiste que je ne reverrai plus, mais que je n’oublierai jamais.
