Une famille italienne en France : Mémoire d'une intégration
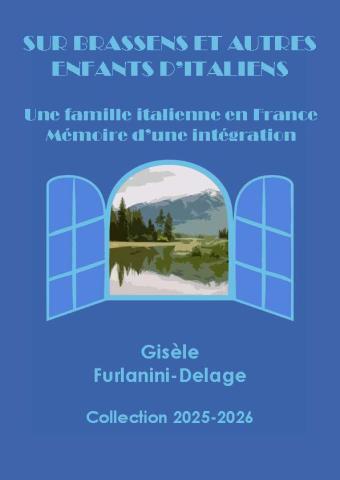
Pour situer
Mes grands-parents paternels étaient nés en 1881, mes grands-parents maternels en 1892.
Tous étaient originaires de Livourne où ils habitaient la même rue (via del giardino). Ils se
connaissaient de vue, mais ne se fréquentaient pas. Ils émigreront en France au même moment,
au tout début des années vingt et, par le plus grand des hasards, ils s’installeront dans le même
quartier de Marseille : Mazargues. Mes grands-parents sont qualifiés : l’un est savetier, l’autre
ébéniste, mais seule ma grand-mère maternelle a un métier puisqu’elle est pantalonière et
travaillera toute sa vie à la maison.
Leurs enfants sont tous nés en Italie, sauf mon oncle Roland, il francesino, né en 1931 et
chargé de symboliser la communion de ses parents avec leur nouveau pays. Tous s’exprimaient
en français et sans accent. Les fratries étaient assez importantes : trois enfants du côté maternel,
six du côté paternel.
Fait intéressant les concernant : leurs conjoints étaient tous d’origine italienne sauf pour
deux d’entre eux qui ont épousé deux femmes françaises. Il est à noter que les liens étaient
particulièrement forts dans le cas de mes parents, puisque le frère de ma mère a épousé la sœur
de mon père et qu’ils se sont mariés le même jour, en 1943.
Lorsque je nais, en 1956, seule ma grand-mère maternelle, Opelia, est encore en vie. La
famille est encore très unie géographiquement (tout le monde habite le même quartier) et
affectivement (les rencontres sont fréquentes). L’Italie est loin derrière, en filigrane, au travers
de très rares voyages à Livourne où se trouvaient encore des frères et sœurs d’Opelia ainsi que
mon arrière-grand-mère paternelle et des cousins.
Une italianité vécue au quotidien, sans qu’elle dise ouvertement son nom.
J’ai toujours su que j’étais d’origine italienne, mais la conscience de la culture d’origine
s’est constituée progressivement, dans un milieu qui se voulait totalement intégré à la société
française. L’italianité apparaissait dans mon nom de famille, bien sûr, et dans celui de ma mère.
Il y avait une certaine présence de la langue, même si personne ne parlait italien à la maison.
J’entendais des conversations en italien entre ma mère et ma grand-mère (un grand merci à
elles deux car elles ne sont pas pour rien dans la construction de mon oreille et de mon appareil
phonatoire). Il y avait aussi des mots italiens qui apparaissaient dans les propos de tous, et
particulièrement d’Opelia qui, pour avoir travaillé à la maison, avait eu moins de contacts avec
l’extérieur et parlait un français approximatif. Je comprenais tout ce qu’elle disait. Les mots
italiens étaient prononcés avec l’accent tonique (par exemple, on l’appelait mémé Opelia, un mot
français + mot italien accentué).
Il y avait aussi les traditions (mais pas religieuses car la famille était pour le moins mécréante).
Je me souviens de soirées où l’on faisait les ravioli, tous ensemble, pour la grande tablée du
lendemain. Mémé nous régalait de cenci, de frati, de fritto composto, de caciucco, bref, de spécialités
toscanes version maritime.
Il y avait l’opéra, passion qui s’est transmise fidèlement d’une génération à l’autre. Cela
signifiait aller à l’opéra de Marseille (toujours au poulailler), écouter des disques, raconter les
intrigues, pleurer avec Rigoletto et chanter Cortigiani vil razza dannata ou Una voce poco fa en
gardant comme un trésor ces sonorités dont on me donnait le sens global – ce qui me suffisait.
En ce qui concerne la musique, il y avait aussi San Remo. Volare et Non ho l’età ont fait l’objet
d’un intérêt particulier puisque nous en avions acheté les disques 45 tours.
Il y avait des anecdotes ou de petits récits qui se racontaient sur la vie à Livourne. Mon père
qui vendait enfant des frati pour le compte de son grand-père boulanger en parcourant les rues
avec un bâton où les beignets avaient été enfilés, ou encore ce ténor contrefait qui, moqué par le
public, décida de chanter rideau baissé et emporta l’enthousiasme des spectateurs.
Il y avait aussi les amis de mes grands-parents maternels, tous livournais, déjà très âgés,
mais qui fréquentaient encore notre maison. Ils tenaient un magasin de charbon et les liens
d’amitié étaient très forts.
Je me souviens aussi de la presse italienne que je voyais et essayais de lire chez Ezio, le frère
de ma grand-mère, immigré de plus fraîche date, qui lisait régulièrement Il corriere della sera. Je
me souviens qu’il avait gardé des suppléments concernant l’histoire récente de l’Italie. L’un des
fascicules s’intitulait Il governo è marcio. Il tempo è maturo. Il m’en avait expliqué le sens et je ne
l’ai jamais oublié.
Il y a eu aussi un voyage chez la jeune sœur de ma grand-mère quand j’avais huit ans.
Découverte d’une autre planète ! J’avais des parents italiens. Le choc fut salutaire. Je prononçais
ma première phrase en italien (Come ti chiami ?). Il me faudra attendre cependant l’entrée en
quatrième pour en prononcer d’autres.
Il y avait aussi l’humour, que j’ai a posteriori identifié comme un trait italien. Rien n’était
jamais grave. La mémoire familiale pullule d’anecdotes du genre de celle-ci : Amedeo, mon
grand-père, victime d’un malaise, s’effondre. On le secoue, on le gifle, enfin on le ranime, on lui
fait de l’air, et là il dit : Credevo di essere sui bagni Pancaldi (prononcé Pancardi à la livournaise).
Il venait juste de frôler la mort.
Il y avait aussi les petits poèmes et les répliques que mémé Opelia savait de mémoire. Il y
avait du sérieux (poemi di Lorenzo Stecchetti) et du moins sérieux (Ciao Maria, Tu sei piena di
grazia e io d’acquavite, Tuo figlio è morto in croce, il mio in galera, Siamo due famiglie rovinate, Addio
Maria).
Je ne me souviens pas d’avoir ressenti un quelconque orgueil d’être italien s’exprimer à la
maison. Nous étions d’origine italienne. C’est tout.
Le temps des questions et l’histoire de ma famille en France.
Ce n’est que parce que j’ai posé des questions (et je pense, avec le recul, que je n’en ai pas
posé assez) que j’ai appris l’histoire de ma famille, avec plus de précisions du côté maternel.
Les raisons du départ
On pourra parler d’émigration politique, mais avec des nuances. Du côté paternel, Alberto
était anarchiste – il a d’ailleurs donné des prénoms lourds de sens à certains de ses enfants
comme mon père Pietro, en hommage à Pietro Gori, ou mes oncles Oberdan et Ferrer. Il avait
été gazé pendant la guerre et souffrait de troubles respiratoires. Il quitta l’Italie avec toute sa
famille dès 1922.
Mon autre grand-père, Amedeo, était simplement un homme libre. Rescapé de Caporetto, il
ne voyait pas d’un bon œil les fascistes. Il s’aperçut très vite qu’il aurait du mal à travailler et à
vivre dans ce contexte. Après un premier voyage aux États-Unis comme matelot sur un bateau,
juste pour voir comment c’était, il revint convaincu qu’il lui fallait partir, mais pas si loin. Un de
ses amis se trouvait déjà à Marseille et l’affaire fut entendue. En 1924, toute la famille se trouvait
réunie à Mazargues.
Leur volonté de s’intégrer a été immédiate et totale. Aucun d’entre eux n’a fréquenté la casa
d’Italia. Tous les deux ont demandé et obtenu la nationalité française pour eux-mêmes et pour
leurs enfants encore mineurs. Mon père racontait avec fierté qu’il était français par option, qu’il
avait choisi en toute conscience d’être français. Il garda toute sa vie son livret militaire comme
la preuve de ce choix fondamental pour lui.
Mes grands-parents
La première génération, tout en cherchant à s’intégrer, a recréé une petite Italie. C’était
les amis, les gueuletons du dimanche, les sorties à l’opéra. Les liens d’amitié s’étaient tressés
exclusivement avec des Livournais. Dans mon quartier, il y avait pourtant des Napolitains, des
Piémontais. Je m’avance un peu, mais je crois qu’ils éprouvaient une sacrée fierté à être toscans.
Ils ont toujours travaillé et n’ont pas rencontré de réactions de type raciste. Seule l’une de
mes tantes racontait qu’elle se battait à coups de sabots lorsqu’on la traitait de Sale bàbi. Il faut
dire qu’ils restaient à leur place.
Leurs choix politiques antérieurs les ont amenés à prendre des risques et à cacher des
militants antifascistes. La mémoire familiale rapporte l’histoire de Carlino, réfugié en France,
caché une semaine chez l’un, une semaine chez l’autre (et même à Bastia chez Ezio, le frère
de ma grand-mère, lui-même condamné à mort par les fascistes) et qui fut trahi par l’un de ses
oncles, curé de son état, qui lui fit savoir qu’il ne risquait plus rien, qu’il pouvait rentrer dans sa
famille et qui fut immédiatement arrêté. Nous ne savons ce qu’est devenu Carlino.
Leurs enfants : mes parents
Du côté de mon père, l’autorité appartenait à mon grand-père. Mon père voulait devenir
jardinier, mais il fut maçon. Son intégration se fit par le travail, qu’il commença à onze ans, auprès
d’entrepreneurs locaux qui parlaient provençal. Mon père adopta le mode de vie marseillais
(façon de vivre et traditions culinaires) et partiellement la langue provençale, notamment pour
les outils et les gestes de son métier. Il s’est intégré dans les mouvements d’éducation laïque et a
pratiqué la course à pied. Il a contribué à la diffusion du volley-ball. Toute sa vie, il fut membre
du cercle laïc de mon quartier. Il s’est engagé politiquement après 1936 en adhérant au parti
communiste français. Il fut un acteur engagé, toute sa vie. Il fit la drôle de guerre dans les Alpes
maritimes, fut résistant à Marseille, occupa l’Allemagne en 1944 et fit sa part durant la guerre
d’Algérie en allant notamment garder la nuit le journal La Marseillaise menacé d’attentat par
l’OAS. Je me souviens aussi d’un matin où la porte de notre maison avait été peinte en rouge et
l’inscription OAS tracée sur le mur. Je crois que toutes les marques de son engagement dans la
vie civile étaient autant de preuves de son droit à être français.
À la fin de sa vie, il avait oublié la langue italienne.
Ma mère a toujours cultivé sa culture italienne. Elle parle encore bien, malgré ses quatrevingt-
treize ans, et pratique une langue charmante, marquée d’archaïsmes.
Les petits-enfants.
Nous sommes nés pour le plus vieux en 1922 et pour le plus jeune en 1981. Tous les cas de
figure sont représentés : l’oubli de la langue, le souvenir de quelques bribes d’italien, l’italien
réappris (nous sommes deux à avoir fait un cursus d’italien). Ceux qui se sont mariés ont épousé
des Français et nos noms de famille n’ont plus d’accent tonique. Il reste quelques traditions
culinaires. Le plat le plus représentatif de la tradition interne à notre famille est ce que mon père
appelait la « soupe-fricot ». Riche, jamais, ou presque jamais, la même, elle commence toujours
par un soffritto cipolla-carota-sedano dans l’huile d’olive, auquel on rajoute les légumes que l’on a à
portée de main, sans avoir peur de cuisiner aussi les légumes secs. En commençant avec le même
soffritto, on fait la viande en sauce. Nous continuons à faire la soupe de moules à la façon de
mémé/maman et aussi les gnocchi, nous les roulons sur une fourchette, comme mémé/maman.
L’été, la panzanella, bien huilée.
En février les cenci.
Le risotto, très riche en légumes.
Toutes les recettes de baccalà, en distinguant bien les provençales des italiennes.
Je fais souvent, en saison ou pas, les fagioli all’uccelletto.
Il y a tout de même un phénomène intéressant à observer : nous avons cherché à faire plus
italien en adoptant des recettes que jamais personne n’avait cuisinées à la maison, les pizze et les
pâtes à la bolognaise !
Nous habitons tous très loin les uns des autres. Je ne sais pas ce qu’il restera par la suite. Je
crois que l’intégration est en passe de s’accomplir.
