Les grenouilles du fleuve
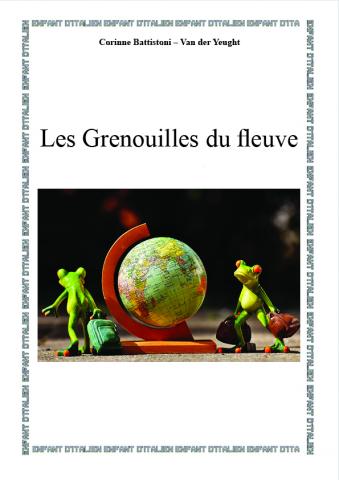
Je me suis souvent interrogée sur les raisons qui avaient motivé mon apprentissage de la langue italienne et sur ma passion pour le pays d’origine de mes ascendants paternels. Comme cela se produit fréquemment dans les régions qui ont connu de nombreuses vagues d’immigration, notre culture familiale était mixte, corse par ma mère, italienne par mon père, et bien sûr française par éducation. Mes parents travaillaient dur et prenaient peu de vacances, mais nous allions parfois en Italie où mon père retrouvait ses cousins restés en Ombrie. Je n’avais que trois ans lors de notre premier voyage, mais j’ai conservé dans ma mémoire sensorielle des souvenirs inoubliables dans lesquels se mêlent l’odeur du foin, la saveur des aliments, la beauté des paysages et surtout, la douceur et la générosité des personnes rencontrées. Lors de nos séjours, toute la famille était réunie à l’occasion de grands repas organisés à la ferme où vivaient les cousins de mon père. J’avais du mal à identifier toutes ces personnes qui ne parlaient pas ma langue, mais je comprenais qu’elles nous manifestaient beaucoup d’amour. Les photos en noir en blanc que mes parents ont conservées de cette époque témoignent de ces moments heureux où la petite citadine que j’étais court après les oies, saute dans les bottes de foin et nourrit les animaux.
Lorsque j’atteignis sept ans, ces vacances rurales en Italie ne furent plus possibles en raison de la naissance de mes sœurs et d’une charge de travail accrue pour mes parents. Les contacts avec l’Italie se firent plus rares : quelques appels téléphoniques à l’occasion d’une naissance ou d’un décès et les traditionnels échanges de bons vœux lors des fêtes de Noël. Je me souviens pourtant d’un épisode étrange lorsque j’avais environ douze ans. Deux cousins avaient raccompagné mon grand-père d’Italie car celui-ci avait souhaité s’y installer vers la fin de sa vie. Dans une longue histoire, ils expliquaient en italien les difficultés de mon grand-père qui n’était pas parvenu à s’acclimater à son pays d’origine. Nous n’étions par retournés en Italie depuis plusieurs années et pourtant, je comprenais tout ce qui se disait. La mélodie de la langue s’était apparemment inscrite dans mon cerveau. Les sons avaient un sens : je comprenais les tribulations de mon grand-père devenu étranger dans son pays natal. J’étais alors au collège et je devais choisir une seconde langue étrangère. Je choisis naturellement l’italien. J’ai étudié cette langue pendant près de dix ans en suivant un cursus scientifique, jusqu’au baccalauréat, puis économique et commercial par la suite. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je réalisai que mes parents ne parlaient pas vraiment l’italien ! Ils disposaient en réalité d’un bagage de quelques mots et expressions qui leur permettaient de faire face aux situations les plus courantes. L’amour faisait le reste. Quelques gestes, quelques mots avaient suffi pour entretenir des relations familiales pendant plus d’un demi-siècle. Ma participation à cet ouvrage collectif a été l’occasion d’enquêter sur l’histoire familiale afin de comprendre comment s’effectue la transmission de la langue entre les générations. Pourquoi mon père ne parle-t-il pas la langue de ses parents ? Comment le lien avec le pays d’origine a-t-il perduré pendant trois générations malgré des contacts épisodiques et sans parler la même langue ? Parviendrons-nous à maintenir ce lien à l’avenir ?
Pour répondre à ces questions, j’ai mené une petite enquête. Je n’ai pas pu reconstituer l’ensemble du puzzle car certaines pièces ont disparu avec la mort des membres de ma famille. La sœur de mon père, Henriette, aujourd’hui âgée de quatre-vingt-cinq ans, et mon père, âgé de soixante-douze ans, ont accepté de répondre à mes questions afin de m’aider dans cette entreprise. Pour estimer nos chances de transmettre aux futures générations la mémoire de nos racines italiennes et la langue de nos ancêtres, j’ai interrogé mes enfants. C’est donc sur la base de ces témoignages et de ma propre expérience que je vais tenter d’expliquer notre relation avec la langue et la culture de notre pays d’origine.
À la recherche d’une vie meilleure : le départ d’Italie
Mon grand-père, Gino Battistoni, est né en 1898 à Cannara en Ombrie. Il était l’aîné d’une famille nombreuse dont certains enfants sont morts jeunes. Parmi les anecdotes qu’il se plaisait à raconter figure celle des grenouilles qu’il allait pêcher sur les rives du fleuve Topino, puis vendre au marché pour rapporter un peu d’argent à ses parents. L’idée que notre famille devait sa survie à ces malheureuses grenouilles frappait mon imagination d’enfant, comme elle l’avait fait pour mon père et pour Henriette, qui m’ont tous deux rappelé cette histoire lors de nos entretiens. La pauvreté dans laquelle vivait mon grand-père lorsqu’il était enfant a fait de l’argent une véritable obsession pour cet homme qui ne vécut ensuite que pour son travail. Il épousa ma grand-mère, Sabatina Canafoglia, en 1921. Née en 1896, Sabatina avait perdu sa mère à l’âge de cinq ans et elle avait reporté son affection sur sa sœur aînée, Maria. Son père ne pouvant s’occuper de deux enfants, elle fut placée dans une famille d’accueil. Sa maman de substitution était une cousine de son père apparemment peu affectueuse. Compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été élevés, Gino et Sabatina n’ont pas véritablement fait d’études. Ils ont appris à lire, à écrire et à compter et ils ont ensuite dû travailler. La misère dans laquelle vivaient alors bon nombre d’Italiens les poussait à émigrer. Mon grand-père décida en 1923 d’aller tenter sa chance dans les mines du nord de l’Europe. Henriette naquit en janvier 1923 à Foligno (Ombrie), juste avant le départ pour la Belgique et c’est dans ce pays d’accueil que sa petite sœur Marie vit le jour en 1924. Très vite, les parents de Gino, ses frères et ses sœurs le rejoignirent en Belgique. La plupart n’en sont jamais repartis.
Le climat froid du nord ne convenait guère à mes grands-parents, habitués à la douceur de l’Ombrie, et mon grand-père rechercha rapidement un travail dans le sud de la France. Une petite communauté d’émigrés italiens s’était constituée à Toulon et Gino y trouva un emploi de jardinier dans le quartier des œillets, en 1926. Au bout de quelques mois, il fit venir sa famille, restée en Belgique et il s’installa à la Seyne où il acquit un fonds de commerce.
Ses parents perdirent toutes leurs économies placées dans une banque belge lors de la crise de 1929. Accompagnés de leur fille la plus jeune, ils rejoignirent donc Gino peu de temps après son installation en France, mais les autres membres de la fratrie restèrent en Belgique. Henriette se souvient que toute la famille parlait italien jusqu’à son arrivée en France. La Belgique avait constitué une sorte de sas de transition où Gino, Sabatina et leurs enfants avaient appris le français, mais entre eux ils continuaient à communiquer en italien. C’est après leur installation en France que la rupture avec la langue d’origine a été consommée, non pas brutalement, mais par étapes.
L’installation en France et la rupture avec la langue d’origine
À la Seyne, Gino et Sabatina comptaient beaucoup d’immigrés italiens parmi leurs clients et l’italien s’imposait naturellement comme langue commune. Le contact avec l’Italie était maintenu grâce au courrier car Sabatina correspondait souvent avec son père et sa sœur. Henriette se souvient d’être allée en Italie à l’âge de cinq ans avec sa mère et Marie. Ne souhaitant pas laisser son commerce, Gino ne les avait pas accompagnées. Henriette était bilingue et elle passait sans difficulté de l’italien au français. La rupture avec la langue d’origine intervint en 1931. Gino et Sabatina décidèrent de vendre leur commerce pour en acheter un autre situé dans le quartier du Pont de Bois à Toulon. La clientèle était différente, essentiellement francophone. Lorsque la famille déménagea, les parents de Gino préférèrent repartir en Italie où ils finirent leur vie. Henriette vouvoyait encore ses parents avant leur installation au Pont de Bois. Cette pratique fut abandonnée lorsqu’elle passa à l’utilisation exclusive du français. Mon père, Guy, est né en 1936 alors que sa famille s’était parfaitement acculturée à la France. Il a été élevé dans le respect des principes républicains français et ses parents ne lui ont jamais parlé italien. Sa langue maternelle est donc le français. Pendant les années 1930, l’Italie s’enfonça dans le fascisme et Benito Mussolini se rapprocha de plus en plus de l’Allemagne hitlérienne. Je suppose qu’il était préférable de ne pas rappeler ses origines italiennes dans un tel contexte. Puis la guerre éclata et mes grands-parents choisirent leur camp : ils ne partageaient pas les valeurs fascistes de Mussolini, ils respectaient leur pays d’accueil et ils souhaitaient être assimilés aux Français. Dans le même temps, les cousins restés en Italie entraient en résistance contre les camicie nere qui faisaient régner la terreur dans les campagnes.
Mon grand-père profita de sa qualité de commerçant pour aider les personnes démunies à se nourrir. Probablement cacha-t-il à l’occasion quelques résistants dans les réserves du magasin. Mon père était alors très jeune, il ne comprenait pas les enjeux. Lors d’une visite de la milice, il livra des informations qui conduisirent mon grand-père en prison. Menacé d’expulsion, celui-ci dut sa libération et son maintien sur le territoire français au soutien de certaines personnalités locales qui lui étaient reconnaissantes pour les services rendus. Le même problème se posa à la Libération car le service d’épuration voulait renvoyer les étrangers chez eux. Mes grands parents eurent à affronter les dénonciations (probablement de concurrents jaloux), mais les témoignages favorables l’emportèrent, et la famille put rester en France. La situation était très inconfortable. Mon père se souvient que ses camarades lui reprochaient parfois ses origines italiennes lorsqu’ils étaient à court d’arguments. Il trouvait ces réactions profondément injustes car il se sentait aussi français qu’eux. Ce qui n’était que des chamailleries d’écoliers à l’origine pouvait ainsi dégénérer en bagarres. Gino et Sabatina ne voulaient pas avoir de problèmes avec les Français de souche, aussi corrigeaient-ils leur fils quand ils apprenaient qu’il s’était battu.
Pendant toute la durée de la guerre, les contacts avec l’Italie furent difficiles, même par la poste. Cette période douloureuse marque la rupture définitive avec la langue d’origine. Mon père ne l’entendait jamais parler à la maison car ses parents faisaient de leur mieux pour s’intégrer. Lorsque la paix fut rétablie, Sabatina reprit ses contacts épistolaires avec sa famille, mais elle ne retourna en Italie qu’en 1948, avec mon père. Il avait alors douze ans.
Des relations épisodiques, mais durables, avec la terre de nos ancêtres
Lorsque mon père m’apprend qu’il n’est allé en Italie que deux fois avant ma naissance, je suis abasourdie. Aussi loin que remontent mes souvenirs, ses relations avec sa famille italienne ont toujours été très affectueuses. Nous avons toujours été accueillis avec beaucoup d’hospitalité et une immense gentillesse. Les retrouvailles étaient joyeuses et les séparations très tristes. Comment les liens ont-ils perduré au fil des décennies malgré si peu de contacts ? Papa m’explique qu’il s’est rendu en Italie pour la première fois à l’âge de douze ans, puis une seconde fois vers quatorze ans. Ces voyages furent une révélation. Ses cousins étaient plus grands que lui. Ils l’emmenaient partout avec eux et lui racontaient leur façon de vivre. Grâce à cette immersion, au bout de trois semaines, papa comprenait et parlait l’italien. Il trouvait une telle chaleur humaine auprès de cette famille qu’il faisait tous ses efforts pour communiquer dans la langue de ses cousins.
Malheureusement, une nouvelle période sombre s’annonçait. Sabatina décéda en 1953, après une longue période de maladie et en 1956, sa fille, Marie, mourut brutalement à l’âge de trente et un ans. La jeune femme laissait deux enfants dont Gino prit soin jusqu’à leur majorité. La même année, mon père partit en Algérie livrer un combat qui n’était pas le sien. Peu avant son départ, il rencontra ma mère et la demanda en mariage. Ils se marièrent à son retour de la guerre, en 1958, et quatre ans après, je naissais. En 1965, papa décida de nous emmener, maman et moi, faire la connaissance de sa famille italienne. Je rencontrai Maria, la sœur chérie de Sabatina, et les nombreux cousins et cousines que papa n’avait plus revus depuis le début des années cinquante. Plusieurs d’entre eux travaillaient et vivaient encore à la ferme. Il n’y avait pas de sanitaires et le confort était très limité, mais je garde des souvenirs merveilleux de cette période. Comme papa l’avait vécu dans son enfance, je fis l’expérience des grands repas familiaux, de la gentillesse de nos cousins et de la vie à la ferme. J’appréciais les plaisirs d’un environnement rustique : nourrir les animaux, sauter dans les bottes de foin, jouer dans la campagne immense. Les vieilles photos racornies de cette époque suscitent en moi l’émotion des jours heureux. Nous avons dû retourner en Italie aux alentours de mes six ans, puis il y eut une longue interruption pendant près de dix ans au cours desquels mes parents furent trop occupés par leur travail et la naissance de mes sœurs pour envisager un tel voyage. Gino décéda en 1976. Sa tentative d’installation en Italie vers la fin de ses jours s’était soldée par un échec : après toute une vie passée hors de son pays d’origine, il n’était pas parvenu à s’y adapter. Les contacts avec l’Italie s’espacèrent, mais je conservais au fond de moi le désir de repartir un jour, peut-être par mes propres moyens lorsque je serais assez grande, pour retrouver ce pays et ces gens qui m’avaient fait si bon accueil.
L’apprentissage de la langue comme moyen d’accès à la culture d’origine
À l’école, j’étudiais l’italien avec ferveur : pour moi, il ne s’agissait pas d’une langue comme les autres, mais de celle de mes ancêtres et de mes cousins restés là-bas, en Ombrie. Au-delà de la langue, c’est aussi la culture italienne que je souhaitais approfondir. Ayant étudié le latin, je ressentais comme une fierté de compter parmi mes ancêtres des représentants des civilisations étrusque et romaine. À l’adolescence, je ne rêvais que de repartir en Italie pour découvrir les merveilles de l’Antiquité romaine ou de la Renaissance florentine. Je parvins à convaincre mes parents de nous emmener mes sœurs et moi en Italie pour mes dix-sept ans. Mon père craignait de déranger ses cousins après plus de dix ans de séparation. Il s’interrogeait sur l’accueil qui nous serait réservé et, n’ayant plus pratiqué la langue, il doutait de pouvoir communiquer comme autrefois. Trente ans plus tard, je suis heureuse d’avoir insisté. Les retrouvailles furent joyeuses et affectueuses comme cela s’était produit à chaque fois dans le passé. Maria était morte, mais ses cinq enfants mettaient un point d’honneur à nous recevoir dans les règles de l’hospitalité latine. Mes cousins étaient de jeunes adultes. Comme l’avaient fait leurs parents en leur temps avec mon père, ils souhaitaient me faire découvrir leur pays et leur culture. Comprenant mon désir de parler correctement leur langue, ils se montraient indulgents et pédagogues. À partir de cette période, je retournais régulièrement en Italie, parfois avec mes parents, le plus souvent seule par le train. Je me sentais si bien dans ce pays que j’envisageais sérieusement de m’y installer lorsque viendrait le temps de travailler. Je ne suis pas allée vivre en Italie, mais grâce à l’usage de la langue, j’ai pu établir avec ma famille italienne des relations de confiance qui vont bien au-delà des usages codifiés par les lois de l’hospitalité. C’est aujourd’hui avec mon mari et mes enfants que je fais le voyage. Chacun de nos séjours est l’occasion de découvrir une parcelle de l’immense patrimoine culturel de l’Italie. L’Ombrie est riche en cités médiévales (Gubbio, Perugia, Spello, Spoleto…) et lieux de pèlerinages (Assisi, en particulier). Les régions limitrophes étant la Toscane et le Latium, les sites à visiter ne manquent pas et nous avons toujours le sentiment qu’il reste tant à voir. J’ai la chance d’avoir épousé un enseignant d’anglais passionné d’Italie et nous avons tous deux transmis cette passion à nos enfants. Nous les y avons emmenés de façon très régulière et ils ont choisi de leur propre chef d’étudier l’italien comme seconde langue. Ils ne le parlent pas couramment, mais ils parviennent à communiquer avec notre famille. Ils sont sensibles à la culture italienne, à la richesse du patrimoine historique, architectural et gastronomique de ce pays et ils partagent mon attachement familial. Du côté italien, mon cousin Paolo a créé avec sa femme, Doriana, un complexe agri-touristique près de Cannara. Nous pouvons désormais séjourner chez eux et partager nos repas avec notre famille italienne dans une ambiance proche de celle que j’ai connue enfant. Paolo et Doriana ont deux fils qui étudient le tourisme et qui ont choisi le français comme seconde langue. C’est désormais à nos enfants de porter le flambeau de la transmission inter-générationnelle. Quatre-vingt-cinq ans après le départ d’Italie, j’ai pu préserver ces contacts privilégiés grâce à la pratique de la langue et je cultive les relations avec ma famille italienne car ce lien me semble précieux pour mes enfants. Ainsi que le résume très simplement mon fils aîné : « l’Italie, c’est un pays étranger où je me sens chez moi ».
Lorsque je me promène à Cannara, il me semble parfois apercevoir un jeune garçon en culottes courtes courir sur les bords du fleuve Topino en quête de grenouilles dont la vente permettra de nourrir ses frères et sœurs. Je pense aussi à Sabatina qui dut quitter sa famille et l’Italie pour s’expatrier dans un pays dont elle ne savait rien. L’amour qu’elle portait à sa sœur était si fort qu’il nous a été transmis sur quatre générations. Je formule le vœu que nos enfants le transmettent à leur tour à leurs propres enfants.
Corinne Battistoni – Van der Yeught, 2007
Texte publié dans l'ouvrage Enfants d’Italiens, quelle(s) langue(s) parlez-vous ?
