Souvenirs d'un jeune émigré "trilingue"
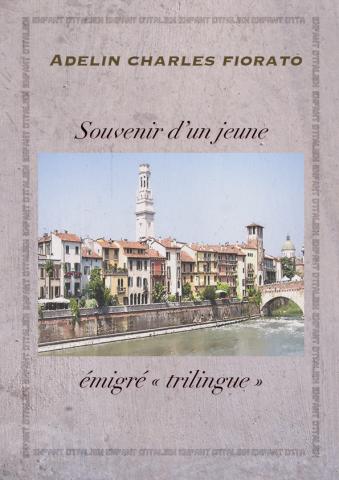
« Trilingue » n’est pas le mot juste. En fait, les trois langues que j’ai pratiquées dans ma jeunesse s’échelonnent dans le temps, en se jumelant en gros deux à deux.
Ma langue maternelle – celle qui me vient de ma mère, de Gargagnago, et de ma nourrice, de San Giorgio, di Valpolicella –, est une variante du dialecte vénéto-véronais, avec quelques légers écarts. Par exemple, nous disons la aca, pour la vaca ; mi ago pour mi vago (io vado). Cela suffisait pour vous connoter, dans les environs, comme des croquants.
Il faut dire qu’il n’y a guère de hameau plus modeste, dans les environs, que Gargagnago, frazione de Sant’Ambrogio Valpolicella : il est coincé dans un creux du relief, entre l’extrémité de la plaine padane et le pied d’une des premières collines des monts Lessini. Mon village jouissait tout de même d’un illustre privilège : celui d’avoir un nom s’écrivant avec quatre g, ce qui est, à ma connaissance, unique au monde[1]. Il est en effet bercé par les « glouglous » de son méchant Vaio (Vario) : le bien nommé car, dans une de ses crues capricieuses, il recouvrit un jour sous dix centimètres de gravier – je suis né dans une contrada dénommée Giare (Ghiaie) – le champ de mon grand-père qui, ruiné, fut ainsi obligé d’émigrer en Amérique.
Jusqu’à l’âge de six ans, je n’ai pratiquement jamais rencontré la langue italienne. Si, parfois, sur les emballages des rares produits venus de la ville, la lointaine Vérone (à quatorze kilomètres), ou encore des inscriptions saugrenues, du genre « È vietato orinare contre il muro della chiesa » ; ou, ailleurs, « Ogni abuso verrà punito ». È vietato, verrà, cela ressemble à quoi ? je vous le demande. D’autre part, la chanson, qu’on pratiquait beaucoup dans nos veillées (i filò) – sans doute parce qu’autrefois on y filait la laine –, nous apportait parfois une senteur d’italien, à travers des mélodies semi-dialectales :
« Quel mazolin di fiori,
che vien da la montagna.
E guarda ben che non si bagna… ».
Mais les chansons proprement dialectales avaient à nos yeux un tout autre charme :
« El capitan de la compagnia / a i so alpini el ghe fa dir… » ; ou bien : « Bel uzelin del bosc / ‘ndove saralo andà ? / Le andà da la soa bela », ou encore : « Mi voria che l’Arena / fusse un grande paneton, / e che l’Adese en piena / la scoresse de vin bon… »
Pour nous, l’italien était la langue des signori, catégorie mythique, qui devait bien exister là-bas quelque part, du côté de Vérone. Mais, au village, les signori c’était qui ? Le comte Serego[2], bien sûr, le « latifondiste » du coin, chez qui travaillait mon grand-père maternel ; son intendant Percaccini, le médecin, le curé… et encore, car eux aussi parlaient en dialecte avec leur entourage.
D’ailleurs, l’italien avait chez nous une connotation un peu burlesque. Il y avait au village, une sorte de patriotisme dialectal, qui faisait que tenter de parler in lingua, c’était vouloir singer les signori, et donc se comporter en prétentieux, en précieux ridicules. Et il courait toute une série de calembours, blagues et anecdotes stigmatisant ceux des nôtres qui avaient la présomption de vouloir passer de l’autre côté.
En voici une. Un jeune soldat revient du service militaire, où il s’était frotté forcément à l’italien, ne serait-ce qu’à celui des signori ufficiali. Revenu dans sa ferme natale, un matin, devant l’évier de la cuisine, il s’écrie : « Mamma, dammi il sapone, per piacere. (per favore est inconnu chez nous : trop courtisan !). – Sì alà, fiol, lui répond-elle, suto andar a sapar a st’ora chi ? [3] – No, mamma, il sapone per lavarmi la faccia ».
L’italien, je devais le découvrir à l’âge de six ans, à l’école « élémentaire », où on nous l’enseignait un peu comme une langue étrangère.
Et ce fut une révélation ! Non pas tant à cause de la langue proprement dite : dettato, grammatica, componimento, quoi de plus fastidieux ! mais des contenus qu’elle véhiculait. Je découvris ainsi des horizons nouveaux, au delà des dernières maisons de notre village. Je fis connaissance avec la géographie et l’histoire de mon pays, et acquis de la sorte une conscience de mon « italianité », comme disaient alors les fascistes. Je m’y fis aussi de solides amitiés : Balilla, Garibaldi, Nino Bixio (première manière), Cesare Battisti, etc., et d’autres qui me causèrent du chagrin. Ainsi le sort funeste de « La piccola vedetta lombarda », d’Edmondo de Amicis, romancier très porté sur le « cœur », comme on sait, me désola au point qu’un soir ma mère me surprit en train de pleurer sur mon livre : « Cosa gheto ? », me dit-elle. Je lui expliquai que j’étais triste à cause de la mort du petit héros. « Ma va’, stupido, quel lì l’è un butel de carta[4] ». C’est ainsi que je compris – plus tard, bien plus tard –, que ma mère, tout analphabète qu’elle fût, avait formulé, bien avant nos collègues structuralistes ou sémiologues, un principe de narratologie.
L’émigration de toute la famille en France, où nous allâmes rejoindre mon père, expatrié avant nous, porta un coup sévère, aussi bien à notre dialecte quotidien qu’à mon italien de récente acquisition scolaire.
J’avais alors huit ans et demi, et il se trouva que nos parents purent inscrire leurs trois enfants, pour tout l’été, à la colonie de vacances de l’école de Brunoy. Cela voulait dire que, cinq jours par semaine, nous partions en groupe, bien encadrés par nos moniteurs, pour la forêt de Sénart, où nous attendaient des activités collectives diverses : jeux d’équipe, sports, marches, chansons, récits, etc.
À ce régime, mes deux sœurs et moi, au bout de trois mois au terme des vacances, parlions couramment le français (enfin presque !…), avec parfois de curieux malentendus. Par exemple, je me souviens que, quand nous chantions en chœur : « Sur l’air du tra-deri-dera », je comprenais : « Il re d’Italia riderà ».
Nous eûmes vite fait d’importer la pratique du français à la maison, où le dialecte vénéto-véronais fut progressivement détrôné, d’autant plus que mon père, sur ses chantiers, et ma mère, chez les commerçants, avaient bien dû se mettre eux-mêmes à la langue de notre pays d’accueil.
Tandis que notre dialecte maternel déclinait inexorablement – sauf dans les rencontres familiales, au sein de la nombreuse colonie italienne du haut Brunoy –, l’italien aurait dû totalement disparaître de ma mémoire. Eh bien, détrompez-vous : il se maintint paradoxalement, et même y prospéra ; et voici comment.
Dans la maison traînait, depuis toujours, (Dieu sait comment il y était venu !) un roman d’Emilio Salgari, un Véronais, guarda caso, intitulé Le Selve ardenti. J’ai dû lire et relire une bonne demi-douzaine de fois cette histoire passionnante d’Indiens, pourchassés par les colons américains, qui finissaient exterminés sous les mitrailleuses de l’Armée fédérale, à l’exception de leur chef, une femme du nom de Minaha, qui réussissait à s’échapper avec une poignée de fidèles. Je me souviens encore de la première phrase du roman : « Due colpi di fucile rimbombarono lungamente nella prateria ». Le reste, oublié, a dû me marquer tout autant.
Par ailleurs, nous recevions à la maison – gracieusement, pour des raisons de propagande – un petit bulletin fasciste de quatre pages, rédigé et publié à Agen : une des principales capitales régionales de l’émigration italienne en France. Je passais, ça va de soi, sur bon nombre d’informations pratiques ; mais comment résister aux éditoriaux enflammés ou aux articles de fond, exaltant les grandes entreprises victorieuses du Duce. C’est ainsi que je participai moralement, avec quel enthousiasme, à la « Bataille du blé », à la conquête de l’Abyssinie, à la proclamation de l’Empire Italien.
Ah ! L’Abyssinie me valut bien des joies, mais quelques déboires aussi. J’étais alors en cinquième, dans un collège religieux, à Juvisy-sur-Orge. Et quand les nouvelles arrivaient, faisant état de la progression victorieuse de l’armée italienne, mon cœur vibrait d’élans patriotiques, et j’avais envie de chanter :
« Faccetta nera,
sarai romana.
La tua bandiera
sarà quella italiana… »,
chanson que nous avait apprise notre tante Marcella, l’intellectuelle brunoyenne de la famille : elle avait été maîtresse d’école à la maternelle de notre village.
Mais autour de moi, mes camarades de classe, et davantage encore mes professeurs, ne partageaient pas mes enthousiasmes. Je fus en butte à une sorte de persécution, ou du moins de quarantaine, et l’insulte usuelle « Va donc, sale macaroni ! » s’agrémenta de perfidies plus raffinées, dans le genre : « Va donc lécher le … de ton Mussolini ». Le comble fut atteint par un enseignant religieux – je mentionne ici son nom pour le désigner à la vindicte universelle – : l’abbé Roussel, qui, me reprenant à propos de je ne sais quelle sottise, me dit un jour : « Ce n’est pas de votre faute, mon petit, vous êtes italien ». J’espère qu’il grille encore aujourd’hui dans quelque bolgia dantesque.
Cet ostracisme eut pour effet de renforcer chez moi la fibre patriotique. Et, quand je quittai mon collège et fus inscrit, grâce à une bourse, au Lycée Louis-le-Grand, j’optai sans hésiter pour l’italien seconde langue, à côté de mon médiocre anglais : la première.
Merci, cher monsieur Garnier, de m’avoir ouvert la voie royale vers la langue et la poésie de Dante, les nouvelles et romans rusticani de Verga, les cadences musicales de Pascoli et de D’Annunzio… Je découvrais, avec stupéfaction, ce que je ne soupçonnais nullement : à savoir que l’Italie pouvait se targuer, dans l’histoire de la culture, d’une longue et brillante production littéraire et artistique, et – comble de fierté pour le jeune fils de l’Italietta umiliata, que j’étais – que cette production avait jadis influencé, et influence encore largement aujourd’hui, les littératures étrangères, dont la française.
Me revoilà donc de nouveau, à partir de seize ans, bilingue, cette fois au niveau élevé des études secondaires, puis universitaires. Ce bilinguisme, pédagogique et littéraire, devait me suivre pendant des décennies. Car, quelle autre voie pouvais-je emprunter dans ma vie professionnelle, sinon celle qui me menait à l’enseignement de la langue, puis de la littérature italiennes. Et, quand vint l’heure d’aborder la recherche, je m’efforçai spontanément de travailler, à chaque fois que je le pouvais, sur les deux versants de la chaîne des Alpes[5], me considérant comme un passeur entre mes deux cultures, qui tendaient maintenant à s’égaler.
Cependant, mon dialecte « gargagnagais » n’avait pas tout à fait lâché prise. Il se rappelait même, de temps à autre, à mon souvenir, en se glissant perfidement, sous forme de bévues, dans mon italien universitaire.
Ainsi, quand, après les résultats du CAPES et de l’Agrégation –, j’étais reçu au premier, recalé à la seconde[6] –, notre bon maître Henri Bedarida me reçut, rue de l’École de Médecine, pour la rituelle « confession », il me dit : « Ce n’est pas mal dans l’ensemble, mais vous avez d’étranges défaillances : pourquoi diable avez-vous traduit, dans le thème : “se boucher les oreilles” par “stuparsi le orecchie” (au lieu de “turarsi”) ». Je n’osai pas lui avouer que, chez nous, on ne connaissait que stuparse le rece.
Mon patriotisme italien bascula radicalement en 1940, lors de la défaite militaire de la France et du « coup de poignard » que Mussolini « nous » avait planté dans le dos. Adieu dialecte véronais, adieu italien ! Adieu, mère patrie !
Quoi d’étonnant si, à la fin de 1944, je me retrouvai engagé volontaire dans la 1ère Armée française. Parmi mes motivations : certainement celle d’acquérir en profondeur ma « naturalisation » française.
Un dernier épisode linguistique se présenta à moi, quand démobilisé sur place, en Allemagne, fin 1945, je me retrouvai journaliste aux « Nouvelles de France », quotidien de la zone française d’occupation, tout en préparant (à distance) ma licence d’italien. Rédacteur-reporter, j’eus un jour l’idée de me taper à la machine un ordre de mission, et de m’envoyer faire des reportages à Vienne, puis… à Venise : l’Autriche, l’Italie d’après guerre, c’était intéressant, non ? De Venise jusqu’à Vérone, il n’y avait qu’un pas.
C’était la première fois que je remettais le pied sur ma terre natale. (Je passe sur mes émotions !). Mais dans quelle langue allais-je donc parler, après quinze années d’absence, à mes oncles et cousins, que j’avais laissés à Sant’Ambrogio Valpolicella et à Castelnuovo Veronese ?… Eux, je les comprenais parfaitement ; mais moi ? Tant qu’il s’agissait d’embrassades et de tapes dans le dos, mes réminiscences dialectales passaient fort bien. Mais comment pouvais-je leur expliquer, en dialecte, que j’avais été chiffreur de messages secrets dans un service d’état-major, puis rédacteur d’articles, et autres tâches journalistiques. Les mots me manquaient, ou partaient estropiés ; les tournures syntaxiques sortaient difficilement, pas toujours compréhensibles. Il me fallait répéter… Mon langage était devenu étranger ! Quoi de plus navrant que de ne pouvoir communiquer convenablement avec les gens qu’on aime ? On décida, d’un commun accord, de passer à l’italien. L’artifice !… La honte !… Et pourtant.
Mes cousins aussi, par d’autres moyens, avaient été conquis par le parler in lingua. La guerre, naturellement, ce grand broyeur de dialectes et promoteur de la langue nazionale. Mais, les circonstances locales aussi : l’arrivée de la presse quotidienne, de la radio ; et puis, leurs activités professionnelles : l’une était devenue institutrice, l’autre employé de mairie, un troisième représentant en assurances, etc.
En fin de compte, par nécessité plus que par conviction, nous nous étions rendus, l’un et les autres, aux impératifs de la langue du pays dove il dolce sì suona.
Adelin Charles Fiorato, 2009
Texte publié dans l'ouvrage Enfants d’Italiens, quelle(s) langue(s) parlez-vous ?
[1] Gargouille, Livry Gargan, Gargantua, glougloutants eux aussi, n’en ont que deux.
[2] En étudiant Bandello, j’ai découvert un jour que les Serego étaient lointainement apparentés aux Alighieri : un autre titre de gloire pour le village !
[3]« Su, figlio mio, cosa vuoi andare a zappare a quest’ora » ; Il sapone = lo zappone ; sapar = zappare.
[4] « Allons donc, celui-là c’est un garçon de papier ».
[5] Voir, entre autres, mon anthologie d’articles, Oltralpe et outremonts, Regards croisés entre l’Italie et l’Europe à la Renaissance, in Studi francesi, numéro spécial, Supplément 139, Turin, Rosemberg et Sellier, 2003.
[6] Je fus reçu l’année suivante, quand je pus suivre les cours.
