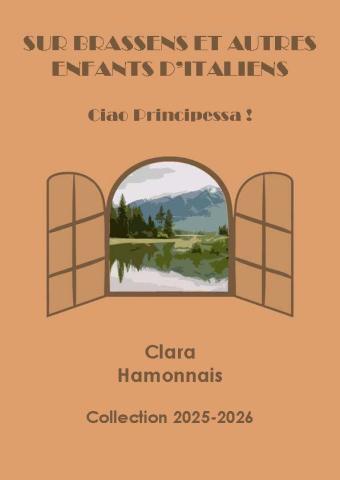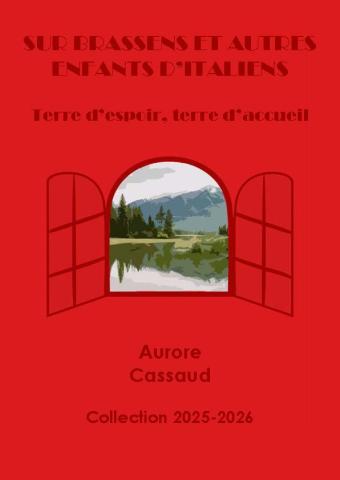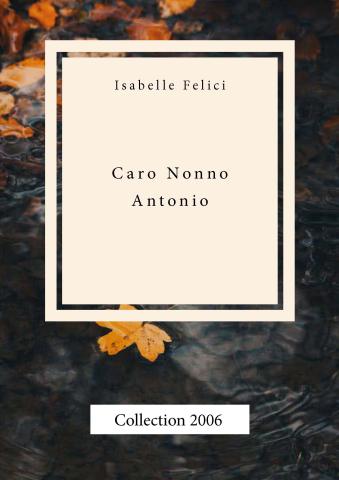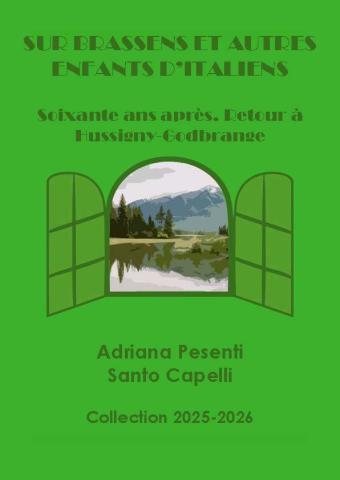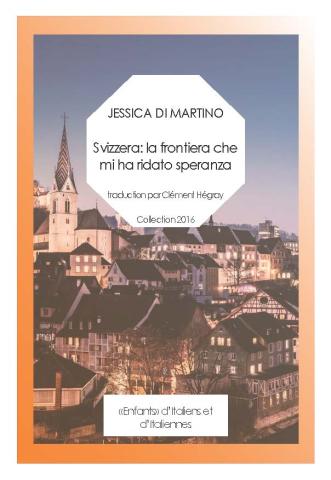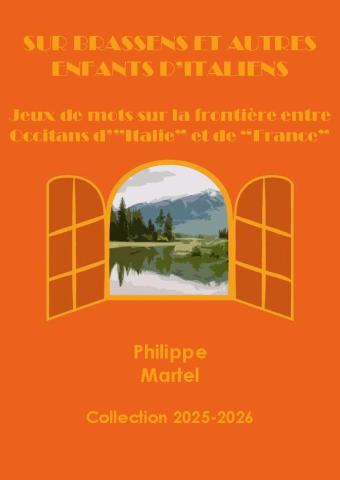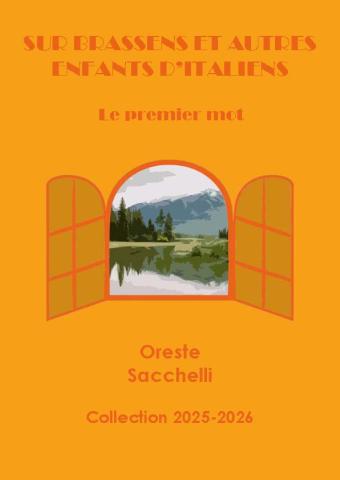Être enfant d’Italiens émigrés en France, dans les années vingt, n’a certainement pas été pour moi
une expérience traumatisante, mais a déterminé la plupart des grands choix qui dessinent une vie.
Cette prise de conscience a été tardive, à l’âge adulte, quand j’ai reconnu chez mes propres enfants les
symptômes d’une double identité que j’avais transmise sans même m’en apercevoir. Ce n’est qu’avec
le recul du temps et une réflexion plutôt récente que j’ai commencé à dénouer les fils d’un écheveau
resté caché dans un coin de la conscience.
Mais comment pouvait-il en être autrement quand toute mon enfance avait été marquée par un
non-dit qui avait mis en sourdine notre origine italienne tout en préservant son intégrité ?
Le non-dit
Née en France de parents déjà français, naturalisés en 1947, je n’ai pas connu bien sûr les
déchirements de l’émigration. Si traumatisme il y eut, il appartenait à mes parents et ceux-ci ne nous
en parlèrent jamais. Certes, le récit du départ de mon père qui quitta son petit village bergamasque
à l’âge de quatorze ans, confié, avec un frère à peine plus âgé, à une vague de migrants qui allaient
chercher fortune en France, poussés par la misère, faisait partie de notre mémoire familiale. Mais un
récit d’aventure, avec tous ses aspects téméraires, courageux, éprouvants aussi – l’hébergement dans
des abris de fortune, les hangars surpeuplés, la récolte des melons aux alentours de Cavaillon, celle
des betteraves dont on sortait plié en deux après des heures de travail sans pouvoir se redresser, etc.
(quelque chose de semblable aux images de l’émigration d’aujourd’hui) –, jamais le récit d’un vécu
dramatique, mais celui d’une expérience épique qu’on est fier d’avoir supporté et qu’on raconte aux
enfants, parfois, pour leur inculquer le sens du courage et leur dire que dans la vie il faut savoir gérer
les difficultés. Même l’arrivée de ma mère, la jeune épouse que mon père – déjà décidé à s’installer
définitivement en France après une tentative de retour en Italie brisée par le fascisme – était allé
chercher au pays, nous fut racontée comme une épreuve douloureuse mais surmontée avec courage
et volonté. Elle avait vingt ans, pas un mot de français, l’ingénuité et l’inexpérience des villageoises.
Mon père lui apprit vite comment affronter les difficultés. Elle nous racontait souvent, les larmes aux
yeux mais la fierté au front, comment son mari entendit faciliter son intégration : le soir même de
son arrivée en France, il lui expliqua en deux mots comment se rendre à l’épicerie du coin pour faire
les courses, lui mit quelques pièces de monnaie dans la main, lui fit répéter deux ou trois fois une
phrase en français (Bonjour Madame, un litre de lait s’il vous plaît – elle s’en souvenait encore !) et
ne lui adressa pratiquement plus la parole en italien. Full immersion, dirait-on aujourd’hui, sans état
d’âme !
De la dureté du travail (dans les campagnes puis dans le bâtiment, comme manœuvre dans un
premier temps puis très vite en tant qu’artisan-maçon à Dijon, à son compte), de ce travail acharné et
méticuleux, mon père ne parlait que pour exalter la grande capacité de résistance et l’amour du travail
bien fait, la voie royale pour atteindre son but : sa pleine intégration et l’estime des Français. Pas
question de se distinguer sinon par la qualité du travail, l’honnêteté, la parole donnée, la ponctualité.
Par la courtoisie aussi, par une politique d’ouverture aux autres : il fallait que l’on sache que chez les
Italiens la porte est toujours ouverte. Nous étions en effet la seule maison du quartier où les voisins
pouvaient venir frapper sans problème sachant y trouver, toujours, le sourire et la disponibilité à
rendre service. Une seule devise, en deux volets complémentaires : « En France on fait comme les
Français » et « Ils doivent savoir de quoi sont capables les Italiens ».
Avec de telles consignes, plus implicites qu’explicites, intériorisées et jamais criées, comme une
discipline comportementale profonde assimilée dans notre ADN, il est vrai que dans notre famille il
était même superflu de parler d’intégration. Le succès économique aidant, il est plus juste de parler
d’une pleine inclusion, vécue avec sérénité, dans la vie sociale française au point que notre origine
italienne me semblait une appartenance lointaine, surprenante parfois, à laquelle je fus d’abord,
jusqu’à l’adolescence, assez peu intéressée.
Bien sûr, les malices ne manquèrent pas : les macaronis, les ritals, les dérisions, le mépris parfois,
etc., mais elles n’eurent aucun poids sur notre conviction d’être français parmi les Français, elles
furent perçues comme des incidents de parcours auxquels il ne faut pas donner d’importance vu que
les manifestations d’estime étaient infiniment supérieures aux tentatives de vexation ou autre. En tout
cas, si vexation il y eut, elle fut aussitôt refoulée. La volonté d’inclusion était telle qu’il n’y avait point
place pour s’apitoyer et qu’elle filtra toutes les perceptions négatives.
Un équilibre bien dosé cependant, qui ne devait jamais dépasser les limites d’un orgueil italien,
discret, caché, silencieux mais toujours sensible. Alain, mon jeune frère, m’a rappelé récemment un
épisode que j’avais complètement effacé de ma mémoire : au cours de la distribution du verre de lait
qui nous était servi à l’école primaire tous les mercredis, un petit camarade le bouscule en lui disant
que les ritals n’ont pas droit à ce bénéfice. Alain lui répond par un poing dans la figure qui lui doit une
sévère punition. Il savait qu’à la maison toute infraction à la discipline était considérée inadmissible
et qu’il aurait dû subir les réprimandes paternelles après avoir subi celles des autorités scolaires. Mais
non, en fait il avait parfaitement mesuré, instinctivement, l’équilibre à ne pas dépasser : arrivé à la
maison, il dut raconter l’épisode, craignant une réaction négative. Cette fois, mon père le félicita :
il avait bien fait, le respect devait être réciproque ! C’était une manière de nous inculquer le dosage
délicat entre notre identité française et notre appartenance italienne.
Mais en quoi étions-nous encore italiens ? Quels signes, quelles coutumes nous liaient encore
à nos origines ? Bien peu en vérité. Ni la nationalité, à jamais perdue, ni la langue – pas un mot
d’italien à la maison (sauf les chants populaires italiens que mes parents entonnaient dès que nous
roulions en voiture et auxquels nous ne comprenions rien : Mamma mia dammi cento lire ou Nóter
de Bèrghem) – ni la connaissance du pays où nous n’étions jamais allés (sauf de brèves vacances à la
mer, anonymes, à Vintimille, mais jamais au pays natal), ni des liens familiaux forts, au contraire, des
contacts rituels avec notre famille italienne, après la mort des grands-parents que nous ne connurent
pas mais dont nous savions qu’ils avaient été soutenus financièrement par nos parents toute leur vie
durant, ni la cuisine de ma mère rigoureusement française à part quelques plats typiques consommés
occasionnellement : le risotto, la polenta (remuée avec le bâton du grand-père bergamasque dont
mon frère est aujourd’hui le gardien) ou encore les châtaignes grillées enveloppées dans du papier
journal. Rien, presque rien, quelques repères seulement, noyés dans un non-dit obscur et silencieux.
Alors comment cette origine italienne a-t-elle pu ne pas sombrer dans l’oubli ? Rarement nommée,
jamais affichée, cette appartenance italienne a été alimentée par ce non-dit. À bien y réfléchir, tout
était passé au filtre d’une double lecture sans qu’il en soit dit un seul mot. Le succès scolaire par
exemple : je percevais la joie de mes parents quand j’apportais de brillants résultats. Ils ne me le dirent
jamais mais j’étais pour eux la digne fille d’un Italien et l’ascenseur social se tintait silencieusement
d’une fierté identitaire. Ce fut certainement pour moi le moteur inavoué d’une irrésistible envie de
réussir et de confirmer une dignité toujours à conquérir. Et puis, le cœur qui battait si fort quand les
Italiens remportaient un match de foot ou bien encore une fierté joyeuse quand Gigliola Cinquetti
remporta le concours de l’Eurovision ! Une source profonde, nourrie d’émotions intérieures non
déclarées ou jalousement cachées au fond du cœur, une source profonde qui ne nous empêchait pas
de nous sentir pleinement et heureusement français, sans ambiguïté, sans distinctions, dans un pays
que nous sentions nôtre, sans racines ni mémoire mais projetés vers un futur.
La révélation
Ce fleuve intérieur, tranquille et indolent, fit irruption chez l’adolescente que j’étais, au détour
d’un dialogue avec ma meilleure amie, Régine. Nous faisions ensemble, chaque jour, le trajet qui
nous séparait de notre lycée et la conversation allait bon train : des remarques les plus anodines aux
grands débats politiques, des chefs d’œuvre de la littérature qui nous passionnaient toutes deux au
quotidien des relations familiales, enfin un dialogue entre deux amies adolescentes, toujours côte à
côte et partageant les mêmes idéaux et les mêmes questionnements. Au coin d’une rue, en attendant
que le feu passe au vert, la phrase qui va changer ma vie : « Il a vraiment eu de la chance ton père !
– Pourquoi ? – Eh bien, la chance de rencontrer la France ! ». Mon sang ne fit qu’un tour dans mes
veines et j’eus du mal à reprendre la marche. Que se passait-il ? Que m’avait donc dit Régine d’aussi
bouleversant ?
Rien de méchant bien sûr, mais elle venait de me dire, inconsciemment, que nous étions différents.
Elle venait de me dire que sa perception de notre famille n’était pas celle d’une famille pareille à tant
d’autres et appartenant à la même communauté, mais celle d’une famille étrangère qui avait eu la
chance de pouvoir intégrer la France. La différence, nous et les autres, voilà ce que j’avais découvert
en cet instant et jamais soupçonné auparavant. Au fond, mon père lui aurait sans doute donné
raison, lui qui était reconnaissant à la France de lui avoir donné l’opportunité de construire un avenir
meilleur pour ses enfants, lui qui nous éduquait dans le respect de la France tout en conservant, au
fond de l’âme, son appartenance italienne. Régine avait donc bien dit. Mais pour moi, le monde était
renversé. Cette différence dans la perception de l’autre me bouleversa. Au coin de cette rue, en une
seconde, j’avais pris conscience de ma différence, j’étais devenue italienne. Tout s’enchaîna très vite
dans ma tête d’adolescente. La France avait fait de moi une fille de la République et je ne réussissais
pas à comprendre pourquoi la réussite des uns était chose due, normale et celle des autres « une
chance », pourquoi les Français avaient du mérite alors que mon père, qui s’assommait de travail,
était simplement chanceux. Ne pouvait-il pas lui aussi être reconnu comme un citoyen à l’égal des
autres, récoltant semblable aux autres le fruit de ses efforts ? Quels citoyens étions-nous donc pour
les Français ? Mise devant cette distinction, « nous et les autres », je laissai le fleuve souterrain de
mon italianité, assoupi et réprimé depuis toujours par ma propre famille, envahir ma vie.
Régine ne sut jamais quel changement elle venait de provoquer en moi. Moi qui avais tant
de fois engagé avec elle des batailles idéales pour la justice et la liberté, qui avais partagé avec elle
l’enthousiasme commun pour les grands principes d’égalité, avec la foi et la fougue de l’adolescence,
je me tus, je compris qu’il s’agissait là d’une dimension personnelle, intime, complexe, que moi seule
devais explorer et dénouer.
La révélation de « la différence » fut un nouveau départ. Je sentais en moi une force nouvelle, celle
de la libération et le jour même, en rentrant à la maison, je prétendis des explications. Alors, nous
sommes italiens ? C’est ainsi qu’on nous perçoit ! Pourquoi ne me l’avez-vous pas dit plus clairement ?
Alors, je ne suis pas dans mon pays, ici, je suis en pays d’accueil ? C’est comme ça ? Et le mérite, le
travail, tout cela, à quoi bon ? Nous avons seulement de la chance ! Pourquoi ne m’avez-vous jamais
parlé italien, pourquoi parle-t-on toujours à demi-mot de ce pays, si nous sommes italiens ?… Une
avalanche de questions, de reproches, d’accusations presque, s’abattit sur mes parents ahuris par
tant de passion chez la petite Française bien sage et raisonnable qu’ils avaient élevée pour qu’elle
accompagne leur chemin discipliné et rigoureux sur les rails de la parfaite intégration dans un pays
qu’ils sentaient désormais et depuis longtemps comme le leur, celui du futur de leurs enfants, loin,
bien loin d’une origine italienne restée vivante mais confinée à la sphère intime et sentimentale de
chacun de nous. C’était cette sphère justement que je voulais maintenant ouvrir, sonder, comprendre,
faire remonter à la surface. Le bouchon avait sauté.
Je prétendis qu’on me rende un patrimoine dont on m’avait injustement privée, les signes
d’une italianité devinée : la langue, la connaissance du pays, de la famille. Après une période de
consternation, mes parents finirent par comprendre que rien ne m’aurait arrêtée et par se sentir eux
aussi, sans doute, attendris par cette résurgence sentimentale inattendue qui devait caresser les replis
de l’âme où ils avaient relégué leurs racines. Je ne pouvais pas compter sur eux pour la langue qu’ils
avaient abandonnée depuis leur départ ; j’obtins un changement de lycée pour pouvoir apprendre
l’italien en deuxième langue dès la rentrée suivante. À seize ans, j’étais trop jeune pour voyager seule
dans un pays « étranger »... mais après la récolte des groseilles dans les campagnes environnantes pour
gagner de quoi payer mon billet, ma mère, terrorisée mais émue, finit par céder et contacta un oncle
qui, à la gare de Milan, m’aurait reconnue à ma robe rouge à pois blancs et m’aurait accompagnée
dans le petit village bergamasque que mon père avait quitté un demi-siècle auparavant. J’avais gagné
ma bataille, avec des forces venues d’on ne sait où, des profondeurs de l’âme, de l’obscurité de la
conscience, du non-dit.
Les retrouvailles
Ce furent des retrouvailles, même si je n’avais jamais mis pied en Italie et n’en possédait pas
encore la langue.
À la gare de Milan, comme prévu, mon oncle Luigi me reconnut à ma robe rouge à pois blancs !
Il essaya bien de m’entretenir dans le petit train cahotant, aux sièges de bois, qui nous conduisait à
Bergame... mais à part quelques mots très vite épuisés (quelques semaines seulement étaient passées
depuis la « révélation » et je n’avais pas eu le temps de me mettre à l’italien), le dialogue ne put aller
très loin, le silence finit par s’installer et le regard prit la relève. Mon oncle me regardait silencieux,
visiblement ému et un peu embarrassé ; il avait les mêmes traits que ma mère et il devait retrouver la
même chose en moi. C’était la première fois que je retrouvais dans un visage les traits de mes parents.
Il avait donc fallu que je vienne jusqu’ici pour percevoir cette sensation nouvelle : reconnaître le lien
tangible d’une appartenance familiale, me réapproprier du fil qui relie les membres d’une même
famille. Jamais je n’aurais pensé qu’une telle expérience, aussi banale soit-elle pour la plupart des
personnes normalement habituées à retrouver des airs de famille autour d’elles, puisse être aussi
bouleversante pour ceux qui, comme moi n’avaient pas éprouvé l’émotion d’une ressemblance. Je
commençais à sentir qu’effectivement une fracture avait eu lieu, que le moment était venu de ramasser
les morceaux, de recomposer le puzzle, de comprendre de quoi était faite cette unité originale dont la
nostalgie était née sans même qu’on s’y réfère. Ce n’était que la pointe de l’iceberg, les racines étaient
prêtes à affleurer, à profusion.
Au village, un vieux bourg accroché aux flancs des collines de la Val Brembana, mitigé entre les
vieilles pierres et les nouvelles coulées de ciment, on m’attendait. Toute une communauté m’attendait :
torna la figlia del Guido e della Laura! Je ne les connaissais pas, personne ne m’avait parlé d’eux,
mais eux ne nous avaient pas oubliés, ils savaient qui était parti, revenu, ils se souvenaient de leur
départ, ils avaient mémorisé les migrations, les retours, l’histoire des familles et l’avaient transmise
à leurs enfants, ils se souvenaient du nom de chaque homme, de chaque femme, émigrés il y a si
longtemps, ils avaient recueilli ici et là les informations rapportées par ceux qui étaient revenus ou
passés par là ; en quelque sorte, ils avaient tenu un carnet de bord de l’essaimage des enfants du pays,
de cette diaspora qui avait vidé les villages de la région pendant plusieurs décennies. Ils m’attendaient,
tous, regroupés devant la maison familiale en chantant à pleine gorge les mêmes chansons que
celles qu’entonnaient mes parents en voiture, seul vestige oral d’un univers communautaire lointain
(encore quelques titres dont je me souviens : E qui comando io, Tu sei la stella di noi soldà.) Après
avoir retrouvé les traits de ma mère sur le visage de mon oncle, je pressentais, stupéfaite, que la toile
immense, tissée par une mémoire occulte, commençait à peine à s’entrouvrir et se serait révélée par
cercles concentriques jusqu’à m’englober dans ses filets : les racines.
Quand ce fut le tour de mes parents de nous quitter pour toujours, plus de soixante ans après leur
départ, je fis en sorte que la nouvelle arrive au village : je savais qu’alors les cloches auraient sonné le
glas des migrants, de ceux qui ne sont pas revenus et qui meurent loin de leur terre natale : il Guido
e la Laura étaient restés des enfants du pays.
Durant ce mois de vacances de l’été 1964, je découvris un monde inconnu qui ne m’était pourtant
pas étranger. Je découvris ce que signifiait avoir des racines, venir de quelque part, ressembler à un
aïeul, reconnaître un lieu jamais vu auparavant mais ancré dans la mémoire à travers les flashs, les
images mentales imprimées jour après jour par les récits de nos parents, pourtant discrets et avares.
C’est ainsi que je reconnus instantanément la pièce où ma mère avait exercé son métier de couturière
au rez-de-chaussée de la maison familiale : j’en avais une connaissance sensitive tant elle avait été
l’objet de récits joyeux, d’anecdotes qui regorgeaient du labeur et de la gaité de leur jeunesse. Mes
pieds reconnurent le sentier qui montait al monte, les prés verts et fleuris, là-haut sur la colline qui
surplombait le village où l’on allait faucher l’herbe autrefois, une hotte en osier sur le dos, devenus
aujourd’hui un lieu de rencontre pour les dimanches de détente ou les soirées chantantes en famille.
Je reconnaissais surtout cette joie du vivre ensemble qui m’avait frappée dans les tableaux, pourtant
rares et succincts, que mes parents avaient peints de leur vie au pays. Une gaité, une convivialité, une
spontanéité dans les relations que je n’avais rencontrées nulle part ailleurs mais qu’il me semblait
reconnaître. Sans jamais avoir voulu nous parler de l’Italie, sans la nommer, mes parents nous
avaient transmis la nostalgie d’un monde de relations, où la communication et le partage avaient
une dimension presque féérique. C’est cette dimension restée à niveau de l’imaginaire que je pouvais
maintenant palper, caresser, savourer et qui constituait une véritable révélation : je n’avais jamais
connu un tissu social et familial aussi dense, aussi chaleureux, jovial, un tel enthousiasme, une telle
capacité d’exprimer ses sentiments aussi intense et immédiate. Ce débordement d’intérêt, de curiosité
et d’affection fut comme une libération du cœur qui m’ouvrait les portes d’une autre expression de
soi, qui me faisait sortir de la vie rationnelle, disciplinée, réservée, faite surtout de devoir et de
rigueur qui était la mienne dans mon milieu français.
En outre, les signes de la misère avaient disparu. Plus, le luxe des maisons me surprit : les marbres,
les sols toujours brillants et astiqués par des ménagères perfectionnistes, un style de vie qui valorisait
l’élégance et le goût. Le sens du plaisir après celui du travail, une expression de soi désinvolte et sans
complexe, l’orgueil de la réussite individuelle et collective en même temps qu’un irrésistible besoin
de s’affirmer en dehors des règles. En somme, un autre univers qui m’interpellait par la complicité de
ses racines et me projetait vers une autre manière de sentir le monde.
À la fin de l’été, avant de quitter la vallée de mes ancêtres, je descendis encore une fois sur la grève
du Brembo, la rivière devenue le lieu de nos baignades, mais surtout, restée par excellence un lieu de
mémoire. Ses pierres polies par ses eaux tumultueuses ne m’étaient pas non plus étrangères et étaient
bien présentes dans le bagage imaginaire que les récits de ma mère avaient lentement sédimenté : je
l’imaginais descendre sur la rive du Brembo, laver son linge en chantant à tue-tête avec les lavandières
du village, j’imaginais les hommes et les femmes de la paroisse qui, le dimanche, venaient se charger
de belles pierres rondes et lisses qui auraient servi à construire la nouvelle église, une communauté
villageoise joyeuse qui grimpait le long des sentiers caillouteux vers le haut de la colline, pliés sous le
poids de leur fardeau et chantant eux-aussi à gorge déployée, le cœur léger, pour vaincre la fatigue.
Le torrent emporta la passion de mes seize ans : je fis le serment solennel de ne jamais abandonner
le fil de la mémoire que je venais de renouer et de rentrer chez moi (en France) pour servir le pays
de mes ancêtres, pour en apprendre la langue, l’histoire, pour en diffuser la culture, pour dire à tous
que je l’avais retrouvé. Ce fut un tournant dans ma vie.
Le tournant
Désormais j’avais un but, ma nouvelle vie était tracée. Au lycée, l’apprentissage de l’italien fut
une fulguration. La rencontre d’une enseignante d’italien extraordinaire qui allait orienter toute
ma formation, non seulement linguistique mais culturelle, fit le reste. Je dévorai l’italien comme s’il
s’agissait d’une réappropriation ; je découvris la culture italienne, la littérature, l’art, l’histoire comme
à travers un phénomène d’osmose, au point que quelques années plus tard, arrivant pour la première
fois à Florence, j’eus l’impression de tout connaître déjà et d’y revenir.
Je retournai chaque été dans mon petit village bergamasque, maîtrisant parfaitement la langue
cette fois, affamée de savoir, convaincue que j’étais en train d’accomplir un parcours prédestiné : la
reconquête d’une identité perdue et son épanouissement à travers la culture. Ma famille italienne
comprit vite que j’avais dépassé le stade sentimental et me présenta Adriana, une jeune enseignante
avec laquelle j’allais pouvoir assouvir ma soif de culture. Une longue et profonde amitié naquit qui ne
se contenta pas des quelques semaines de vacance d’été pour partager notre passion commune, mais
franchit les limites du temps et de l’espace et s’installa dans un dialogue épistolaire des plus intenses.
Je conserve encore ses lettres où elle m’introduisait à la lecture de Dante et m’illustrait les merveilles
de la Divine Comédie.
Je me détournai des matières scientifiques auxquelles j’étais pourtant promise et me consacrai
uniquement à comprendre les mouvements de l’âme et de l’esprit. Après un bac philo, une maîtrise
d’italien : des années d’études passionnantes et heureuses, menées avec une énergie sans faille,
une plénitude absolue, car je menais de front le savoir et la réappropriation d’un monde affectif et
sensoriel qui m’avait été nié.
Mes parents, qui n’auraient jamais imaginé un tel rapprochement avec l’Italie et qui au contraire
avaient tout mis en œuvre pour nous forger un destin franco-français, furent d’abord surpris, puis
émus et flattés par cette orientation inattendue qui leur restituait en quelque sorte la fierté de leur
origine et ouvrait une brèche dans leur positionnement en faveur d’une intégration rigoureuse, même
au prix du sacrifice de leur appartenance italienne. Nous ne fréquentions pas les Italiens installés
à Dijon, mais nous faisions partie à plein titre du réseau de solidarité qui liait toutes les familles
italiennes : on ne refusait jamais un service à une famille italienne en difficulté. Je repris à mon
compte cet enseignement et j’entrai en contact avec des Italiens fraichement arrivés pour les assister
dans leur installation, j’entrai dans d’autres familles d’Italiens qui, contrairement à la mienne, avaient
conservé la langue, les coutumes, avaient cultivé leur appartenance. Je compris que chacun réagissait
à sa manière à cette fracture qu’est l’émigration, volontaire ou obligée qu’elle soit et je commençai
à prendre un peu de recul par rapport à cette condition, à faire une lecture moins émotive et plus
réfléchie de chaque comportement, avec ses contraintes et ses espoirs, à commencer par l’expérience
de mes parents.
Cela m’aida à les comprendre lorsqu’ils se désespérèrent à l’annonce de mon mariage avec un
Italien et à ma décision d’aller vivre au-delà des Alpes, faisant le parcours inverse à celui qui les
avait conduits en France un demi-siècle auparavant. Le tournant avait ainsi atteint sa plus grande
amplitude.
Une double identité à l’épreuve
Je devais désormais assumer et gérer ma propre décision et, je ne l’avais pas pris en compte, la
réaction de mon entourage. Celle de mes parents était compréhensible : leur affliction n’était pas liée
seulement à l’éloignement d’une fille (les distances étaient à l’époque bien plus difficiles à parcourir)
mais à la crainte de la voir retomber dans la situation qu’ils avaient dû fuir. J’avais beau leur avoir
parlé du « miracle italien », d’une métamorphose totale du pays qu’ils avaient quitté, sur le plan
économique et social, ce « retour » prenait en quelque sorte la couleur d’un désaveu, d’un jugement
sur leur propre choix d’émigrer, une remise en cause de leur itinéraire d’émigrés parfaitement
intégrés. À quoi bon avoir affronté tant de sacrifices pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants
si maintenant ceux-ci revenaient sur leurs pas ? Mon père m’avertit de ne point compter sur lui pour
venir me voir en Italie, il avait rompu pour toujours avec ce pays ; heureusement il ne maintiendrait
pas sa promesse ! Ma mère pleurait à chaudes larmes pensant à la dureté des Bergamasques et à la
discipline à laquelle mon père l’avait pliée pour accélérer son intégration sans s’apitoyer sur son sort.
Le pire pour moi devait arriver du milieu universitaire dans lequel je m’étais épanouie et qui
m’avait accompagnée dans la découverte de l’Italie des arts, de la culture, de la pensée, qui m’avait
assuré une formation intellectuelle solide et donné les outils conceptuels nécessaires pour une
lecture ouverte des autres mondes. Lorsque j’allai saluer le grand patron des italianistes, le chef du
département d’italien à l’université, il fut lapidaire : « Alors, vous ne passerez pas l’agrégation ? Est-ce
que vous aurez les pieds au chaud au moins ? ». En deux phrases, les adieux furent consommés :
mon maître à penser avait fait le calcul d’une inscription en moins au concours et avait liquidé mon
choix, dont j’aurais tant voulu lui parler – à lui qui nous avait fait aimer la culture italienne – à
une évidente erreur d’évaluation, une réaction qui ressemblait fort à celle de mes parents et qui me
troubla bien davantage car elle n’était pas justifiée par un lien affectif profond. À une exception près,
celle d’un jeune universitaire fils d’Italiens lui aussi, je reçus partout la même réponse, le même air
contraint et perplexe devant une décision qui aurait impliqué une régression.
Mais quelle régression ? Économique, sociale, culturelle ? Je finis moi aussi par me laisser
contaminer par cette peur. J’étais le produit de l’école française, pour le meilleur et pour le pire. On
m’avait bien appris que la France « a la forme d’un hexagone parfait » et que sa culture est universelle.
Aucune prise de distance venant d’une expérience autre, de la mobilité ou de l’ouverture d’horizons
culturels différents ne peut totalement détruire cette conviction intime, profondément ancrée par
l’école et l’orgueil national dans l’âme de tout Français, qu’il appartient à une société supérieure. Des
années durant, j’allais devoir combattre, à chaque retour en France, cet air apitoyé de mes anciens
camarades, de mes collègues, etc., devant une personne qui avait eu le courage (ou l’inconscience)
de faire un choix aussi téméraire. En vérité, je dois l’avouer, cette conviction avait fait son nid chez
moi aussi, d’autant plus que toute mon éducation familiale s’appuyait sur cette évidence. Il me fallait
donc me dédoubler pour affronter une épreuve de taille : passer d’une société meilleure à une société
inférieure pour des raisons de cœur ! Une double identité commença à se dessiner : une tête française
et un cœur italien, une dualité insupportable, génératrice de clichés et de préjugés que j’allais mettre
très longtemps à vaincre, sur le plan intellectuel et émotif.
En Italie, tout fut plus facile sur le plan relationnel grâce à un accueil d’une générosité et
d’une sympathie extraordinaires. Le Piémont m’ouvrit les bras avec tant de chaleur, de curiosité
et d’admiration que je crus y déceler parfois la confirmation que j’arrivais effectivement d’un pays
privilégié pour mériter autant d’égards ! Partout le même enthousiasme, une luminosité humaine et
atmosphérique qui, après les brumes bourguignonnes, se fraya un chemin dans mon âme et m’ouvrit
les portes d’un bien-être que je n’avais pas connu auparavant. Bien sûr, il y eut des étapes difficiles,
à l’université par exemple où, à l’époque, on ne parlait pas d’équivalence des diplômes et où je dus
affronter l’épreuve la plus contrariante : me faire accepter par un monde académique clos et obtus, le
seul grand obstacle que j’aie rencontré. Je mesurai le fossé énorme qui sépare les deux cultures. Je dus
passer des plans, des schémas, des « idées claires et distinctes », de la rigueur des épreuves écrites à
la virtuosité orale, à l’exposition non plus articulée mais désinvolte, de l’analyse rigoureuse des textes
à la contextualisation tous azimuts, de la technique pure à la recherche des liens culturels. Avant
de pouvoir réaliser que cet effort allait devenir un enrichissement majeur, je vécus cette différence
comme une dualité imbue de jugements de valeur. Les universitaires italiens exprimèrent tout leur
mépris pour mon approche rationnelle et conceptuelle mais certes bien pauvre et peu érudite pour
les passionnés de l’historicisme qu’ils étaient ; ma formation française me disait que cette obsession
de l’histoire restait superficielle sans aller au fond des choses, sans dégager les concepts. J’eus
beaucoup de mal à faire reconnaître des compétences durement acquises dans le système français
et non valorisées de l’autre côté des Alpes. Il me fallut longtemps pour comprendre à quel point les
deux approches étaient en réalité complémentaires, combien l’union de la recherche conceptuelle
et de l’ancrage historique, l’union de l’analyse ponctuelle et de la lecture holistique constituait la
force de la pensée. Il me fallut passer par bien des déceptions et des colères avant d’avoir pris la
distance nécessaire pour ne pas juger le bon d’un côté et le mauvais de l’autre, mais pour gérer ces
outils intellectuels différents en les unissant au lieu de les opposer. Quelle déception par exemple
quand, devenue proviseur d’un lycée italien, j’organisai une journée de formation sur l’approche du
texte en présence d’enseignants français et italiens qui auraient pu échanger leurs compétences et
leurs méthodes : les Français déclarèrent qu’ils voulaient bien nous livrer les clés de leur art mais
n’attendaient rien d’un échange réciproque et les Italiens, vexés par tant de condescendance virent en
moi la proviseur française qui n’arrivait pas à guérir sa nostalgie de la « méthode » ! Il était sûrement
illusoire de prétendre que ce que j’avais mis des années à assimiler – l’humilité de la confrontation et
du partage – ne pouvait être transmis et digéré en quelques heures.
Le fait est que pendant des années cette dualité me poursuivit. Devenue italienne en France et
toujours perçue comme française en Italie (mon accent aidant), cette double appartenance ne fut pas
toujours facile à vivre, surtout lorsqu’elle apparaissait comme un antagonisme alors qu’avait mûri en
moi un processus d’osmose dont je commençais à percevoir la richesse. Je n’étais plus déchirée entre
deux identités, j’étais prête à vivre une identité plurielle et j’en saisis l’occasion dès qu’elle se présenta.
L’occasion, ce fut une autre migration.
De la contamination à la dissémination
Lorsque l’opportunité de migrer une seconde fois se présenta, pour des raisons professionnelles
(mon mari et moi étions entrés comme attachés culturels dans le réseau des Instituts culturels italiens à
l’étranger), ce fut une victoire du verbe « partir ». Partir pour recommencer, partir pour se confronter
à autre chose, pour se remettre en cause, pour apprendre à lire un autre monde. Nos pérégrinations,
en particulier dans les pays de la rive sud de la Méditerranée (Algérie, Tunisie, Albanie), furent
vécues à l’enseigne de l’écoute de l’Autre, de la soif de comprendre un autre monde, de se confronter
avec une autre culture. Ce n’est que quelques années plus tard, à l’heure des bilans, que je compris
combien mon expérience familiale – de fille d’émigrés – avait été déterminante dans ce nouveau
choix de vie. Nous avons embarqué nos enfants dans cette aventure de confrontation culturelle mais
aussi de déracinements successifs durant toute leur enfance et adolescence, convaincus qu’il n’y
avait de meilleure école que celle de la confrontation permanente, de la gestion des différences, de
l’acquisition sur le terrain d’une capacité de lecture plurielle. Le ciment qui devait les protéger contre
toute défaillance, c’était la famille, toujours unie, compacte, come un carro armato disions-nous. Ce
n’est que quelques années plus tard, quand ma fille Laura eut besoin elle-aussi de faire une pause de
réflexion sur ces années à l’enseigne de la mobilité, que je pris conscience avec elle de l’ampleur de
l’épreuve que nous avions demandé à nos enfants de partager.
Chacun d’eux y répondit avec ses propres ressources. Mon fils Igor, avec une extraordinaire
capacité d’acceptation et d’adaptation aux ballotements familiaux ; avec une docilité qui ne fut pas
sans troubles intérieurs et déboucha à l’âge adulte sur un besoin farouche de stabilité, une volonté
impérieuse de prendre racine quelque part, un attachement à la terre inversement proportionnel à la
longue histoire de fractures qui était celle de sa famille. Et cette impatience qu’il a toujours manifestée
à l’égard de la mémoire, d’où vient-elle ? Le poids intolérable de la mémoire qui lie les générations
à un modèle de comportement à travers les choix, les objets, les relations sont pour lui autant de
liens dont il continue à se méfier. Et ce grand-père franco-italien qui l’a si tendrement accompagné
et initié à l’art du travail manuel ? Il lui en reste bien sûr un souvenir affectueux mais aussi l’image
d’un modèle encombrant dont l’expérience et l’autorité dominatrice ont marqué lourdement le destin
de toute une génération. L’histoire de ce grand-père qui a su « partir » et se frayer un chemin avec
les armes du travail et du devoir, il ne veut plus la porter. Il a choisi pour lui et sa petite famille une
vie très sédentaire, dans une région où aucun de nous n’a d’attaches, la Toscane, et en fait de racines,
il est plutôt intéressé par celles qui nous lient à l’univers, en bon médecin de campagne qu’il est,
convaincu qu’il importe plus de préserver l’unité de l’être humain, à l’image de celle du cosmos. Au
contraire, sa sœur Laura, qui n’a jamais fait preuve de docilité, a immédiatement opté pour une âme
plurielle. Dès la fin du secondaire, alors que Igor opta sans hésitation pour son identité italienne et fit
un choix de stabilité, Laura s’en écarta résolument : des études en France, le choix d’un domaine qui
l’éloignait soigneusement des centres d’intérêt familiaux (le monde hispano-américain), une activité
éclectique et en perpétuel mouvement, des amis à cheval sur plusieurs cultures pour pouvoir partager
la relativité des points de vue, le besoin – toujours – de lire la réalité sous un angle différent, une vie
complexe d’un continent à l’autre, un grand besoin de stabilité au fond de l’âme mais l’impossibilité
de vivre une identité monolithique. Naturellement portée à l’analyse et à la conceptualisation, c’est
elle qui fit émerger en moi la conscience de ce fil rouge qui nous lie tous à l’expérience d’émigration
de mes parents, en positif comme en négatif.
Cette fascination du verbe « partir » pour mieux reconstruire, ce courage de repartir à zéro,
ce défi perpétuel, c’est bien cela l’héritage de mes parents. Fermer une maison, changer de pays, de
langue, d’habitudes, reconstruire chaque fois un espace et une unité familiale, se retrouver unis dans
la diversité : quelle fascination ! Dans d’autres circonstances, certes meilleures, c’est bien leur histoire
que j’ai intériorisée au point d’en faire inconsciemment un modèle, une contamination profonde
et inavouée en quelque sorte. La contamination de la fin et des moyens ; si la fin était le défi lui-même,
les moyens furent draconiens : le devoir et le travail, la voie royale qui a mené cet émigré
bergamasque à la parfaite intégration.
Si la contamination s’est traduite en termes de mobilité et de travail assidu, elle l’a été plus
encore dans le contenu que dans la forme. Nous ne sommes pas devenus de grands voyageurs ni
des touristes acharnés ; nous avons voulu comprendre, nous avons voulu « connaître pour aimer »
– selon la formule de Leonardo da Vinci devenue notre emblème – nous avons voulu, partout où la
vie et le travail nous ont conduits, tisser des liens c’est-à-dire comprendre, aimer et se faire aimer.
C’est pourquoi nous n’avons pas désiré accumuler à l’infini nos séjours à l’étranger en tant qu’attachés
culturels, nous avons préféré nous attarder à comprendre la culture des pays qui nous accueillaient,
à y construire une vie réelle et pleine avec l’Autre, faite de connaissance bien sûr, mais surtout
d’échanges, d’amitiés (qui restent toujours très vives), de réflexion, de projets. Aujourd’hui, notre
travail de recherche sur les sociétés méditerranéennes est le fruit de ce choix.
C’est ainsi que la contamination a évolué en dissémination et a imprégné toute notre activité et
notre vie. Oui, spontanément, ce récit qui a commencé à la première personne, ne peut se conclure
qu’en utilisant le « nous » car la force et la volonté d’intégration du « premier homme » s’est lentement
transformée en un besoin d’unité, en une habitude fondamentale, celle de saisir ce qui unit, non ce
qui divise ; un élan vital qui ne peut être vécu à la première personne et demande à être partagé.
Et la référence au Premier homme d’Albert Camus n’est pas ici un hasard : si j’y ai consacré mes
derniers travaux, c’est bien parce que l’expérience d’émigration de ma famille d’origine, comme celle
de Camus, continue à tracer le chemin de mes choix, de mes intérêts, continue à disséminer un
intarissable besoin de conciliation et d’osmose.